LV - L'intérieur de Rome pendant le proconsulat de César (58-49) |
IV - NOUVEAUX DESORDRES DANS ROME ; POMPEE SEUL CONSUL
(52)
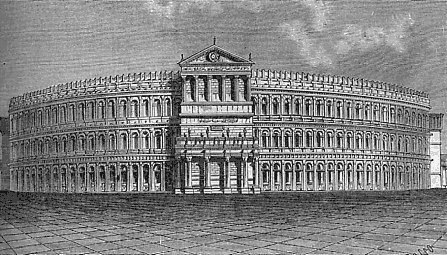
Théâtre de Pompée - Restauration de Victor Baltard |
Durant la désastreuse expédition de
Crassus, Pompée était resté à
Rome. Il avait cherché à consolider son
influence par la magnificence des jeux qu'il donna pour
l'inauguration de son théâtre : quarante mille
spectateurs y trouvèrent place et cinq cents lions y
furent tués. Son année consulaire
passée, il avait envoyé des lieutenants eu
Espagne, et, sous prétexte d'accomplir les devoirs de
sa charge pour les vivres, il était demeuré aux
portes de Rome. Ce consulat, pour lequel la ville avait
été si longtemps troublée, n'avait rien
produit, rien du moins pour les réformes utiles, mais
beaucoup pour l'ambitieux général lui
s'était attribué tant d'avantages personnels.
Lorsque l'on compare cette stérilité à
l'activité féconde de César en 59, on a
la mesure des deux hommes.
En déposant les faisceaux, Pompée laissa la
république dans la plus déplorable situation.
Littéralement tout se pesait au poids de l'or, le
mérite des candidats, comme l'innocence des
accusés, et le Forum n'était qu'un
marché où s'achetaient les suffrages, les
charges, les provinces. Gabinius avait vendu l'Egypte 10.000
talents à Ptolémée Aulète et
volé aux Syriens 100 millions de drachmes ; il
s'était mis en révolte même contre Rome,
méprisant les sénatus-consultes et les livres
sibyllins, sortant de sa province, malgré les
expresses défenses de la loi, et refusant de remettre
son gouvernement au remplaçant qui lui fut
envoyé. L'irritation était extrême dans
le sénat, moins à cause des
illégalités commises qu'en raison de ces
immenses richesses qui semblaient ne devoir rien laisser aux
successeurs. Malgré l'assistance de Pompée, il
fut condamné. Un seul fait montrera jusqu'où
allait la dépravation. C. Memmius, écrit
Cicéron, vient de lire en plein sénat un
marché d'élection passé entre lui et son
compétiteur Domitius d'un côté, d'autre
part les deux consuls en charge. Par ce traité,
Memmius et Domitius s'engagent, sous la condition
d'être désignés consuls pour
l'année prochaine, soit à payer aux consuls en
charge 400.000 sesterces, soit à procurer : 1°
trois augures affirmant avoir assisté à la
promulgation d'une loi curiate qui n'existait pas ; 2°
deux consulaires déclarant s'être trouvés
à une séance de distribution des provinces
consulaires, séance qui n'avait pas eu lieu.
«Que de malhonnêtes gens dans un seul contrat
!» dit Montesquieu. Ajoutons que 400.000 sesterces pour
un double faux si audacieux, c'était supposer la
conscience des augures et des consulaires à bien bon
marché ! Mais le peuple lui-même ne se vendait
pas cher : Verrès n'avait acheté sa
préture que 80.000 sesterces.
En même temps que la vénalité, la
violence : à chaque instant les traits, les pierres,
le sauve-qui-peut ; et point de journée sans meurtre ;
un consul même fut blessé. Un certain Pomptinus
attendait, depuis sept ans, en dehors du pomerium, un
triomphe que le sénat lui refusait pour des
succès remportés en 61 sur les Allobroges. Un
préteur, son ami, réunit enfin quelques
citoyens au point du jour, et, contrairement à la loi
qui interdisait toute assemblée avant la
première heure, il leur fit voter ce que Pomptinus
désirait. Ce candidat persévérant
triompha, mais au milieu d'un désordre extrême :
on se battit sur plusieurs points, et il y eut des morts.
Pour les plus mesquines ambitions, pour les plus petites
choses, on violait la loi et le sang coulait.
Qu'on se représente, au milieu d'une telle
société, Caton, alors préteur, allant
nu-pieds, sans tunique, siéger sur son tribunal et
faisant distribuer à la populace, au lieu des
fastueuses profusions dont elle avait l'habitude, des raves,
des laitues et des figues, ou bien proposant, après
l'extermination des Tenctères et des Usipiens, qu'on
livrât César aux Germains comme infracteur de la
paix, et l'on comprendra que cette opposition n'allait pas au
delà d'une protestation qui ne corrigeait personne et
faisait sourire tout le monde, excepté Favonius, le
singe de Caton.
Ces deux hommes, qui se croyaient des Romains de l'ancien
temps, ne changeaient pas, mais beaucoup d'autres avaient
changé. On a vu l'évolution rapide
opérée par Cicéron à
l'époque de la conférence de Lucques.
L'excellent homme qui, dans un Etat paisible, eût
gardé avec honneur la première place,
était, dans cette république orageuse,
tiré en sens contraire par ses idées et par ses
intérêts ; tantôt les uns, tantôt
les autres l'emportaient ; car il était aussi pauvre
de caractère qu'il était riche de talents. Pour
le moment, ses intérêts l'attachaient à
César, et il le fatiguait de ses éloges. Il
avait entrepris un poème en l'honneur du proconsul et
eut soin qu'il en fût informé ; le poème
fini, il le lui envoya, puis en commença un autre.
César, qui ménagea toujours le grand orateur
par goût pour son esprit, prit son frère Quintus
comme lieutenant et chargea Cicéron de veiller
à l'emploi d'une partie des fonds qu'il faisait passer
à Rome pour ses constructions. Lorsque Quintus
reprocha à son frère de l'avoir contraint
d'accepter cette lieutenance, ces fatigues ces dangers, dans
un pays qui semblait à Cicéron lui-même
au bout du monde : Le prix de ce sacrifice, lui
répond-il, sera la consolidation de notre position
politique par l'amitié d'un homme puissant et bon.
On voit à quoi se bornent ses désirs. Il ne
s'effraye même pas de la dictature imminente de
Pompée ; il en cause sans indignation, comme de tout
autre événement. Pompée en veut-il ?
N'en veut-il pas ? Qui le sait ? Mais tout le monde en parle.
Et, ajoute Appien, tout le monde le souhaite. On le disait
ouvertement : Aux maux présents il n'y a qu'un
remède, l'autorité d'un seul. Pompée
s'en défendait, tout en encourageant
secrètement les désordres qui rendaient cette
dictature nécessaire. Du moins, parmi les
conservateurs, beaucoup croyaient voir sa main dans les
émeutes.
Pour la seconde fois en trois ans, on ne put, dans
l'année 55, faire les élections consulaires :
l'interrègne dura sept mois. De guerre lasse, les
grands se rapprochèrent du sphinx menaçant dont
on devinait les désirs, mais qui continuait à
les cacher. En paraissant croire à son
désintéressement, on le força par des
flatteries calculées à laisser élire, le
septième mois, deux consuls. Soit impuissance
réelle de ce gouvernement à durer plus
longtemps, soit intrigues de Pompée, soit plutôt
ces deux causes réunies, l'interrègne
recommença l'année suivante (52). Milon,
Scipion et Hypsaeus demandaient le consulat les armes
à la main ; Clodius briguait la présure de la
même manière, et chaque jour une sédition
éclatait.
Au milieu de ces meurtres obscurs, il y en eut un qui porta
le désordre au comble. Milon se rendant à
Lanuvium, sa ville natale, dont il était le premier
magistrat (dictateur), rencontra Clodius sur la voie
Appienne, près de Boville. Comme les barons romains du
moyen âge, ils ne marchaient l'un et l'autre
qu'escortés d'une bande de spadassins. Les deux
troupes se croisèrent, en se lançant des
regards furieux, cependant elles s'éloignaient,
lorsque deux gladiateurs de Milon restés en
arrière se prirent de querelle avec des gens de
Clodius. Celui-ci, accouru au secours des siens, fut
blessé et se réfugia dans une hôtellerie.
Milon pensa qu'il ne lui en coûterait pas plus de
l'achever, et, comme sa bande était nombreuse, l'autre
s'enfuit en laissant onze morts sur la place. La porte de la
taverne fut alors enfoncée, le cabaretier tué,
Clodius percé de coups et son cadavre jeté sur
la route, où il resta jusqu'au soir. Un
sénateur qui revenait de sa villa le ramena à
Rome (13 déc. 53). Fulvie, femme de Clodius, sa
famille, la puissante gens Claudia, le peuple, dont il
avait été longtemps le favori, crièrent
vengeance ; on exposa le corps sur la tribune aux harangues,
et la foule ameutée lui donna pour bûcher
l'édifice où le sénat s'assemblait. La
curie brûlée, ils essayèrent d'incendier
la maison de Milon, puis celle de l'interroi ; mais des
chevaliers, des sénateurs, accoururent armés ;
on s'égorgea encore les jours suivants. Les bandits,
les voleurs, profitaient de ces meurtres pour faire leur
main. Sous prétexte de chercher les complices de
Milon, ils pénétraient dans les maisons et
volaient ; dans les rues, ils tuaient ceux dont le riche
costume ou les anneaux d'or promettaient qu'il y aurait
profit à dépouiller leurs cadavres. La
politique, ou ce qu'on appelait ainsi, couvrait tout.
On comprend que ces abominations aient fini par ouvrir les
yeux à creux qui les fermaient obstinément,
pour ne pas voir que le seul moyen de sauver la vie sociale
qui périssait était la concentration des
pouvoirs dans la main d'un chef énergique. Un
sénatus-consulte décida que la curie
brûlée serait rebâtie aux frais du
trésor par Faustus Sylla et qu'elle porterait le nom
de son père. Par cet hommage inattendu à la
mémoire du bourreau des marianistes, la
majorité sénatoriale montrait à la fois
ses sentiments à l'égard du neveu de Marius et
le souvenir reconnaissant qu'elle conservait de l'homme qui,
trente ans plus tôt, avait rétabli l'ordre par
la dictature. Naguère Caton attaquait encore
Pompée au sénat : «Il dispose de tout,
disait-il ; dernièrement, il a prêté
à César six mille hommes sans que l'un vous les
ait demandés, sans que l'autre vous en ait
prévenus. Des armes, des chevaux, une légion
entière, sont les présents qu'échangent
maintenant des particuliers. Avec son titre
d'imperator, Pompée distribue les armées
et les provinces tout en restant dans la ville où il
machine des troubles et des séditions, afin de se
frayer par l'anarchie un chemin à la
royauté». Mais, en face de la dissolution
imminente de l'Etat, il en vint, lui aussi, à
désespérer de la république. Il la
voyait menacée de deux dangers : au dedans par
l'anarchie, qui n'était que trop certaine ; au dehors
par César, qui cependant n'avait encore
justifié ses soupçons ni par des actes ni par
des paroles ; et quand il cherchait autour de lui qui
voudrait défendre l'aristocratie, il trouvait,
même en ceux que Cicéron avait appelés le
parti des honnêtes gens, tant d'indifférence,
qu'il se décida enfin à demander pour elle
à un homme la protection que les lois ne pouvaient
plus lui donner. Mieux vaut, dit-il, se choisir un
maître qu'attendre le tyran qui certainement
naîtra de cet immense désordre ; et il
appuya la proposition que fit Bibulus de nommer Pompée
seul consul. Il pensait que, content de ce titre,
Pompée userait avec modération de son pouvoir,
qu'il rétablirait l'ordre dans la ville, et saurait
contraindre César à quitter son armée.
Cette tâche remplie, Caton se promettait de le forcer
à compter avec le sénat. S'il échouait,
cette dictature du moins n'aurait été qu'une
passagère et bienfaisante tyrannie. Pompée le
confirma dans cette espérance, en feignant de ne plus
agir que par ses conseils. Il fut élu seul consul le
27 février 52.
Cet événement était grave, car il
consommait la réunion de Pompée avec le
sénat et sa rupture avec le proconsul des Gaules.
Depuis deux ans on prévoyait ce résultat. La
mort de Julie, l'épouse aimante de Pompée, la
fille chérie de César, avait brisé un
lien que tous deux auraient respecté (54) ; et depuis
la fin de Crassus (53), ils se trouvaient en présence,
sans intermédiaire qui prévint ou
arrêtât les chocs. Une rivalité à
trois peut durer, parce qu'un des trois maintient
l'équilibre en se portant de l'un ou de l'autre
côté ; une rivalité à deux
amène bientôt la guerre. Pompée avait
depuis longtemps reconnu la fausse position que lui avaient
faite sa versatilité et l'habileté de son
adversaire ; pour rompre avec lui, il n'attendait qu'un
retour du sénat ; or voici que les grands, que Caton
même, lui offraient, par une violation de toutes les
règles constitutionnelles, une domination sans
partage.
Proconsul d'Espagne, il était légalement
considéré comme absent, c'est-à-dire
incapable d'être élu à une charge
urbaine, et on lui donnait le consulat ! Cette suprême
magistrature de la cité devait toujours être
partagée, et il était seul consul. S'il voulait
un collègue, c'était lui, et non pas les
comices, qui devait le choisir ; encore prenait-on des
garanties contre son désintéressement, en ne
lui permettant pas de se donner avant deux mois ce
collègue autrefois nécessaire. Le consul
n'avait pas, dans Rome, l'autorité militaire, le
jus necis ; Pompée restant gouverneur de
province gardait l'imperium, et, pour que personne ne
discutât son droit à l'exercer dans la ville, le
sénat l'avait encore investi de l'autorité
dictatoriale par la formule des jours de péril public
: Caveat consul. Enfin au pouvoir on avait
ajouté les moyens d'action : un décret lui
ouvrait le trésor et lui prescrivait de lever des
troupes en Italie. Il était donc le maître, et
comme il le voulait être, en sauvant les apparences,
puisqu'il n'avait rien pris de vive force et qu'il tenait
tout du sénat. Mais qui ne voit que l'aristocratie
fondait l'empire ? Il suffit de comparer les pouvoirs de
Pompée avec ceux d'Auguste pour reconnaître
qu'ils sont à peu près semblables ; car la
révolution impériale ne fut que la
concentration viagère dans les mains d'un seul des
droits répartis chaque année par la
république entre plusieurs.
Au moment où les grands, par haine contre César
et par impuissance à gouverner, sacrifiaient à
un chef incapable ce qu'ils appelaient la liberté
romaine, le proconsul qu'ils voulaient proscrire,
dédaignant leurs menaces séniles, faisait pour
Rome cette merveilleuse campagne de l'année 52, qui le
place à côté d'Annibal, et tenait la
Gaule captive dans Alésia !
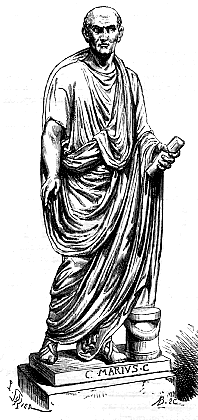
Marius |
Pour expliquer la violence de cette haine, il faut reconnaître que les grands avaient de très sérieux motifs de détester César ; mais l'histoire doit rechercher si ces motifs étaient légitimes. La véritable question entre eux était le maintien ou le renversement de la législation cornélienne, qui avait tout pris au peuple pour tout donner au sénat. Quoique bien des brèches eussent été pratiquées dans la forteresse aristocratique, même par la main de Pompée, elle tenait bon et restait debout ; le neveu de Marius voulait en forcer les portes. Sans qu'il eût commis une illégalité, et par le seul fait d'avoir relevé le parti populaire écrasé sous Sylla, les nobles avaient à trembler pour leur pouvoir, et ils tremblaient plus encore pour leurs biens. Ses lois consulaires, si elles avaient été exécutées, auraient tari la source où ils puisaient leurs richesses ; d'un mot il pouvait même les ruiner, en provoquant un plébiscite qui autorisât les revendications des familles dépouillées par Sylla, ou qui forçât les anciens généraux à remettre au trésor le butin de guerre qu'ils s'étaient approprié. La plupart des fortunes de l'oligarchie étaient faites de l'or ravi aux provinces, comme celle de Lucullus, et de terres enlevées aux proscrits, comme celle du plus violent adversaire de César, ce Domitius qui en avait assez pour être en état de promettre durant la guerre civile à chacun de ses soldats, une ferme prise sur son bien. Jusqu'à présent, les spoliateurs avaient tenu leurs vols hors d'atteinte par la loi qui avait interdit aux fils des victimes de Sylla l'accès aux charges publiques. Ils avaient espéré rendre la proscription éternelle, en prévenant toute dangereuse rogation d'un fils de proscrit qui parviendrait au tribunat. Que César fasse restituer leurs droits civiques à ceux qu'une loi d'odieuse iniquité en a privés, et l'oligarchie perdra ces immenses domaines acquis par le meurtre. Voilà les craintes que l'on cachait sous l'accusation de tyrannie prochaine, et l'histoire, surtout en notre temps, n'est pas tenue de partager ces colères ; voilà aussi pourquoi la majorité sénatoriale aimera mieux déchaîner la guerre civile que de voir un second consulat de César : c'est le secret de ses avances à Pompée. |
Ce personnage devait beaucoup à son ancien
collègue qui, en 59, l'avait défendu contre les
grands ; qui, en 55, avait loyalement contribué
à faire sa fortune présente. Mais lorsque
Pompée fut assuré de la grande situation que
lui avait faite le plébiscite trébonien, quand
il eut joint à son intendance des vivres, qui lui
livrait Rome et l'Italie, le proconsulat d'Espagne et
d'Afrique, qui lui donnait des provinces et des
armées, il n'avait plus gardé pour le proconsul
des Gaules que des égards de convenance, lesquels
cessèrent avec la vie de Julie. En vain César
lui proposa de consolider leur alliance politique par une
double alliance de famille : César épousant une
fille de Pompée, et celui-ci une petite-nièce
de César ; il refusa et fit entrer dans sa maison la
fille d'un ennemi acharné de son ancien
beau-père. L'amitié de César, qu'il
avait subie dix ans, pesait à son orgueil, et cette
renommée devenue si grande lui était importune.
Il entendait ne plus partager avec personne, et nous allons
le voir se servir de son autorité consulaire pour
annuler les avantages qu'il avait été
contraint, en l'année 55, de faire accorder au
proconsul des Gaules.
D'abord il voulut montrer que tout le monde aurait à
compter avec lui. Il proposa de nouvelles lois contre la
corruption, la violence et la brigue, en leur donnant un
effet rétroactif de vingt années. Le proconsul
en fut blessé, car, avec ces lois, un affidé
des grands pouvait le citer devant des juges bien faciles
à corrompre ou à intimider. Caton
lui-même trouvait cette disposition inique. Les amis de
César réclamèrent ; Pompée ne les
écouta pas. Pour se débarrasser de Milon et de
sa bande, il laissa instruire le procès du meurtrier
de Clodius. Cicéron avait longtemps souhaité ce
meurtre, et Caton osa dire en plein sénat que Milon
avait agi en bon citoyen, tant ces temps malheureux
troublaient les consciences les plus honnêtes. Mais le
peuple était trop irrité pour que justice ne
fût point faite. Les soldats dont Pompée entour
le tribunal effrayèrent le défenseur, qui
plaida mal ; l'accusé s'exila à Marseille.
Quand il y reçut la Milonienne savamment
recomposée par Cicéron dans le silence du
cabinet : S'il avait parlé comme il sait
écrire, dit l'épicurien, je ne mangerais
pas aujourd'hui d'aussi bon poisson. L'habile orateur
avait eu plus de courage lorsque, au temps de
l'étroite union entre les triumvirs, il avait fallu
défendre leurs amis. Il n'avait pas
hésité à renier sa vie entière,
ses convictions, ses vieilles rancunes, en prenant la cause
d'un Vatinius et d'un Gabinius, les hommes les plus
tarés, ou celle de tant d'autres dont il disait en
secret : Que je meure si je sais comment les
défendre ! Malgré ses efforts pour
expliquer cette conduite, il en sentait l'indignité,
et il cherchait à s'oublier lui-même en des
travaux littéraires impuissants à le
consoler.
Clodius mort, Milon en exil et leurs bandes
dispersées, le calme revint, tant il suffisait d'un
homme ayant la volonté de maintenir l'ordre pour que
la paix régnât dans la cité. Mais
Pompée, capable d'actes énergiques,
était incapable de les soutenir longtemps, parce qu'en
politique il allait à l'aventure, sans principe
arrêté ni plan de conduite, se fiant, en vrai
Romain, à la fortune du jour, c'est-à-dire aux
circonstances ; aujourd'hui avec Sylla, demain avec
César ; restaurateur des droits populaires, puis
défenseur de l'oligarchie. Il ne se tenait même
pas pour obligé par les lois qu'il avait faites. Il
avait interdit les éloges que prononçaient au
tribunal les amis puissants d'un accusé ; et quand
Metellus Scipion, son beau-père, fut cité en
justice, il vint le défendre, c'est-à-dire
ordonner l'acquittement ; pour le même délit,
Plautius Hypsoeus était condamné. Il avait fait
décréter que les magistrats ne pourraient avoir
une province que cinq années après leur sortie
de charge ; la mesure était excellente, il l'annula en
demandant que ses pouvoirs proconsulaires fussent
prorogés pour cinq ans avec le droit de prendre chaque
année 1000 talents dans le trésor. Il avait
établi par la loi de jure magistratuum que nul
ne pourrait, absent de Rome, briguer une charge, et il y
introduisit presque aussitôt une exception qui la
détruisait.
Ces contradictions prouvent que Rome n'aurait pas
trouvé en Pompée l'homme résolu et ferme
dont elle avait besoin, mais les grands ne s'en
inquiétaient pas. Tout à leur haine, ils
aidaient le consul à enlacer César dans un
réseau de dispositions législatives qui
devaient réduire le proconsul des Gaules à
l'impuissance. La nouvelle loi judiciaire permettait,
à un moment donné, d'incriminer tous ses actes,
et le procès de Milon venait de montrer comment
Pompée comprenait la liberté des tribunaux.
L'interdiction de briguer absent une magistrature le
forçait, s'il voulait un second consulat, d'abandonner
ses provinces et de se mettre à la discrétion
de ses ennemis. Echappait-il aux juges, c'est-à-dire
à l'exil, et parvenait-il à obtenir du peuple
les faisceaux consulaires, l'obligation d'attendre cinq ans,
après sa sortie de charge, un gouvernement provincial,
le laissait désarmé, durant ces cinq
années, en face de Pompée, maître
jusqu'en 46 du trésor et de grandes forces
militaires.
Les nobles ne voulaient à aucun prix le laisser
arriver à un nouveau consulat. Le premier avait
révélé un plan de réformes qui
serait certainement repris et développé, et ils
croyaient que leur nouvel allié venait d'arrêter
un ensemble de mesures qui devait les mettre à l'abri
de ce danger. Mais, dans cette campagne législative si
bien conduite, les habiles gens du sénat avaient tout
calculé, sauf le degré de résignation
auquel s'abaisserait, devant ces convoitises si claires et
ces menaces si peu déguisées, l'homme dont les
victoires permettaient d'oublier le désastre de
Crassus. Contre la loi judiciaire, César
s'était contenté des réclamations de ses
amis, résolu qu'il était à ne pas
s'exposer aux coups de la justice romaine tant que celui qui
venait, par ses lois, de lui déclarer la guerre,
garderait à Rome une dictature officielle ou à
demi voilée. Au sujet de la disposition qui mettait un
intervalle de cinq années entre l'exercice d'une
grande charge et la gestion d'un proconsulat, il se dit sans
doute que ce qui avait été fait par un consul
pourrait être défait par un autre. Un consulat
lui était donc nécessaire pour briser ces lacs
si artificieusement tressés par son allié
d'hier, son adversaire d'aujourd'hui ; et ce consulat, il
fallait qu'il pût le briguer du fond de sa province,
parce qu'il était perdu s'il reparaissait un seul jour
dans la ville sans être couvert par l'imperium.
Il exigea que la loi touchant l'absence fût
modifiée, et il doit l'avoir fait de telle
façon, que Pompée, qui n'était pas en
mesure de rompre avec lui, fut contraint d'y consentir. Un
refus aurait fait éclater probablement la guerre
civile trois années plus tôt. Cicéron
s'interposa. Il se rendit à Ravenne, où
l'ancien associé du proconsul des Gaules l'avait
envoyé, et, de retour à Rome, il agit
auprès de son ami Caelius, alors investi de la
puissance tribunitienne, pour faire accepter les conditions
qu'il rapportait. Pompée pressa lui-même les
autres tribuns de provoquer une loi qui consacrât le
droit réclamé par César. Le
plébiscite fut voté et dut l'être
à l'unanimité, puisque le peuple,
représenté par ses dix tribuns, l'acceptait, et
que le parti sénatorial, entraîné
malgré lui par Cicéron et Pompée, le
subissait. Sur la table d'airain où la loi consulaire
contre les absents était déjà
gravée, Pompée ajouta l'exception qui venait
d'être faite en faveur de César. Après la
solennité de ce dernier vote, il ne pouvait plus avoir
l'espérance de trouver des jurisconsultes pour
rappeler que, selon la loi des Douze Tables, le
privilegium était nul et de nul effet. Il avait
menacé, et il était revenu sur sa menace : jeu
double et dangereux qui révélait son
caractère incertain.
César venait de gagner sa cause, non par la force,
mais par une loi ; car, en lui accordant le
bénéfice de l'absence, on lui assurait toutes
les garanties que réclamaient son ambition et sa
sécurité. Le plébiscite, en effet, lui
reconnaissait implicitement le droit de rester à la
tête de son armée jusqu'au jour où il
pourrait briguer légalement le consulat,
c'est-à-dire jusqu'au milieu de 49. Cicéron,
redevenu son ennemi, sera forcé de le proclamer
lui-même. En lui donnant le bénéfice de
l'absence, on lui a donné le droit de garder son
armée jusqu'aux comices consulaires.
Tout cela était fort peu républicain : mais
est-ce qu'il y avait alors une république à
Rome ? Bien habile serait celui qui pourrait dire où
était le droit véritable. L'argent et
l'intimidation ayant depuis longtemps décidé
les votes, toute loi pouvait être abrogée, toute
élection cassée pour vice de forme, corruption
ou violence, à quelque faction qu'appartînt
l'élu ou l'auteur de la loi. La république
était morte depuis que Rome n'avait plus de libres
comices, et l'on peut dire que, depuis le meurtre des
Gracques, elle n'en avait pas eu.