- GRECE
Le terme de mimos a trois acceptions : il désigne l'acteur, homme ou femme, qui produit une imitation ; l'imitation elle-même ; enfin un genre voisin de la comédie, et dont le premier représentant est, pour nous, Sophron de Syracuse. Au plus bas degré parmi les acteurs-mimes peuvent être placés ces baladins dont les imitations vocales (chevaux hennissants, taureaux mugissants, bruit des torrents et de la mer, grondement du tonnerre, etc.) étaient très en faveur auprès du public. Le mime est quelquefois aussi un danseur : le terme d'orchêstês s'applique à lui ; et cette identification est naturelle, car, ainsi qu'on l'a justement montré, la séparation que notre art orchestique met entre la mimique et la danse n'existe pas chez les Grecs au même degré : bien que les monuments figurés nous montrent «des pas de danse... qui paraissent, comme les nôtres, entièrement dépourvus de sens mimétique», le danseur grec est le plus souvent un mime : l'objet de son art est l'imitation individuelle ou l'imitation en masse [Saltatio]. Un certain nombre de danses sont des imitations d'animaux, de personnages typiques ou de scènes plaisantes. Le morphasmos est défini par Pollux : pantodamôn zôôn mimêsis, et les danses appelées skôps, leôn, glaux, alôpêx, geranos, n'en sont, sans doute, que des formes particulières ; à la catégorie des danses typiques se rattachent l'aggelikê, où l'on reproduisait la gesticulation et les attitudes des messagers, et la danse laconienne des upogupônes ; parmi les danses qui sont proprement des scènes comiques, on peut mentionner la klôpeia et la klopê tôn eôlôn kreôn : celle-ci était spécialement appelée mimétique ; la klôpeia était peut-être une scène à un seul personnage, la mimique du voleur pouvant marquer d'une manière assez claire l'intervention du volé ; une danse d'un autre caractère, la karpaia des Aenianes et des Magnètes, était un mime à deux personnages : un laboureur sème son champ en se retournant fréquemment, comme un homme qui a peur : un brigand survient, et une lutte s'engage dont les boeufs et la charrue sont l'enjeu. D'un genre analogue est la scène des amours de Bacchus et d'Ariadne, qui termine le Banquet de Xénophon : la physionomie et les gestes des acteurs donnent une impression de réalité saisissante, mais il n'est pas fait usage de la parole [Pantomimus]. Parallèlement à ces danses mimétiques où une action suivie et complète est représentée par simple gesticulation, se développe un autre genre de mime, plus voisin de la comédie : il ne se borne pas à l'imitation des gestes typiques, il représente aussi par la parole ou par le chant des scènes bouffonnes et des parodies. Ce mime, qui est, par excellence, le divertissement populaire, n'a pas un développement rectiligne : nous le verrons plus loin naître spontanément dans des fêtes dionysiaques, mais on en voit d'autre part une espèce profane, dont on peul chercher l'origine dans les parades des thaumatopoioi. Le jongleur n'a pas de plus sûr moyen que la mimique pour retenir ou attirer les passants [Balatro, Cinaedus] : il imitera, par exemple, des bruits ou des animaux et pourra même contrefaire quelque personnage ridicule, parmi les gens qui font cercle autour de lui. Nous voyons d'ailleurs que les mots thaumatopoioi, mimoi, êthologoi, sont constamment rapprochés. Athénée nous montre une sorte d'ascension de jongleur à mime : un thaumatopoiois appelé Nymphodoros devint presque aussi célèbre que Créon, le plus renommé des mimes italiotes. Le crieur public Ischomachos eut une carrière analogue : il produisit d'abord ses imitations dans la rue (en kuxlois), puis, ayant acquis de la renommée, il joua des mimes dans des théâtres forains (en thaumasin).
Le mime, sous ses formes multiples, fut de tout temps très populaire en Grèce et dans l'Italie méridionale. Nombreux furent ces mimoi geloiôn dont s'entourait Philippe de Macédoine, et les charges mimiques avaient sans doute une assez large place dans le répertoire de ce collège des Soixante oi exêkonta qui se réunissait au temple d'Héraklès à Dioméies. Athénée énumère longuement des bouffons italiotes qui n'imitaient pas seulement les lutteurs et les pugilistes, les chanteurs de dithyrambes et les citharèdes : certains d'entre eux jouaient de véritables mimes Kuklôpa eisêgage teretizona, kai nauagon Odussea teretizonta. Mais ces témoignages sont relatifs à des faits qui, le plus souvent, ne sont pas antérieurs au IIIe siècle, ou à la fin du IVe av. J.-C). Pouvons-nous remonter à des origines plus lointaines ?
Un témoignage relatif à d'anciennes représentations mimiques, et dont l'intérêt serait beaucoup plus grand si les compilateurs avaient eu plus de souci de la chronologie, est celui qui concerne les Dikélistes. Leurs farces sont, nous dit-on, «une forme ancienne de jeu comique», d'une simplicité toute spartiate. On y représentait notamment le médecin étranger qui donne sa consultation dans un langage et avec un accent barbares. Un personnage de la Mandragorizomenê d'Alexis reprendra ce thème comique en montrant qu'un médecin ne passe pour grand clerc auprès du peuple, que sil vient de loin et écorche le grec. Ce nom de Dikélistes parait être tout simplement l'appellation lacédémonienne des mimes ; la même espèce de bouffons porte, en certains endroits, le nom d'autokabdaloi, à cause du caractère improvisé de leurs scènes comiques. Ces acteurs paraissaient couronnés de lierre, et débitaient de longues tirades. Les Phallopllores de Sicyone semblent donner mêmes divertissements que les Dikélistes. Ils n'ont pas de masque, mais ils se couvrent le visage avec du serpolet et des feuilles d'acanthe, ils ont une épaisse couronne, faite de lierre et de violettes, et portent une sorte de pelisse (kaunakês) : ils s'avancent, en marchant d'un pas rythmé, les uns par l'entrée ordinaire du choeur, les autres par les portes centrales, et entonnent en l'honneur de Bacchus un chant «qui ne convient pas aux jeunes filles» ; puis, ils rompent les rangs et se mettent à railler qui bon leur semble. Enfin ils jouent une scène dramatique, car c'est ainsi qu'il faut vraisemblablement expliquer l'expression stadên epratton. Relevons un détail dans cette description d'Athénée : les Phallophores ne portent pas de masque, et tel semble avoir été l'usage constant pour les acteurs-mimes. Cette tradition nous explique, mieux que les raisons d'art invoquées par Heydemann, l'absence de masque chez certains Phlyaques [Phlyakes].
Les mimes de Sophron, moins proches des danses mimétiques qu'on ne l'a quelquefois admis étaient des tableaux de moeurs, des scènes fort simples où paraissaient des dieux, et surtout des gens de la classe populaire (les Ravaudeuses, le Pêcheur de thons, le Pêcheur et le Paysan, les Sorcières, etc.), dont l'auteur syracusain excellait à copier la désinvolture, le langage semé de proverbes, les plaisanteries grossières. Ces mimes étaient certainement dialogués ; une distinction ancienne, rappelée par Suidas, et qui ne date peut-être que du grammairien Apollodore d'Athènes (IIe siècle av. J.-C.), les divisait en mimoi andreioi et mimoi gunaikeioi. Il faut entendre par là ou bien que les mimes, suivant leur catégorie, représentaient exclusivement des hommes ou des femmes, ou bien que les rôles étaient inégalement répartis, un protagoniste, homme ou femme, concentrant. sur lui presque tout l'intérêt. Enfin ces mimes, dont le dialecte est le dorien populaire, étaient écrits en prose rythmée. Le scoliaste de saint Grégoire de Nazianze nous dit, en effet, que Sophron empruntait des poètes les membres rythmiques, mais qu'il les combinait librement, «sans tenir compte des lois ordinaires et des règles d'affinité». Encore aujourd'hui notre oreille saisit dans les fragments de véritables cadences : un heureux agencement de brèves et de longues donne à la phrase une harmonie qui ressemble au nombre oratoire.
Nous savons que le mime fut cultivé après Sophron par son fils Xénarque. Mais ce dernier nous est à peu près inconnu : il est mentionné par Aristote et Suidas nous dit qu'il railla les Rhégiens pour leur lâcheté, sur l'ordre de Denys le Tyran. Si ce ne fut pas un cas unique, on serait fondé à penser que Xénarque, en tournant le mime à la satire politique, fit déchoir un genre dont le plus grand mérite avait été, chez Sophron, la fidélité. Il est assez naturel, il est vrai, qu'un genre comique en faveur auprès du public ne restait pas étranger à la politique, dans un temps où la tragédie elle-même ne s'en désintéressait pas. A l'époque alexandrine le mime retrouvera, naturellement, son indifférence à l'égard des affaires : il fera quelquefois l'éloge des princes ou de quelque illustre personnage, mais son unique préoccupation sera l'étude des moeurs.
Au IIIe siècle av. J.-C., tandis que des poètes alexandrins écrivent des mimes littéraires, la Grande-Grèce garde encore une forme populaire du genre dans les divertissements des Phlyaques. Le Phlyaque est proche parent du mime : d'après Athénée, ses farces sont du même genre que celles des Dikélistes, et les peintures de vases où Jahn et Heydemann croient avec raison retrouver leurs scènes bouffonnes nous représentent de véritables mimes [Phlyakes]. Le papyrus publié par M. Kenyon en 1891, et qui contenait sept poèmes complets d'Hérondas, nous a très heureusement fait connaître des mimes réalistes traités par l'art alexandrin. Il paraît établi qu'Hérondas, dont les poèmes sont écrits en choliambes, dans un dialecte ionien mélangé de formes doriennes et attiques, et sous l'inspiration d'Hipponax, est contemporain de Ptolémée Philadelphe. Il a donc écrit des mimes avant Théocrite. Les Mimiambes, qui sont des études de caractères et de types, nous montrent la vie des anciens dans ses détails familiers, et même dans ses postscenia. Nous n'avons pas à étudier ici ce que Diels appelle justement leur «réalisme raffiné». Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'ils étaient joués, et dans quelles conditions. La question se résout, plus facilement pour les mimes de Théocrite, qui sont certainement «livresques» : à la rigueur, l'idylle XIV pouvait être jouée, mais les autres ne paraissent pas s'y prêter.
En est-il autrement des Mimiambes, et quelle sorte d'exécution pouvaient-ils recevoir ? La plupart des critiques pensent qu'ils n'étaient pas joués, car il n'eût guère valu la peine d'installer un décor pour une pièce de cent vers, et tel trime, par exemple les Asklêpiô anatitheisai, se fût mal accommodé de décors ou d'accessoires grossiers ; en ce qui regarde la distribution des rôles, il est peu vraisemblable que dans le mime VII on employait sept acteurs pour cent vingt-neuf vers ; enfin, l'action aurait eu peine quelquefois à suivre le texte, et certains mimes auraient paru tronqués. Il nous paraît, en effet, qu'une exécution dramatique des Mimiambes ne pouvait être qu'une fantaisie de lettré : un public choisi eût été d'imagination complaisante, et, volontiers, eût excusé certains vides (par exemple I, 79 et suiv.), ou des morceaux (par exemple II) brusquement découpés dans la réalité. Mais si les Mimiambes ont paru devant un plus grand public, il est vraisemblable d'admettre qu'ils étaient récités par un acteur unique qui, très habile à contrefaire sa voix, à gesticuler, à marquer à propos des temps d'arrêt, rendait présents aux yeux des spectateurs tous les personnages du petit drame. M. Crusius admet que les Mimiambes étaient vraiment joués (entendons : avec autant d'acteurs que de rôles) : il montre notamment que le style d'Hérondas a un caractère agonistique ; que certains tours semblent réclamer le geste pour être compris ; que l'énumération des chaussures dans le septième mime produit l'effet «d'un extrait du Lexique de Pollux», s'il n'est enlevé prestissimo. Mais ces observations, fort justes, peuvent être également invoquées dans l'hypothèse d'un seul récitant et dans celle de plusieurs acteurs. - ROME
Mime, en latin comme mimos en grec, désigne à la fois le personnage qui représente une certaine action en public et l'action elle-même qui est représentée, la pièce et l'acteur. Le mot grec d'où il est tiré, et qui signifie imitation (mimos, apo tou mimeisthai), est trop général pour définir un genre particulier, puisque Aristote prétend que l'imitation est le principe de toute la poésie. Les grammairiens latins, en l'appliquant spécialement au mime, ont cru devoir le restreindre et le préciser. «Le mime, disent-ils, est l'imitation des actions vulgaires et des personnages grossiers». Cette imitation est susceptible de prendre des caractères différents suivant le milieu où elle se produit, sur les places publiques, dans les maisons particulières ou au théâtre. De là trois sortes de mimes, qu'il convient d'étudier à part.
La première ne nous arrêtera pas longtemps. On sait que les villes anciennes devaient être plus animées que celles d'aujourd'hui, les habitants n'étant guère accoutumés à rester chez eux. Les rues et les places, qu'ils fréquentaient très volontiers, leur offraient les spectacles les plus amusants : à Rome, parmi les baladins et les charlatans de toute espèce, qu'on appelait circulatores, parce qu'on faisait cercle autour d'eux, les faiseurs de tours (praestigiatores), les diseurs de bonne aventure (divini), devant lesquels s'arrêtait Horace, les gens montés sur des échasses (grallatores), dont Plaute fait mention, les danseurs de corde (petauristae, funambuli), pour lesquels on délaissa l'Hécyre de Térence, ceux qui exécutaient ces danses sur place (staticuli) dont parle Caton et qui sans doute consistaient plus en gestes des bras qu'en mouvements des pieds, ceux enfin dont l'industrie consistait à se dire mutuellement des injures (opprobria rustica), ou à interpeller les passants, divertissement qui a toujours fait la joie des Romains, il devait s'en trouver qui représentaient des mimes proprement dits. Ceux-là égayaient la foule en imitant soit divers animaux, soit les artisans qui exerçaient des métiers vulgaires, les muletiers, les cordonniers, les charlatans, les cuisiniers, etc. Quelques-uns s'élevaient jusqu'à des professions plus distinguées, comme celui qui se vante, dans son épitaphe, «d'avoir été le premier à imiter les avocats» ; il s'appelle lui-même l'amuseur de Tibère, Caesaris lusor, ce qui ne devait pas être un métier facile. De ces mimes de la rue, on comprend qu'il ne soit rien resté et que nous ayons peu de chose à en dire.
Nous sommes un peu mieux renseignés sur ceux qui se produisaient dans les maisons des particuliers. Nous savons que Sylla se plaisait à fréquenter les comédiens grecs et romains. A certaines heures, il donnait congé aux affaires sérieuses, il admettait à sa table des bouffons, parmi lesquels l'archimime Sorix, et faisait assaut de plaisanteries avec eux. 0n dit même que, pour leur témoigner sa reconnaissance, il leur distribua des terres qui appartenaient au domaine public. Auguste, au milieu de ses repas, écoutait des musiciens et des histrions ; il y admettait des baladins, qu'il prenait parmi ceux de la rue et du grand cirque ; mais il aimait surtout les mimes qu'on appelait aretalogi, qui excellaient à raconter des histoires extraordinaires. Ce goût pour les mimes a persisté chez les empereurs jusqu'à la fin. Aurélien les aimait avec passion et Carin en avait rempli le Palatin. On les introduisit dans les fêtes de famille jusqu'à la fin de l'antiquité. Il est naturel de croire que les succès que les pièces de ce genre obtenaient chez les princes et dans la haute société donnèrent l'idée de former des artistes pour les représenter. Horace parle d'une école, qui était dirigée par un musicien de talent, Tigellius Hermogène, et parmi les élèves qui écoutaient ses leçons, il place des mimes. Il n'y a guère de doute que les Mimiambes que Cn. Malius a composés vers l'époque de César ne fussent aussi destinés à paraître dans les exhibitions du grand monde. Comme les minces d'Hérondas, ils sont écrits en cholïambes ou scazons, sorte d'iambe trimètre dont le dernier pied est un spondée, qui ne paraît pas être un vers de comédie, et les quelques fragments qui nous restent de ces pièces paraissent se rattacher à la poésie élégiaque plus qu'à la poésie comique. Mais c'est principalement au théâtre que le mime a pris de l'importance ; c'est là qu'il nous faut surtout le suivre. Il est question de lui dès l'époque de Sylla, et il est probable qu'il remonte beaucoup plus haut et qu'il est presque aussi ancien que les jeux scéniques. Les acteurs de mimes remplissaient au théâtre des fonctions différentes. On nous les montre, dans les premiers temps, se produisant dans l'orchestre et exécutant leurs jeux de plain-pied avec les derniers rangs des spectateurs (in plano orchestrae). On prétend que c'est ce qui leur avait fait donner le nom de planipedes ; mais il est plus vraisemblable qu'on ne les avait appelés ainsi que parce qu'ils n'étaient pas chaussés de socques et de brodequins, comme les acteurs de comédies et de tragédies. Peut-être les exercices de ces mimes étaient-ils destinés à faire prendre patience au public, avant que le véritable spectacle commençait. Le plus souvent ils montaient sur la scène, mais seulement sur la partie antérieure du proscenium, qui était séparée du reste par un rideau particulier, qu'on appelait siparium, ou mimicum velum. On suppose qu'ils amusaient la foule dans l'intervalle des actes ou des pièces, ce qui était aussi le rôle du tibicen. Nous savons enfin qu'à une certaine époque les mimes furent chargés de clore les représentations scéniques. Un scoliaste de Juvénal nous dit que c'était l'usage, chez les anciens, d'introduire, à la fin du spectacle, un bouffon «qui devait sécher les larmes que la tragédie avait fait couler». Ce bouffon s'appelait exodiarius, et les pièces qu'il jouait portaient le nom d'exodia. Ces exodia furent d'abord introduits dans les Atellanes ; mais Cicéron nous dit que, de son temps, l'Atellane, qui probablement avait cessé de plaire, fut remplacée par le mime. C'est la preuve de la vogue que le mime obtenait en ce moment.
Quant à nous rendre compte exactement de ce que les mimes devaient être à cette époque, nous avons peine à y parvenir, non seulement parce qu'il n'en reste rien, mais parce que les renseignements qu'on nous donne sur eux sont très confus. On a vu plus haut qu'il s'était produit, dans la littérature grecque, toute une floraison de genres nouveaux issus de la comédie, et qui essayaient de la rajeunir. Ce qui en reste (et ce n'est guère) laisse croire qu'au fond ils ne différaient pas beaucoup les uns des autres, et que, par des routes un peu diverses, ils allaient au même but. Les Romains s'étaient sans doute familiarisés avec eux dès la prise de Tarente ; quand leurs relalions devinrent plus fréquentes avec la Grèce, et surtout vers la fin de la République, lorsqu'ils intervinrent directement dans les affaires de l'Egypte, ils eurent l'occasion de les mieux connaître et la pensée d'en profiter. Cicéron semble bien indiquer qu'ils ne manquèrent pas de puiser à ces sources nouvelles quand il dit, en parlant d'Alexandrie, que c'est de là que viennent les sujets des mimes. Il se peut donc que, sous le nom général de mimes, les Romains aient réuni les emprunts faits à des genres différents, et que de là soient venues certaines confusions qui nous surprennent. Dans certains cas, il semble que les mimes soient exécutés par un seul artiste, et dans d'autres par plusieurs, et que tantôt le chant, tantôt la danse y dominent : c'est ce qui sans doute arrivait quelquefois. Sans doute aussi les imitations, qui avaient donné au mime l'occasion de naître et d'où il tirait son nom, n'étaient pas négligées et elles ont dû persister jusqu'à la fin. L'Anthologie contient l'épitaphe du mime Vitalis, qui raconte que son art lui a donné la gloire et la fortune. «J'imitais, dit-il, si parfaitement les traits, les gestes, les paroles des gens, que celui dont je reproduisais l'image était épouvanté de voir que j'étais lui beaucoup plus qu'il ne l'était lui-même». Mais le plus souvent les mimes devaient être de petites scènes de moeurs, amusantes et légères ; par exemple le tableau d'un pauvre diable devenu subitement riche, et qui se livre à toute sorte d'excès, ou celui d'un homme tombé en léthargie, qui, se réveillant tout d'un coup, tombe à coups de poing sur le médecin qui le soigne. Les quelques fragments qui nous restent de ces pièces nous paraissent assez médiocres ; ce sont des naïvetés ou des sottises qui amusaient le public : un niais qui demande du vin aux nymphes ou de l'eau à Bacchus ; un autre qui fait cette réflexion : «L'imbécile ! quand il commençait à être riche, il s'est laissé mourir», ou ce bout de dialogue : «C'est sa femme. - On le voit bien, elle lui ressemble». Cependant Cicéron parle d'un de ces mimes, qui s'appelait Tutor, et qui lui semble tout à fait plaisant, oppide ridiculus.
Il faut remarquer que Cicéron, qui en fait l'éloge, n'en nomme pas l'auteur ; et c'est ce qui arrive aussi pour les autres mimes de cette période primitive. Les ailleurs n'en sont nulle part désignés par leur nom particulier ; on se contente de les appeler d'une manière générale mimographi. C'est que leur travail n'était pas semblable à celui des poètes qui composaient des tragédies ou des comédies. Il est probable qu'ils ne se donnaient pas la peine d'écrire d'un bout à l'autre leurs petites pièces, ou même d'en arrêter toutes les parties et d'en fixer le détail ; ils se bornaient vraisemblablement à en tracer en gros le dessin, à imaginer quelques situations comiques, à mettre aux prises d'une manière un peu nouvelle des personnages que le public connaissait et qu'il aimait à revoir. Suétone raconte qu'un grammairien, qui devint très célèbre, avait commencé par s'occuper des choses du théâtre, et «qu'il aidait les mimographes», ce qui ne se comprendrait guère si les mimographes étaient des écrivains comme Plaute ou Accius, qui en général composent leurs ouvrages tout seuls et y mettent le cachet de leur personnalité. Mais le mime étant une oeuvre un peu indécise et flottante, qui à chaque représentation se renouvelle, au moins dans quelques détails, qu'on raccourcit ou qu'on allonge sans cesse, on comprend que l'auteur ait besoin d'avoir des gens autour de lui qui lui viennent en aide pour ce travail de manoeuvre, qui lui fournissent, quand il en manque, des idées, des bons mots, des jeux de scène. Un passage très curieux de Cicéron nous montre à quel point certaines parties, dans les mimes, étaient abandonnées à l'inspiration du moment, et que si l'inspiration venait à manquer, par exemple à la fin de la pièce (ceux qui ont joué des charades savent bien que le plus difficile est de finir), on avait recours, pour se tirer d'affaire, à des procédés très primitifs. Répondant à une accusation qui lui parait peu solide et mal conduite, Cicéron dit qu'elle n'a ni plan, ni suite (quam est sine argumento)
«Ce n'est pas le dénoûment d'une comédie, mais d'un mime. Là, quand on ne sait comment terminer la pièce, un acteur s'échappe des mains qui le tiennent, se met à courir, les musiciens font du bruit, et la toile se lève».
A l'époque même où Cicéron s'exprimait ainsi, il se produisait dans le mime le même changement qui s'était produit dans l'Atellane quelques années auparavant : on essayait d'en faire un genre littéraire. C'est très probahleulent Laberius qui fut l'auteur de cette innovation, du moins n'en trouve-t-on pas de trace avant lui. Decimus Laberius, qui vivait sous César, était un chevalier romain, homme d'esprit et de lettres, qui voulut élever le mime, malgré ses origines et ses habitudes populaires, à la hauteur de la comédie. Quoiqu'il n'ait peut-être pas tout à fait renoncé au mime improvisé, tel qu'il existait avant lui, puisqu'on nous dit qu'il consentit à lutter de verve et d'invention sur la scène avec P. Syrus, les titres et les fragments qui nous restent de quarante-deux de ses pièces montrent que, par les sujets qu'il traitait de préférence et par sa versification (trimètre ïambique), il cherchait à se rapprocher de la togata et même des palliatae. De son rival, P. Publilius Syrus, nous n'avons que très peu de titres de pièces ; mais nous possédons un recueil de sentences qu'on prétend tirées de ses ouvrages, ce qui n'est pas impossible, car nous savons par Sénèque que les mimes contenaient beaucoup de belles pensées, et qu'on trouve souvent, surtout chez P. Syrus, quand il ne se croit pas obligé de faire rire les gens des derniers gradins, des vers dignes d'être prononcés par des acteurs chaussés du cothurne.
Pour l'époque qui suit, et jusqu'à la fin de l'Empire, nous avons peu de noms d'auteurs de mimes : on en cite trois ou quatre tout au plus, Lentulus, Hostilius, Marullus, dont on ne nous dit que le nom, et Catullus, qui est un peu mieux connu ; c'est bien peu pour un temps aussi long, où les mimes n'ont pas cessé d'être représentés avec succès. Celte absence de noms d'auteurs laisse penser qu'on est alors revenu à la méthode de ces mimographi de l'époque précédente, dont l'oeuvre ne consistait guère qu'en une sorte d'esquisse ou de canevas qu'on modifiait sans cesse, et qui n'avait rien de tout à fait personnel ; ce qui explique qu'on ne se soit plus souvenu du premier auteur.
Les mimes de ce temps n'avaient pas de scrupule à représenter au naturel la vie de famille à Rome. C'était un sujet que la comédie primitive, celle de Plaute et de Térence, n'avait pas osé directement aborder. La togata y mit moins de réserve ; le mime paraît n'avoir gardé à ce sujet aucune retenue : il n'hésita pas à mettre sur la scène ces trois personnages qui ne l'ont plus guère quittée, le mari, la femme et l'amant. On y voyait, nous dit Ovide, la femme et l'amant qui s'entendent pour duper le mari ; l'amant y est élégant et bien vêtu, la femme fort adroite, le mari représenté comme un sot : «et toutes les fois qu'on le trompe avec quelque ruse nouvelle, les applaudissements éclatent». Juvénal fait allusion à une de ces pièces où, le mari survenant mal à propos, au milieu d'un entretien galant, l'amant n'a que le temps de se blottir dans un coffre. Le plus connu de ces mimes, celui qui paraît avoir obtenu le plus long succès, c'est le Laureolus de Catullus. On y représentait un chef de voleurs aux prises avec la justice ; l'intérêt y naissait sans doute de la difficulté de saisir Laureolus, de l'habileté avec laquelle il parvenait à s'échapper dans les situations les plus critiques et sautait même par-dessus la croix au moment où on l'y attachait. Cependant force restait à la loi, et la pièce se terminait, en manière de drame, par le supplice de l'habile voleur. Le Laureolus fut représenté vers la fin du règne de Caligula, et Suétone dit que l'on considéra comme un présage de mort pour ce prince le sang que, dans cette pièce, les acteurs répandaient sur la scène. A l'époque de Domitien, on imagina de le rendre plus attrayant au peuple en substituant, au dernier moment, au comédien chargé du principal rôle, un esclave que l'on crucifiait véritablement.
Le Laureolus se maintint longtemps au théâtre, et Tertullien en parle comme d'une pièce qui se jouait encore de son temps.
Il y avait dans la troupe (grex) que recrutait et dirigeait un archimimus ou une archimima des emplois de différentes classes ; on rencontre la mention de deuxièmes, de troisièmes, de quatrièmes rôles ; dans beaucoup de pièces, comme dans le Laureolus, les acteurs devaient être très nombreux. Ils étaient loués pour une ou plusieurs représentations, ou avaient un engagement perpétuel avec un salaire quotidien : on les appelait alors diurni.
Malgré les éloges que leur accorde Sénèque, les mimes devaient former, en général, un spectacle très grossier. Les acteurs ne s'attaquaient pas seulement de bons mots ; ils y ajoutaient des coups de poing et des coups de pied.
Un des plus importants personnages était une sorte de Jocrisse (stupidus), avec des cheveux ras, dont tout le rôle consistait à recevoir des coups et à répondre des sottises. Lorsque l'archimime Latinus frappait le pauvre Panniculus, le souffre-douleur de la troupe, d'un de ces soufflets qui s'entendaient par tout le théâtre, il s'élevait de partout un de ces rires bruyants qu'on appelait mimicus risus. A son geste, à sa tête rasée, on reconnaîtra un personnage de ce genre dans un petit bronze de la Bibliothèque nationale. Son costume n'est pas celui qui, d'après certains auteurs, serait caractéristique du mime : il ne porte ni le centunculus, vêtement rapiécé peut-être de morceaux de différentes couleurs, comme celui de l'Arlequin de la comédie italienne, ni le manteau carré primitif (ricinium), conservé par tradition.
Le mime était très souvent aussi un spectacle fort obscène. On sait que dans les Floralia, où l'on représentait des mimes, des filles publiques paraissaient sur le théâtre et qu'elles étaient tenues, sur l'ordre des spectateurs, de se dévêtir et de jouer toutes nues. Un jour qu'ils n'osaient pas le demander, parce que Caton était présent, Favonius, son ami, l'en avertit, et Caton sortit du théâtre pour ne pas gêner les plaisirs du peuple. Héliogabale ordonna que, dans les pièces où il était question d'un adultère, tout se passât sous les yeux du public et les renseignements que nous donnent les Pères de l'Eglise montrent qu'il fut ponctuellement obéi. Il n'y a pas de doute que ces grossièretés et ces indécences n'aient beaucoup contribué au succès qu'obtint le mime sous l'Empire auprès de la foule peu distinguée et cosmopolite qui remplissait les théâtres de Rome.On a sans doute un exemple de ce dernier vêtement dans un autre bronze connu dans les collections auxquelles il a appartenu sous le nom de l'Acteur. Ce lourdaud qui saute les pieds nus est un véritable planipes. Il se peut que pour certains rôles le costume fût invariable, comme il l'est pour Arlequin et Polichinelle chez les modernes ; mais d'autres acteurs jouaient avec celui de la vie habituelle, même en toge. C'est un de ceux-là que représente la figure précédente, le stupidus ou le parasitus, qui ne manquait, nous dit-on, presque jamais à côté de l'acteur principal : il était sa doublure comique et faisait rire en copiant ses gestes et en parlant comme lui.
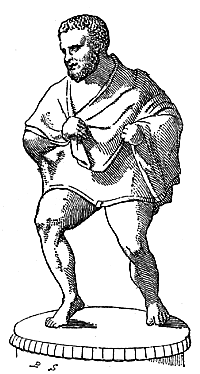
Il lui fut très utile aussi de n'avoir pas confié à des hommes les rôles de femme, comme faisaient la comédie et la tragédie : l'absence de masque rendait chez lui cette substitution très difficile ; il fut donc, pendant longtemps, le seul genre de spectacle où les femmes se produisaient. Quelques-unes d'entre elles y gagnèrent une belle réputation et de grandes fortunes. Il est question, dans Cicéron, d'Arbuscula, dont il dit à son ami Atticus, qui lui en demandait des nouvelles, qu'elle a eu beaucoup de succès, valde placuit. Il est vrai qu'une autre fois elle fut sifflée par la populace ; mais elle ne paraît pas en avoir été fort émue et se contenta de répondre : Il me suffit d'être applaudie par les chevaliers. Celle dont il est le plus souvent question dans les écrivains de ce temps, c'est la belle affranchie du riche Volunmnius, qu'on surnommait Eutrapelus à cause de sa magnificence. Il la faisait assister aux repas qu'il offrait aux plus grands personnages, â côté d'Atticus et de Cicéron. Au théâtre, elle était connue sous le nom de Cythéris. Elle devint la maîtresse d'Antoine, avec lequel elle traversa l'Italie dans une litière découverte, au grand ébahissement des populations, tandis qu'à côté d'elle une autre litière portait la femme légitime d'Antoine, la complaisante Fulvia. Plus tard, Cornelius Gallus en devint très amoureux, mais elle le quitta pour suivre, dit-on, un officier qui parlait pour la Germanie, et c'est pour consoler l'amant délaissé que Virgile composa sa dixième églogue. Ce n'était pas seulement à Rome qu'on voyait les jeunes gens s'éprendre des comédiennes, et, selon le mot d'Horace, leur faire présent des terres et des maisons de leurs aïeux ; il en était de même dans le reste de l'Italie et dans la province. Comme on reprochait à un client de Cicéron d'avoir, dans sa jeunesse un peu légère, enlevé une petite comédienne (mimulam) à Atina, il ne s'en émeut guère : «C'est une vieille habitude, répond-il, et, quand il s'agit de gens de théâtre, c'est presque un droit, dans les petites villes».
Mais ce qui certainement a le plus contribué au succès du mime, c'est qu'il s'occupait des choses actuelles, qu'il touchait aux événements et aux hommes, qu'on y retrouvait un écho des discussions et probablement aussi des scandales du moment. Par làt il fut plus vivant que tous les autres genres de spectacles et, parmi les jeux scéniques, fut à peu près le seul qui conserva jusqu'à la fin la faveur du public. Les Romains avaient pris de grandes précautions pour empêcher le théâtre de s'ingérer dans la politique, comme il l'avait fait en Grèce. Dès le début, pour réprimer ce qu'Horace appelle «la liberté fescennine», ils lui avaient appliqué dans sa rigueur la loi des Douze Tables, qui condamnait à mourir sous le fouet «celui qui aurait composé contre quelqu'un des vers méchants». Cette menace n'empêcha pas que, dès l'époque de Sylla, des auteurs attaquèrent sur la scène Accius et Lucilius : le juge condamna celui qui avait attaqué Accius ; l'autre fut absous, probablement parce que Lucilius était poète satirique et qu'on avait quelque droit de lui rendre ce qu'il faisait aux autres. Quelques années plus tard, Cicéron, plaisantant son ami Trebatius, qui est allé trouver César en Gaule et qui va peut-être le suivre en Bretagne, lui fait craindre que Laberius ne le mette dans une de ses pièces : «Ce serait un bon personnage de mime qu'un jurisconsulte qui exercerait son art chez les Bretons». Après la mort de César, quand Cicéron, inquiet sur les dispositions du peuple, errait autour de Rome, ne sachant pas s'il devait y rentrer ou s'embarquer pour la Grèce, il écrivait à Atticus : «Faites-moi savoir ce qui se dit au théâtre ; rapportez-moi les bons mots des mimes». Ainsi, dans cette crise terrible, les auteurs des mimes osent parler, et les gens sérieux s'informent de ce qu'ils disent pour connaître l'opinion publique. Ils ne sont pas muets non plus pendant l'Empire : sous Marc-Aurèle, ils plaisantent des amants de Faustine ; ils se moquent de la sottise de Maximin ; ils prennent part avec passion dans la lutte contre les chrétiens. Ce n'est pas qu'ils soient très respectueux à l'égard de la religion officielle : comme l'ancienne comédie d'Athènes, ils se moquaient librement d'Hercule toujours affamé, faisaient fouetter sur la scène la chaste Diane et fabriquaient un testament burlesque à Jupiter. Mais le christianisme est l'ennemi des représentations théâtrales et détourne les fidèles d'y assister, et d'ailleurs le mime, qui cherche avant tout le succès, a soin de se mettre toujours du côté des passions populaires. Les actes du martyre de saint Genest peuvent nous donner quelque idée de ce qu'étaient ces pièces composées contre les chrétiens. Ils contiennent une analyse de celle que jouait l'acteur Genest quand il fut touché de la grâce et se convertit. Ces indécentes parodies des rites de la religion nouvelle, ces railleries cruelles du martyre égayées de plates bouffonneries, nous montrent à quel degré le mime était tombé à l'époque de Dioclétien. Il n'y avait plus chez lui, dit Lydus, aucun vestige d'art, technikon echousa ouden, et il ne se souciait plus que de faire rire la foule. C'est sous cette forme grossière qu'il conserva sa popularité jusqu'à la fin de l'Empire.
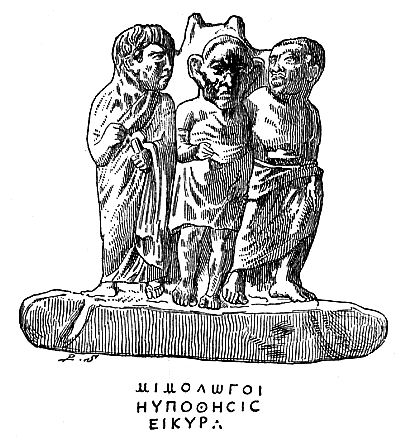 |
La découverte d'un relief d'argile en forme de lampe, où sont représentés trois personnages comiques, confirme, selon M. Crusius, ce qu'il était seulement permis de présumer. Ce relief porte l'inscription suivante : MIMOLOGOI HYPOTHESIS EIKYRA. Ces mots, d'une orthographe incorrecte, nous apprennent donc que les trois personnages du relief étaient des acteurs de mimes en prose (mimologoi), qui figuraient dans une upothesis ayant pour titre Ekura. D'après Watzinger, nous avons là trois types bien connus : l'esclave, le père et le fils. D'autre part, un passage de Plutarque nous renseigne sur le genre de pièces dont il est ici question : les mimes, dit-il, comprennent deux catégories : les upotheseis et paignia. Ces derniers sont pleins de grossières bouffonneries ; les upotheseis ont une action dramatique plus étendue, et leur mise en scène est assez compliquée pour qu'il soit difficile de les jouer dans un banquet. Etait-il question, dans ce passage, d'une époque récente ou relativement ancienne, c'est ce qu'on ignorait avant la découverte de notre groupe. Mais Walzinger pense qu'il faut le dater, au plus tard, de la fin du IIIe siècle av. J.-C. ; il est donc à peu près contemporain d'Hérondas, et nous voyons qu'à cette époque des mimes étaient représentés.
Malgré l'intérêt que présente le relief des trois mimologoi, on ne peut prétendre que sa découverte nous apporte une certitude en ce qui regarde les Mimiambes d'Hérondas. Dans quelle catégorie doit-on ranger ces saynètes ? Reitzenstein en fait des paignia : il paraît plus juste de les rapporter à la catégorie des upotheseis, mais encore faut-il prendre ce terme dans le sens très général d'action comique, et supposer que ces pièces, autrefois d'assez courte haleine, prirent, à l'époque impériale, trop d'étendue pour être jouées chez des particuliers, dans des festins. Car c'était là surtout la destination des Mimiambes, selon M. Crusius, et l'on s'expliquerait ainsi, d'après lui, qu'ils comportent un appareil scénique généralement simple, et qu'ils aient pour lieu de scène un endroit clos. Mais cette opinion demeure toujours à l'état d'hypothèse.
S'il ne résout pas la question de l'exécution des Mimiambes, le relief décrit par Watzinger nous est un précieux document pour l'histoire du mime grec. Les personnages qu'il représente n'ont pas de masque, ce qui paraît être une règle générale dans le mime. L'esclave est sans barbe, ventru, chauve, ses oreilles sont démesurées ; il est vêtu d'un chiton court, serré sous la poitrine ; le personnage de droite (le père), également chauve et sans barbe, porte un manteau qui couvre l'épaule gauche et le bas du corps ; à gauche, le jeune homme, dont les cheveux forment des mèches séparées, est vêtu d'un chiton et d'un manteau : il tient dans la main gauche un rouleau. L'expression de ces trois personnages est typique : la lippe de l'esclave est maussade et inquiète ; le père a l'air irrité ; la physionomie du fils exprime l'intérêt et l'attente. La figure du père rappelle les traits des masques comiques ; l'esclave ressemble aux grotesques de l'époque Alexandrine, distincts des acteurs comiques [Histrio].
Crâne chauve, lippe grimaçante, nez crochu, petits yeux allongés, oreilles énormes et pareilles à deux anses, tous ces traits caractéristiques sont communs à notre personnage et à ces grotesques. On en peut conclure avec vraisemblance que plus d'une figurine de cette classe doit nous représenter assez exactement des personnages de mimes. Nous y voyons, en effet, des hommes et des femmes du peuple, des bateleurs, des esclaves, des paysans, des marchands et des soldats. Le relief des trois mimologues nous montre d'autre part l'influence de la comédie nouvelle sur le mime : les intrigues où figurent les trois personnages-types de la comédie de Diphile, d'Apollodore, de Philémon et de Ménandre étaient réduites aux proportions d'une upothesis, ce qui justifie bien l'observation de Plutarque rappelée précédemment. |  |
A côté des mimes en prose dont les acteurs portent le nom de mimologoi, logomimoi, êthologoi, biologoi, nous trouvons mentionnées diverses formes de mimes lyriques que jouaient et chantaient les mimôdoi, mimauloi, ilarôdoi, magôdoi, lusiôdoi, simôdoi. Athénée nous parle de deux célèbres acteurs-mimes, qui faisaient des imitations de citharèdes et de chanteurs de dithyrambes. Ce qu'étaient les parodies de ce dernier genre nous est très bien représenté par les vers grotesquement emphatiques et vides du poète dithyrambique Cinésias, chez Aristophane. Quant à l'origine du plus grand nombre de ces mimes, on peut la chercher, avec Reich, dans la musique et les chants dont les thaumatopoioi accompagnaient leurs parades et leurs tours d'adresse : Théophraste nous parle du vieux sot qui reste chez les bateleurs pendant trois représentations consécutives «pour apprendre les airs qu'on y chante». Hiller attribue notamment cette origine à la magodie : les magodes seraient d'anciens bateleurs n'ayant gardé de leurs «productions» que les danses et les chants obscènes. D'une manière analogue, les kinaidoi, qui sont primitivement des danseurs et des pantomimes, accompagnent plus tard leurs danses de chansons lascives. Strabon mentionne d'ailleurs comme kinaidologoi, avec Sotadès et Alexandre l'Etolien (dont les vers sont simplement récités), deux auteurs de mimes chantés, Simos et Lysis.
Sur les genres que représentent ces deux derniers poètes, Athénée nous renseigne en plusieurs passages, dont le texte, malheureusement, est gâté ou ne nous éclaircit qu'à demi. Nous y voyons que l'hilarodie avait un caractère sérieux et se rapprochait en quelque façon de la tragédie : la magodie se rattachait au genre comique, et il arriva souvent que les magodes empruntèrent des arguments de comédie pour les accommoder à leur genre particulier. L'hilarode portait un vêtement d'homme, de couleur blanche, des krêpides (il avait anciennement des upodêmata) et une couronne d'or ; un joueur (ou une joueuse) d'instrument à cordes l'accompagnait ; il ne dansait point de danse efféminée. Le magode portait le costume féminin et tenait des tambourins et des cymbales ; ses danses étaient désordonnées : il représentait tantôt une femme débauchée, tantôt un homme ivre qui rejoint sa belle dans une partie joyeuse. Le nom de magodie, d'après Athénée, rappellerait l'art magique. Crusius l'explique par l'instrument appelé magadis (harpe ou flûte), dont il est disserté chez Athénée, et dérive le mot de mag[ad]ôdos.
Hilarodes et simodes sont identifiés par Aristoclès : Simos de Magnésie aurait été, en effet, le plus célèbre des auteurs d'hilarodies. Il faut donc penser que Strabon donnait une extension singulière au mot kinaidologein, ou ne faisait pas une distinction suffisante entre le genre de Simos et celui de Lysis. Aristoclès identifie également les magodes et les lysiodes, mais si les poèmes que chantaient ces deux sortes de mimes étaient pareils, nous voyons qu'Aristoclès ne tient pas compte d'une différence faite par Aristoxène entre les magôdoi et les lusiôdoi. Cette différence paraît avoir été dans le costume ; le texte de la définition d'Aristoxène est malheuseusement altéré : ce qui paraît en ressortir, c'est que des mimes constamment vêtus en hommes pouvaient chanter des rôles de femmes, et inversement. A l'époque d'Aristocles, les magodes et les lysiodes, chantant les mêmes poèmes et ne se distinguant plus par le costume, se confondirent naturellement. Si tous parurent en femmes, ce fut sans doute pour que leur costume répondit mieux au caractère de leurs chants et de leurs danses.
L'Alexandrian erotic fragment (plainte d'une amante délaissée) publié par M. B. Grenfell sans doute du IIe siècle av. J.-C., est tenu avec raison par Crusius et Wilamowitz pour une hilarodie. Au même genre doit être rattachée la singulière lamentation sur la mort d'un coq de combat, publiée par Grenfell et Hunt La découverte de ces poèmes avait ressuscité pour nous le genre de l'hilarodie : un ostrakon rapporté d'Egypte par M. Th. Reinach nous fait connaître, selon toute vraisemblance, un fragment de magodie : quatorze lignes mutilées d'un dialogue entre un buveur amoureux et un ami qui cherche à le calmer.
Ces mimes lyriques, mieux connus, jettent un jour nouveau sur deux questions importantes : l'origine des Cantica de la comédie romaine [Comoedia, Canticum], et les rapports du mime romain avec le mime grec. Pour les Cantica, la comédie de Ménandre et de Philémon ne fournissait aucun modèle à Plaute et à Térence, et, même en admettant une imitation de la comédie ancienne, les parties lyriques des pièces de Plaute restaient insuffisamment expliquées. Ces mimes de l'époque hellénistique nous donnent précisément l'intermédiaire qui nous manquait. Il faut aussi tenir compte de la collaboration du musicien, dont la melographia et la ruthmographia provenaient certainement d'une source alexandrine, et dont la technique devait exercer une certaine influence sur la composition même du texte. Les mimes lyriques des Simos et des Lysis étaient d'autant plus propres à servir de modèles aux comiques latins qu'ils y trouvaient avec une intéressante éthopée, des rythmes variés, et un style qui faisait un mélange assez ambigu de réalisme et de poésie. Nous nous représentons aussi de façon moins vague ce qu'étaient ces mimes romains chantés et dansés de l'époque antérieure à Labérius. Les relations de Rome avec l'Egypte et avec Tarente, la ville des Phlyaques (prise en 272), nous expliquent les origines grecques du mime romain.
G. Dalmeyda
Article de Gaston Boissier