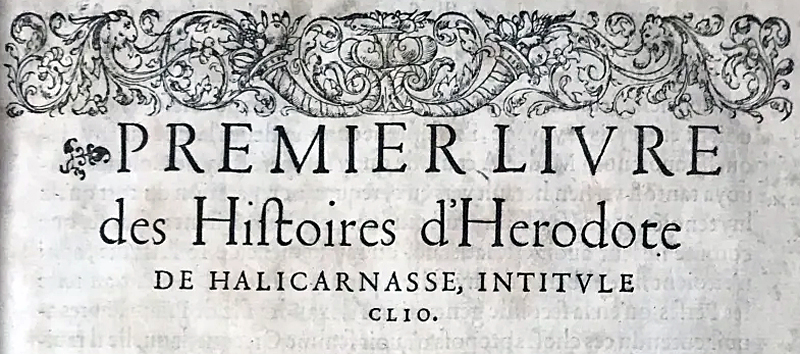
Traduction en français de Pierre Saliat - Les neuf livres des histoires de Hérodote - Paris, Estienne Groulleau, 1556
En présentant au public ces recherches, Hérodote d'Halicarnasse se propose de préserver de l'oubli les actions des hommes, de célébrer les grandes et merveilleuses actions des Grecs et des Barbares, et, indépendamment de toutes ces choses, de développer les motifs qui les portèrent à se faire la guerre.
I. Les Perses les plus savants dans l'histoire de leur pays attribuent aux Phéniciens la cause de cette inimitié. Ils disent que ceux-ci étant venus des bords de la mer Erythrée sur les côtes de la nôtre, ils entreprirent de longs voyages sur mer, aussitôt après s'être établis dans le pays qu'ils habitent encore aujourd'hui, et qu'ils transportèrent des marchandises d'Egypte et d'Assyrie en diverses contrées, entre autres à Argos. Cette ville surpassait alors toutes celles du pays connu actuellement sous le nom de Grèce. Ils ajoutent que les Phéniciens y étant abordés se mirent à vendre leurs marchandises ; que cinq ou six jours après leur arrivée la vente étant presque finie, un grand nombre de femmes se rendit sur le rivage, et parmi elles la fille du roi ; que cette princesse, fille d'Inachus, s'appelait Io, nom que lui donnent aussi les Grecs. Tandis que ces femmes, continuent les mêmes historiens, achetaient près de la poupe ce qui était le plus de leur goût, les Phéniciens, s'animant les uns les autres, se jetèrent sur elles. La plupart prirent la fuite ; mais Io fut enlevée, et d'autres femmes avec elle. Les Phéniciens, les ayant fait embarquer, mirent à la voile, et firent route vers l'Egypte.
II. Voilà, selon les Perses, en cela peu d'accord avec les Phéniciens, comment Io passa en Egypte : voilà le principe des injustices réciproques qui éclatèrent entre eux et les Grecs. Ils ajoutent qu'ensuite quelques Grecs (ils ne peuvent les nommer, c'étaient peut-être des Crétois) abordés à Tyr en Phénicie enlevèrent Europe, fille du roi : c'était sans doute user du droit de représailles ; mais la seconde injustice ne doit, selon les mêmes historiens, être imputée qu'aux Grecs. Ils disent que ceux-ci se rendirent sur un vaisseau long à Aea, en Colchide, sur le Phase, et qu'après avoir terminé les affaires qui leur avaient fait entreprendre ce voyage, ils enlevèrent Médée, fille du roi ; que ce prince ayant envoyé un ambassadeur en Grèce pour redemander sa fille et exiger réparation de cette injure, les Grecs lui répondirent que puisque les Colchidiens n'avaient donné aucune satisfaction de l'enlèvement d'Io, ils ne lui en feraient point de celui de Médée.
III. Les mêmes historiens disent aussi que, la seconde génération après ce rapt, Alexandre (Pâris), fils de Priam, qui en avait entendu parler, voulut par ce même moyen se procurer une femme grecque, bien persuadé que les autres n'ayant point été punis, il ne le serait pas non plus. Il enleva donc Hélène ; mais les Grecs, continuent-ils, s'étant assemblés, furent d'avis d'envoyer d'abord des ambassadeurs pour demander cette princesse, et une réparation de cette insulte. A cette proposition les Troyens opposèrent aux Grecs l'enlèvement de Médée, leur reprocbèrent d'exiger une satisfaction, quoiqu'ils n'en eussent fait aucune, et qu'ils n'eussent point rendu cette princesse après en avoir été sommés.
IV. Jusque-là, disent les Perses, il n'y avait eu de part et d'autre que des enlèvements ; mais depuis cette époque les Grecs se mirent tout à fait dans leur tort, en portant la guerre en Asie avant que les Asiatiques l'eussent déclarée à l'Europe. Or, s'il y a de l'injustice, ajoutent-ils, à enlever des femmes, il y a de la folie à se venger d'un rapt, et de la sagesse à ne s'en pas mettre en peine, puisqu'il est évident que, sans leur consentement, on ne les eût pas enlevées. Les Perses assurent que, quoiqu'ils soient Asiatiques, ils n'ont tenu aucun compte des femmes enlevées dans cette partie du monde ; tandis que les Grecs, pour une femme de Lacédémone, équipèrent une flolte nombreuse, passèrent en Asie, et renversèrent le royaume de Priam. Depuis cette époque, les Perses ont toujours regardé les Grecs comme leurs ennemis ; car ils s'arrogent l'empire sur l'Asie et sur les nations barbares qui l'habitent, et considèrent l'Europe et la Grèce comme un continent à part.
V. Telle est la manière dont les Perses rapportent ces événements, et c'est à la prise d'Ilion qu'ils attribuent la cause de la haine qu'ils portent aux Grecs. A l'égard d'Io, les Phéniciens ne sont pas d'accord avec les Perses. Ils disent que ce ne fut pas par un enlèvement qu'ils la menèrent en Egypte : qu'ayant eu commerce à Argos avec le capitaine du navire, quand elle se vit grosse, la crainte de ses parents la détermina à s'embarquer avec les Phéniciens, pour cacher son déshonneur. Tels sont les récits des Perses et des Phéniciens. Pour moi, je ne prétends point décider si les choses se sont passées de cette manière ou d'une autre ; mais, après avoir indiqué celui que je connais pour le premier auteur des injures faites aux Grecs, je poursuivrai mon récit, qui embrassera les petits Etats comme les grands : car ceux qui florissaient autrefois sont la plupart réduits à rien, et ceux qui fleurissent de nos jours étaient jadis peu de chose. Persuadé de l'instabilité du bonheur des hommes, je me suis déterminé à parler également des uns et des autres.
VI. Crésus était Lydien de naissance, fils d'Alyattes, et tyran des nations que renferme l'Halys dans son cours. Ce fleuve coule du sud, passe entre le pays des Syriens (Cappadociens) et celui des Paphlagoniens, et se jette au nord dans le Pont-Euxin. Ce prince est le premier Barbare, que je sache, qui ait forcé une partie des Grecs à lui payer tribut, et qui se soit allié avec l'autre. Il subjugua en effet les Ioniens, les Eoliens et les Doriens établis en Asie, et fit alliance avec les Lacédémoniens. Avant son règne, tous les Grecs étaient libres ; car l'expédition des Cimmériens contre l'Ionie, antérieure à Crésus, n'alla pas jusqu'à ruiner des villes : ce ne fut qu'une incursion, suivie de pillage.
VII. Voici comment la souveraine puissance, qui appartenait aux Héraclides, passa en la maison des Mermnades, dont était Crésus. Candaule, que les Grecs appellent Myrsile, fut tyran de Sardes. Il descendait d'Hercule par Alcée, fils de ce héros ; car Agron, fils de Ninus, petit-fils de Bélus, arrière-petit-fils d'Alcée, fut le premier des Héraclides qui régna à Sardes ; et Candaule, fils de Myrsus, fut le dernier. Les rois de ce pays antérieurs à Agron descendaient de Lydus, fils d'Atys, qui donna la nom de Lydiens à tous les peuples de cette contrée, qu'on appelait auparavant Méoniens. Enfin les Héraclides, à qui ces princes avaient confié l'administration du gouvernement, et qui tiraient leur origine d'Hercule et d'une esclave de Jardanus, obtinrent la royauté en vertu d'un oracle. Ils régnèrent de père en fils cinq cent cinq ans, en quinze générations, jusqu'à Candaule, fils de Myrsus.
VIII. Ce prince aimait éperdument sa femme, et la regardait comme la plus belle des femmes. Obsédé par sa passion, il ne cessait d'en exagérer la beauté à Gygès, fils de Dascylus, un de ses gardes, qu'il aimait beaucoup, et à qui il communiquait ses affaires les plus importantes. Peu de temps après, Candaule (il ne pouvait éviter son malheur) tint à Gygès ce discours : «Il me semble que tu ne m'en crois pas sur la beauté de ma femme. Les oreilles sont moins crédules que les yeux : fais donc ton possible pour la voir nue. - Quel langage insensé, seigneur ! s'écria Gygès. Y avez-vous réfléchi ? Ordonner à un esclave de voir nue sa souveraine ! Oubliez-vous qu'une femme dépose sa pudeur avec ses vêtements ? Les maximes de l'honnêteté sont connues depuis longtemps : elles doivent nous servir de règle. Or une des plus importantes est que chacun ne doit garder que ce qui lui appartient. Je suis persuadé que vous avez la plus belle de toutes les femmes ; mais n'exigez pas de moi, je vous en conjure, une chose malhonnête».
IX. Ainsi Gygès se refusait à la proposition du roi, en craignant les suites pour lui-même. «Rassure-toi, Gygès, lui dit Candaule ; ne crains ni ton roi (ce discours n'est point un piège pour réprouver) ni la reine : elle ne te fera aucun mal. Je m'y prendrai de manière qu'elle ne saura pas même que tu l'aies vue. Je te placerai dans la chambre où nous couchons, derrière la porte, qui restera ouverte : la reine ne tardera pas à me suivre. A l'entrée est un siège où elle pose ses vêtements, à mesure qu'elle s'en dépouille. Ainsi, tu auras tout le loisir de la considérer. Lorsque de ce siège elle s'avancera vers le lit, comme elle le tournera le dos, saisis ce moment pour l'esquiver sans qu'elle le voie».
X. Gygès ne pouvait plus se refuser aux instances de roi : il se tint prêt à obéir. Candaule, à l'heure du coucher, le mena dans sa chambre, où la reine ne tarda pas à se rendre. Gygès la regarda se déshabiller, et, tandis qu'elle tournait le dos pour gagner le lit, il se glissa hors de l'appartement ; mais la reine l'aperçut en sortant. Elle ne douta point que son mari ne fût l'auteur de cet outrage : la pudeur l'empêcha décrier, et même elle fit semblant de ne l'avoir pas remarqué, ayant déjà conçu dans le fond du coeur le désir de se venger de Candaule : car chez les Lydiens, comme chez presque tout le reste des nations barbares, c'est un opprobre, même à un homme, de paraître nu.
XI. La reine demeura donc tranquille, et sans rien découvrir de ce qui se passait dans son âme. Mais, dès que le jour parut, elle s'assure des dispositions de ses plus fidèles officiers, et mande Gygès. Bien éloigné de la croire instruite, il se rend à son ordre, comme il était dans l'habitude de le faire toutes les fois qu'elle le mandait. Lorsqu'il fut arrivé, cette princesse lui dit : «Gygès, voici deux routes dont je te laisse le choix ; décide-toi sur-le-champ. Obtiens par le meurtre de Candaule ma main et le trône de Lydie, ou une prompte mort t'empêchera désormais de voir, par une aveugle déférence pour Candaule, ce qui t'est interdit. Il faut que l'un des deux périsse, ou toi qui, bravant l'honnêteté, m'as vue sans vêtements, ou du moins celui qui t'a donné ce conseil». A ce discours, Gygès demeura quelque temps interdit ; puis il conjura la reine de ne le point réduire à la nécessité d'un tel choix. Voyant qu'il ne pouvait la persuader, et qu'il fallait absolument ou tuer son maître ou se résoudre lui-même à périr, il préféra sa propre conservation. «Puisque, malgré mes réclamations, dit-il à la reine, vous me forcez à tuer mon maître, je suis prêt à prendre les moyens d'y réussir. - Le lieu de l'embuscade, répondit-elle, sera celui-1à même d'où il m'a exposée nue à les regards, et le temps de l'attaque celui de son sommeil».
XII. Ces mesures prises, elle retint Gygès : nul moyen pour lui de s'échapper. Il fallait qu'il pérît, lui ou Candaule. A l'entrée de la nuit elle l'introduit dans la chambre, l'arme d'un poignard, et le cache derrière la porte : à peine Candaule était endormi, Gygès avance sans bruit, le poignarde, s'empare de son épouse et de son trône. Archiloque de Paros, qui vivait en ce temps-là, fait mention de ce prince dans une pièce qu'il a composée en vers iambes trimètres.
XIII. Gygès étant monté de la sorte sur le trône, il y fut affermi par l'oracle de Delphes. Les Lydiens, indignés de la mort de Candaule, avaient pris les armes ; mais ils convinrent avec les partisans de Gygès que, si l'oracle le reconnaissait pour roi de Lydie, la couronne lui resterait ; qu'autrement elle retournerait aux Héraclides. L'oracle prononça, et le trône fut, par ce moyen, assuré à Gygès. Mais la Pythie ajouta que les Héraclides seraient vengés sur le cinquième descendant de ce prince. Ni les Lydiens ni leurs rois ne tinrent aucun compte de cette réponse avant qu'elle eût été justifiée par l'événement. Ce fut ainsi que les Mermnades s'emparèrent de la couronne, et qu'ils l'enlevèrent aux Héraclides.
XIV. Gygès, maître de la Lydie, envoya beaucoup d'offrandes à Delphes, dont une très grande partie était en argent ; il y ajouta quantité de vases d'or, et entre autres six cratères d'or du poids de trente talents, présent dont la mémoire mérite surtout d'être conservée. Ces offrandes sont dans le trésor des Corinthiens, quoique, à dire vrai, ce trésor ne soit point à la république de Corinthe, mais à Cypsélus, fils d'Eétion. Gygès est, après Midas, fils de Gordius, roi de Phrygie, le premier des Barbares que nous connaissions qui ait envoyé des offrandes à Delphes. Midas avait fait présent à ce temple du trône sur lequel il avait coutume de rendre la justice : cet ouvrage mérite d'être vu ; il est placé dans le même endroit où sont les cratères de Gygès. Au reste, les habitants de Delphes appellent ces offrandes en or et en argent gygadas, du nom de celui qui les a faites. Lorsque ce prince se vit maître du royaume, il entreprit une expédition contre les villes de Milet et de Smyrne, et prit celle de Colophon. Mais comme il ne fit rien autre chose de mémorable pendant un règne de trente-huit ans, nous nous contenterons d'avoir rapporté ces faits, et n'en parlerons pas davantage.
XV. Passons à son fils Ardys. Ce prince lui succéda ; il subjugua ceux de Priène, et entra avec une armée dans le territoire de Milet. Sous son règne, les Cimmériens, chassés de leur pays par les Scythes nomades, vinrent en Asie, et prirent Sardes, excepté la citadelle.
XVI. Ardys régna quarante-neuf ans, et eut pour successeur Sadyattes son fils, qui en régna douze. Alyattes succéda à Sadyattes. Il fit la guerre aux Mèdes et à Cyaxare, petit-fils de Déjocès. Ce fut lui qui chassa les Cimmériens de l'Asie. Il prit la ville de Smyrne, colonie de Colophon. Il entreprit aussi une expédition contre Clazomènes, de devant laquelle il se retira, non comme il le voulut, mais après avoir reçu un échec considérable. Il fit encore durant son règne d'autres actions, dont je vais rapporter les plus mémorables.
XVII. Son père lui ayant laissé la guerre contre les Milésiens, il la continua, et attaqua Milet de la manière que je vais dire. Lorsque, la terre était couverte de grains et de fruits, il se mettait en campagne. Son armée marchait au son du chalumeau, de la harpe, et des flûtes masculines et féminines. Quand il était arrivé sur les terres des Milésiens, il défendait d'abattre les métairies, d'y mettre le feu et d'en arracher les portes ; il les laissait subsister dans l'état où elles étaient : mais il faisait le dégât dans le pays, coupait les arbres, ravageait les blés ; après quoi il s'en retournait sans assiéger la place ; entreprise qui lui eût été inutile, les Milésiens étant maîtres de la mer. Quant aux maisons, Alyattes ne les faisait pas abattre, afin que les Milésiens, ayant toujours où se loger, continuassent à ensemencer et à cultiver leurs terres, et qu'il eût de quoi piller et ravager lorsqu'il reviendrait dans leur pays.
XVIII. Il leur fit de cette manière onze ans la guerre, pendant lesquels les Milésiens essuyèrent deux échecs considérables : l'un à la bataille qu'ils donnèrent dans leur pays, en un endroit appelé Liménéion ; l'autre, dans la plaine du Méandre. Des onze années qu'elle dura, les six premières appartiennent au règne de Sadyattes, fils d'Ardys, qui dans ce temps-là régnait encore en Lydie. Ce fut lui qui l'alluma, et qui entra alors, à la tête d'une armée, dans le pays de Milet. Alyattes poussa avec vigueur, les cinq années suivantes, la guerre que son père lui avait laissée, comme on l'a rapporté un peu plus haut. De tous les Ioniens, il n'y eut que ceux de Chios qui secoururent les habitants de Milet. Ils leur envoyèrent des troupes, en reconnaissance des secours qu'ils en avaient reçus dans la guerre qu'ils avaient eu à soutenir contre les Erythréens.
XIX. Enfin, la douzième année, l'armée d'Alyattes ayant mis le feu aux blés, il arriva que la flamme, poussée par un vent violent, se communiqua au temple de Minerve surnommée Assésienne, et le réduisit en cendres. On ne fit d'abord aucune attention à cet accident ; mais Alyattes, de retour à Sardes avec son armée, étant tombé malade, et sa maladie traînant en longueur, il envoya à Delphes des députés pour consulter le dieu sur sa maladie, soit qu'il eût pris cette résolution de lui-même, soit qu'elle lui eût été suggérée. Ses envoyés étant arrivés à Delphes, la Pythie leur dit qu'elle ne leur rendrait point de réponse qu'ils n'eussent relevé le temple de Minerve qu'ils avaient brûlé à Assésos, dans le pays des Milésiens.
XX. J'ai ouï dire aux habitants de Delphes que la chose s'était passée de la sorte. Mais les Milésiens ajoutent que Périandre, fils de Cypsélus, intime ami de Thrasybule, tyran de Milet, sur la nouvelle de l'oracle rendu à Alyattes, envoya un courrier à Thrasybule, afin qu'instruit d'avance de la réponse du dieu, il prît des mesures relatives aux conjonctures.
XXI. Alyattes n'eut pas plutôt reçu cet oracle, qu'il envoya un héraut à Milet pour conclure une trêve avec Thrasybule et les Milésiens, jusqu'à ce qu'on eût rebâti le temple. Pendant que le héraut était en chemin pour se rendre à Milet, Thrasybule, bien informé de tout, et qui n'ignorait point les desseins d'Alyattes, s'avisa de cette ruse : tout le blé qu'on put trouver à Milet, tant dans ses greniers que dans ceux des particuliers, il le fit apporter sur la place publique. Il commanda ensuite aux Milésiens de se livrer aux plaisirs de la table au signal qu'il leur donnerait.
XXII. Thrasybule publia ces ordres, afin que le héraut, voyant un si grand amas de blé, et que les habitants ne songeaient qu'à leurs plaisirs, en rendît compte à Alyattes ; ce qui ne manqua pas d'arriver. Le héraut, témoin de l'abondance qui régnait à Milet, s'en retourna à Sardes aussitôt qu'il eut communiqué à Thrasybule les ordres qu'il avait reçus du roi de Lydie ; et ce fut là, comme je l'ai appris, la seule cause qui rétablit la paix entre ces deux princes. Alyattes s'était persuadé que la disette était très grande à Milet, et que le peuple était réduit à la dernière extrémité. I1 fut bien surpris, au retour du héraut, d'apprendre le contraire. Quelque temps après, ces deux princes firent ensemble un traité, dont les conditions furent qu'ils vivraient comme amis et alliés. Au lieu d'un temple, Alyattes en fit bâtir deux à Minerve dans Assésos, et il recouvra la santé. C'est ainsi que les choses se passèrent dans la guerre qu'Alyattes fit à Thrasybule et aux Milésiens.
XXIII. Ce Périandre, qui donna avis à Thrasybule de la réponse de l'oracle, était fils de Cypsélus ; il régnait à Corinthe. Les habitants de cette ville racontent qu'il arriva de son temps une aventure très merveilleuse dont il fut témoin, et les Lesbiens en conviennent aussi. Ils disent qu'Arion de Méthymne, le plus habile joueur de cithare qui fût alors, et le premier, que je sache, qui ait fait et nommé le dithyrambe, et l'ait exécuté à Corinthe, fut porté sur le dos d'un dauphin jusqu'au promontoire de Ténare.
XXIV. Ils assurent qu'Arion, ayant passé un temps considérable à la cour de Périandre, eut envie de naviguer en Sicile et en Italie. Ayant amassé dans ces pays de grands biens, il voulut retourner à Corinthe. Prêt à partir de Tarente, il loua un vaisseau corinthien, parce qu'il se fiait plus à ce peuple qu'à tout autre. Lorsqu'il fut sur le vaisseau, les Corinthiens tramèrent sa perte, et résolurent de le jeter à la mer pour s'emparer de ses richesses. Arion, s'étant aperçu de leur dessein, les leur offrit, les conjurant de lui laisser la vie. Mais, bien loin d'être touchés de ses prières, ils lui ordonnèrent de se tuer lui-même s'il voulait être enterré, ou de se jeter sur-le-champ dans la mer. Arion, réduit à une si fâcheuse extrémité, les supplia, puisqu'ils avaient résolu sa perte, de lui permettre de se revêtir de ses plus beaux habits et de chanter sur le tillac, et leur promit de se tuer après qu'il aurait chanté. Ils présumèrent qu'ils auraient du plaisir à entendre le plus habile musicien qui existât, et dès lors ils se retirèrent de la poupe au milieu du vaisseau. Arion se para de ses plus riches habits, prit sa cithare et monta sur le tillac, exécuta l'air orthien ; et dès qu'il l'eut fini, il se jeta à la mer avec ses habits, et dans l'état où il se trouvait. Pendant que le vaisseau partait pour Corinthe, un dauphin reçut, à ce qu'on dit, Arion sur son dos, et le porta à Ténare, où ayant mis pied à terre, il s'en alla à Corinthe vêtu comme il était et y raconta son aventure. Périandre, ne pouvant ajouter foi à son récit, le fit étroitement garder, et porta son attention sur les matelots. Ils ne furent pas plutôt arrivés, que, les ayant envoyé chercher, il leur demanda s'ils pouvaient lui donner des nouvelles d'Arion. Ils lui répondirent qu'ils l'avaient laissé en bonne santé à Tarente, en Italie, où la fortune lui était favorable. Arion parut tout à coup devant eux, tel qu'ils l'avaient vu se précipiter à la mer. Déconcertés, convaincus, ils n'osèrent plus nier leur crime. Les Corinthiens et les Lesbiens racontent cette histoire de la sorte, et l'on voit à Ténare une petite statue de bronze qui représente un homme sur un dauphin : c'est une offrande d'Arion.
XXV. Alyattes, roi de Lydie, mourut longtemps après avoir terminé la guerre de Milet. Il régna cinquante-sept ans. Il fut le second prince de la maison des Mermnades qui envoya des présents à Delphes : c'était en action de grâces du recouvrement de sa santé. Ils consistaient en un grand cratère d'argent et une soucoupe damasquinée, la plus précieuse de toutes les offrandes qui se voient à Delphes. C'est un ouvrage de Glaucus de Chios, qui seul a inventé l'art de la damasquinure.
XXVI. Alyattes étant mort, Crésus son fils lui succéda à l'âge de trente-cinq ans. Ephèse fut la première ville grecque que ce prince attaqua. Ses habitants, se voyant assiégés, consacrèrent leur ville à Diane, en joignant avec une corde leurs murailles au temple de la déesse. Ce temple est éloigné de sept stades de la vieille ville, dont Crésus formait alors le siège. Après avoir fait la guerre aux Ephésiens, il la fit aux Ioniens et aux Eoliens, mais successivement, employant des raisons légitimes quand il en pouvait trouver, ou des prétextes frivoles à défaut de raisons.
XXVII. Lorsqu'il eut subjugué les Grecs de l'Asie, et qu'il les eut forcés à lui payer tribut, il pensa à équiper une flotte pour attaquer les Grecs insulaires. Tout était prêt pour la construction des vaisseaux, lorsque Bias de Priène, ou, selon d'autres, Pittacus de Mitylène, vint à Sardes. Crésus lui ayant demandé s'il y avait en Grèce quelque chose de nouveau, sa réponse fit cesser les préparatifs. «Prince, lui dit-il, les insulaires achètent une grande quantité de chevaux, dans le dessein de venir attaquer Sardes et de vous faire la guerre». Crésus, croyant qu'il disait la vérité, repartit : «Puissent les dieux inspirer aux insulaires le dessein de venir attaquer les Lydiens avec de la cavalerie ! - Il me semble, seigneur, répliqua Bias, que vous désirez ardemment de les rencontrer à cheval dans le continent, et vos espérances sont fondées ; mais, depuis qu'ils ont appris que vous faisiez équiper une flotte pour les attaquer, pensez-vous qu'ils souhaitent autre chose que de surprendre les Lydiens en mer, et de venger sur vous les Grecs du continent que vous avez réduits en esclavage ?» Crésus, charmé de cette réponse, qui lui parut très juste, abandonna son projet, et fit alliance avec les Ioniens des îles.
XXVIII. Quelque temps après, Crésus subjugua presque toutes les nations en deçà du fleuve Halys, excepté les Ciliciens et les Lyciens, savoir : les Phrygiens, les Mysiens, les Mariandyniens, les Chalybes, les Paphlagoniens, les Thraces de l'Asie, c'est-à-dire les Thyniens et les Bithyniens, les Cariens, les Ioniens, les Doriens, les Eoliens et les Pamphyliens.
XXIX. Tant de conquêtes ajoutées au royaume de Lydie avaient rendu la ville de Sardes très florissante. Tous les sages qui étaient alors en Grèce s'y rendirent, chacun en son particulier. On y vit entre autres arriver Solon. Ce philosophe ayant fait, à la prière des Athéniens ses compatriotes, un corps de lois, voyagea pendant dix ans. Il s'embarqua sous prétexte d'examiner les moeurs et les usages des différentes nations, mais en effet pour n'être point contraint d'abroger quelqu'une des lois qu'il avait établies ; car les Athéniens n'en avaient pas le pouvoir, s'étant engagés par des serments solennels à observer pendant dix ans les règlements qu'il leur donnerait.
XXX. Solon étant donc sorti d'Athènes par ce motif, et pour s'instruire des coutumes des peuples étrangers, alla d'abord en Egypte, à la cour d'Amasis, et de là à Sardes, à celle de Crésus, qui le reçut avec distinction et le logea dans son palais. Trois ou quatre jours après son arrivée, il fut conduit par ordre du prince dans les trésors, dont on lui montra toutes les richesses. Quand Solon les eut vues et suffisamment considérées, le roi lui parla en ces termes : «Le bruit de votre sagesse et de vos voyages est venu jusqu'à nous, et je n'ignore point qu'en parcourant tant de pays vous n'avez eu d'autre but que de vous instruire de leurs lois et de leurs usages, et de perfectionner vos connaissances. Je désire savoir quel est l'homme le plus heureux que vous ayez vu». Il lui faisait cette question, parce qu'il se croyait lui-même le plus heureux de tous les hommes. «C'est Tellus d'Athènes», lui dit Solon sans le flatter, et sans lui déguiser la vérité. Crésus, étonné de cette réponse : «Sur quoi donc, lui demanda-t-il avec vivacité, estimez-vous Tellus si heureux ? - Parce qu'il a vécu dans une ville florissante, reprit Solon, qu'il a eu des enfants beaux et vertueux, que chacun d'eux lui a donné des petits-fils qui tous lui ont survécu, et qu'enfin, après avoir joui d'une fortune considérable relativement à celles de notre pays, il a terminé ses jours d'une manière éclatante : car, dans un combat des Athéniens contre leurs voisins à Eleusis, il secourut les premiers, mit en fuite les ennemis, et mourut glorieusement. Les Athéniens lui érigèrent un monument aux frais du public dans l'endroit même où il était tombé mort, et lui rendirent de grands honneurs».
XXXI. Tout ce que Solon venait de dire sur la félicité de Tellus excita Crésus à lui demander quel était celui qu'il estimait après cet Athénien le plus heureux des hommes, ne doutant point que la seconde place ne lui appartînt. «Cléobis et Biton, répondit Solon : ils étaient Argiens, et jouissaient d'un bien honnête ; ils étaient outre cela si forts, qu'ils avaient tous deux également remporté des prix aux jeux publics. On raconte d'eux aussi le trait suivant. Les Argiens célébraient une fête en l'honneur de Junon. Il fallait absolument que leur mère se rendît au temple sur un char traîné par une couple de boeufs. Comme le temps de la cérémonie pressait, et qu'il ne permettait pas à ces jeunes gens d'aller chercher leurs boeufs, qui n'étaient point encore revenus des champs, ils se mirent eux-mêmes sous le joug ; et, tirant le char sur lequel leur mère était montée, ils le conduisirent ainsi quarante-cinq stades jusqu'au temple de la déesse. Après cette action, dont toute l'assemblée fut témoin, ils terminèrent leurs jours de la manière la plus heureuse, et la divinité fit voir par cet événement qu'il est plus avantageux à l'homme de mourir que de vivre. Les Argiens assemblés autour de ces deux jeunes gens louaient leur bon naturel, et les Argiennes félicitaient la prêtresse d'avoir de tels enfants. Celle-ci, comblée de joie et de l'action et des louanges qu'on lui donnait, debout aux pieds de la statue, pria la déesse d'accorder à ses deux fils Cléobis et Biton le plus grand bonheur que pût obtenir un mortel. Cette prière finie, après le sacrifice et le festin ordinaire dans ces sortes de fêtes, les deux jeunes gens, s'étant endormis dans le temple même, ne se réveillèrent plus, et terminèrent ainsi leur vie. Les Argiens, les regardant comme deux personnages distingués, firent faire leur statue, et les envoyèrent au temple de Delphes».
XXXII. Solon accordait par ce discours le second rang à Cléobis et Biton. «Athénien, répliqua Crésus en colère, faites-vous donc si peu de cas de ma félicité que vous me jugiez indigne d'être comparé avec des hommes privés ? - Seigneur, reprit Solon, vous me demandez ce que je pense de la vie humaine : ai-je donc pu vous répondre autrement, moi qui sais que la Divinité est jalouse du bonheur des humains, et qu'elle se plaît à le troubler ? car dans une longue carrière où voit et l'on souffre bien des choses fâcheuses. Je donne à un homme soixante-dix ans pour le plus long terme de sa vie. Ces soixante-dix ans font vingt-cinq mille deux cents jours, en omettant les mois intercalaires ; mais, si chaque sixième année on ajoute un mois, afin que les saisons se retrouvent précisément au temps où elles doivent arriver, dans les soixante-dix ans vous aurez douze mois intercalaires, moins la troisième partie d'un mois, qui feront trois cent cinquante jours, lesquels, ajoutés à vingt-cinq mille deux cents, donneront vingt-cinq mille cinq cent cinquante jours. Or de ces vingt-cinq mille cinq cent cinquante jours, qui font soixante-dix ans, vous n'en trouverez pas un qui amène un événement absolument semblable. Il faut donc en convenir, seigneur, l'homme n'est que vicissitude. Vous avez certainement des richesses considérables, et vous régnez sur un peuple nombreux ; mais je ne puis répondre à votre question que je ne sache si vous avez fini vos jours dans la prospérité ; car l'homme comblé de richesses n'est pas plus heureux que celui qui n'a que le simple nécessaire, à moins que la fortune ne l'accompagne, et que, jouissant de toutes sortes de biens, il ne termine heureusement sa carrière. Rien de plus commun que le malheur dans l'opulence, et le bonheur dans la médiocrité. Un homme puissamment riche, mais malheureux, n'a que deux avantages sur celui qui a du bonheur ; mais celui-ci en a un grand nombre sur le riche malheureux. L'homme riche est plus en état de contenter ses désirs et de supporter de grandes pertes ; mais, si l'autre ne peut soutenir de grandes pertes ni satisfaire ses désirs, son bonheur le met à couvert des uns et des autres, et en cela il l'emporte sur le riche. D'ailleurs il a l'usage de tous ses membres, il jouit d'une bonne santé, il n'éprouve aucun malheur, il est beau, et heureux en enfants. Si à tous ces avantages vous ajoutez celui d'une belle mort, c'est cet homme-là que vous cherchez, c'est lui qui mérite d'être appelé heureux. Mais, avant sa mort, suspendez votre jugement, ne lui donnez point de nom ; dites seulement qu'il est fortuné. Il est impossible qu'un homme réunisse tous ces avantages, de même qu'il n'y a point de pays qui se suffise, et qui renferme tous les biens : car, si un pays en a quelques-uns, il est privé de quelques autres ; le meilleur est celui qui en a le plus. Il en est ainsi de l'homme : il n'y en a pas un qui se suffise à lui-même : s'il possède quelques avantages, d'autres lui manquent. Celui qui en réunit un plus grand nombre, qui les conserve jusqu'à la fin de ses jours, et sort ensuite tranquillement de cette vie ; celui-là, seigneur, mérite, à mon avis, d'être appelé heureux. Il faut considérer la fin de toutes choses, et voir quelle en sera l'issue ; car il arrive que Dieu, après avoir fait entrevoir la félicité à quelques hommes, la détruit souvent radicalement».
XXXIII. Ainsi parla Solon. Il n'avait rien dit d'agréable à Crésus, et ne lui avait pas témoigné la moindre estime : aussi fut-il renvoyé de la cour. Il est probable qu'on traita de grossier un homme qui, sans égard aux biens présents, voulait qu'en tout on envisageât la fin.
XXXIV. Après le départ de Solon, la vengeance des dieux éclata d'une manière terrible sur Crésus, en punition, comme on peut le conjecturer, de ce qu'il s'estimait le plus heureux de tous les hommes. Un songe, qu'il eut aussitôt après, lui annonça les malheurs dont un de ses fils était menacé. Il en avait deux : l'un affligé d'une disgrâce naturelle, il était muet ; l'autre surpassait en tout les jeunes gens de son âge. Il se nommait Atys. C'est donc cet Atys que le songe indiqua à Crésus comme devant périr d'une arme de fer. Le roi réfléchit à son réveil sur ce songe. Tremblant pour son fils, il lui choisit une épouse et l'éloigna des armées, à la tête desquelles il avait coutume de l'envoyer. Il fit aussi enlever les dards, les piques, et toutes sortes d'armes offensives dont on fait usage à la guerre, des appartements des hommes où elles étaient suspendues, et les fit entasser dans des magasins, de peur qu'il n'en tombât quelqu'une sur son fils.
XXXV. Pendant que Crésus était occupé des noces de ce jeune prince, arrive à Sardes un malheureux dont les mains étaient impures : cet homme était Phrygien, et issu du sang royal. Arrivé au palais, il pria Crésus de le purifier, suivant les lois du pays. Ce prince le purifia. Les expiations chez les Lydiens ressemblent beaucoup à celles qui sont usitées en Grèce. Après la cérémonie, Crésus voulut savoir d'où il venait et qui il était. «Etranger, lui dit-il, qui êtes-vous ? De quel canton de Phrygie êtes-vous venu à ma cour comme suppliant ? Quel homme, quelle femme avez-vous tué ? - Seigneur, je suis fils de Gordius et petit-fils de Midas. Je m'appelle Adraste. J'ai tué mon frère sans le vouloir. Chassé par mon père et dépouillé de tout, je suis venu chercher ici un asile. - Vous sortez, reprit Crésus, d'une maison que j'aime. Vous êtes chez des amis : rien ne vous manquera dans mon palais tant que vous jugerez à propos d'y rester. En supportant légèrement ce malheur, vous ferez un gain considérable». Adraste vécut dans le palais de Crésus.
XXXVI. Dans ce même temps il parut en Mysie un sanglier d'une grosseur énorme, qui, descendant du mont Olympe, faisait un grand dégât dans les campagnes. Les Mysiens l'avaient attaqué à diverses reprises ; mais ils ne lui avaient fait aucun mal, et il leur en avait fait beaucoup. Enfin ils s'adressèrent à Crésus : «Seigneur, lui dirent leurs députés, il a paru sur nos terres un effroyable sanglier qui ravage nos campagnes ; malgé nos efforts, nous n'avons pu nous en défaire. Nous vous supplions donc d'envoyer avec nous le prince votre fils à la tête d'une troupe de jeunes gens choisis et votre meute, afin d'en purger le pays». Crésus, se rappelant le songe qu'il avait eu, leur répondit : «Ne me parlez pas davantage de mon fils ; je ne puis l'envoyer avec vous. Nouvellement marié, il n'est maintenant occupé que de ses amours ; mais je vous donnerai mon équipage de chasse, avec l'élite de la jeunesse lydienne, à qui je recommanderai de s'employer avec ardeur pour vous délivrer de ce sanglier».
XXXVII. Les Mysiens furent très contents de cette réponse ; mais Atys, qui avait entendu leur demande et le refus qu'avait fait Crésus de l'envoyer avec eux, entra sur ces entrefaites, et, s'adressant à ce prince : «Mon père, lui dit-il, les actions les plus nobles et les plus généreuses m'étaient autrefois permises, je pouvais m'illustrer à la guerre et à la chasse ; mais vous m'éloignez aujourd'hui de l'une et de l'autre, quoique vous n'ayez remarqué en moi ni lâcheté ni faiblesse. Quand j'irai à la place publique, ou que j'en reviendrai, de quel oeil me verra-t-on ? quelle opinion auront de moi nos citoyens ? quelle idée en aura la jeune princesse que je viens d'épouser ? à quel homme se croira-t-elle unie ? Permettez-moi donc, seigneur, d'aller à cette chasse avec les Mysiens ; ou persuadez-moi par vos discours que les choses faites comme vous le voulez sont mieux».
XXXVIII. «Mon fils, reprit Crésus, si je vous empêche d'aller à cette chasse, ce n'est pas que j'aie remarqué dans votre conduite la moindre lâcheté, ou quelque autre chose qui m'ait déplu ; mais une vision que j'ai eue en songe pendant mon sommeil m'a fait connaître que vous aviez peu de temps à vivre, et que vous deviez périr d'une arme de fer. C'est uniquement à cause de ce songe que je me suis pressé de vous marier ; c'est pour cela que je ne vous envoie pas à cette expédition, et que je prends toutes sortes de précautions pour vous dérober, du moins pendant ma vie, au malheur qui vous menace. Je n'ai que vous d'enfant, car mon autre fils, disgracié de la nature, n'existe plus pour moi».
XXXIX. «Mon père, répliqua le jeune prince, après un pareil songe, le soin avec lequel vous me gardez est bien excusable : mais il me semble que vous ne saisissez pas le sens de cette vision ; puisque vous vous y êtes trompé, je dois vous l'expliquer. Ce songe, dites-vous, vous a fait connaître que je devais périr d'une arme de fer. Mais un sanglier a-t-il des mains ? est-il armé de ce fer aigu que vous craignez ? Si votre songe vous eût appris que je dusse mourir d'une défense de sanglier ou de quelque autre manière semblable, il vous faudrait faire ce que vous faites ; mais il n'est question que d'une pointe de fer. Puis donc que ce ne sont pas des hommes que j'ai à combattre, laissez-moi partir».
XL. «Mon fils, répond Crésus, votre interprétation est plus juste que la mienne ; et puisque vous m'avez vaincu, je change de sentiment : la chasse que vous désirez vous est permise».
XLI. En même temps il mande le Phrygien Adraste, et lui dit : «Vous étiez sous les coups du malheur, Adraste (me préserve le ciel de vous le reprocher !); je vous ai purifié, je vous ai reçu dans mon palais, où je pourvois à tous vos besoins : prévenu par mes bienfaits, vous me devez quelque retour. Mon fils part pour la chasse ; je vous confie la garde de sa personne : préservez-le des brigands qui pourraient vous attaquer sur la route. D'ailleurs il vous importe de rechercher les occasions de vous signaler ; vos pères vous l'ont enseigné, la vigueur de votre âge vous le permet».
XLII. «Seigneur, répondit Adraste, sans un pareil motif je n'irais point à ce combat. Au comble du malheur, me mêler à des hommes de mon âge et plus heureux, cela n'est pas juste, et je n'en ai pas la volonté : souvent je m'en suis abstenu. Mais vous le désirez : il faut vous obliger, il faut reconnaître vos bienfaits ; je suis prêt à obéir. Soyez sûr que votre fils, confié à ma garde, reviendra sain et sauf, autant qu'il dépendra de son gardien».
XLIII. Le prince Atys et lui partirent après cette réponse, avec une troupe de jeunes gens d'élite et la meute du roi. Arrivés au mont Olympe, on cherche le sanglier, on le trouve, on l'environne, on lance sur lui des traits. Alors cet étranger, cet Adraste, purifié d'un meurtre, lance un javelot, manque le sanglier, et frappe le fils de Crésus. Ainsi le jeune prince fut percé d'un fer aigu ; ainsi fut accompli le songe du roi. Aussitôt un courrier dépêché à Sardes apprit au roi la nouvelle du combat et le sort de son fils.
XLIV. Crésus, troublé de sa mort, la ressentit d'autant plus vivement qu'il avait lui-même purifié d'un homicide celui qui en était l'auteur. S'abandonnant à toute sa douleur, il invoquait Jupiter Expiateur, le prenait à témoin du mal que lui avait fait cet étranger ; il l'invoquait encore comme protecteur de l'hospitalité et de l'amitié : comme protecteur de l'hospitalité, parce qu'en donnant à cet étranger une retraite dans son palais, il avait nourri sans le savoir le meurtrier de son fils ; comme dieu de l'amitié, parce qu'ayant chargé Adraste de la garde de son fils, il avait trouvé en lui son plus cruel ennemi.
XLV. Quelque temps après, les Lydiens arrivèrent avec le corps d'Atys, suivi du meurtrier. Adraste, debout devant le cadavre, les mains étendues vers Crésus, le conjure de l'immoler sur son fils, la vie lui étant devenue odieuse depuis qu'à son premier crime il en a ajouté un second, en tuant celui qui l'avait purifié. Quoique accablé de douleur, Crésus ne put entendre le discours de cet étranger sans être ému de compassion. «Adraste, lui dit-il, en vous condamnant vous-même à la mort, vous satisfaites pleinement ma vengeance. Vous n'êtes pas l'auteur de ce meurtre, puisqu'il est involontaire ; je n'en accuse que celui des dieux qui me l'a prédit». Crésus rendit les derniers devoirs à son fils, et ordonna qu'on lui fît des funérailles convenables à son rang. La cérémonie achevée, et le silence régnant autour du monument, cet Adraste, fils de Gordius, petit-fils de Midas, qui avait été le meurtrier de son propre frère, le meurtrier de celui qui l'avait purifié, sentant qu'il était le plus malheureux de tous les hommes, se tua sur le tombeau d'Atys.
XLVI. Crésus pleura deux ans la mort de son fils. Mais l'empire d'Astyage, fils de Cyaxare, détruit par Cyrus, fils de Cambyse, et celui des Perses, qui prenait de jour en jour de nouveaux accroissements, lui firent mettre un terme à sa douleur. Il ne pensa plus qu'aux moyens de réprimer cette puissance avant qu'elle devînt plus formidable. Tout occupé de cette pensée, il résolut sur-le-champ d'éprouver les oracles de la Grèce et l'oracle de la Libye. Il envoya des députés en divers endroits, les uns à Delphes, les autres à Abes en Phocide, les autres à Dodone, quelques-uns à l'oracle d'Amphiaraüs, à l'antre de Trophonius, et aux Branchides dans la Milésie : voilà les oracles de Grèce que Crésus fit consulter. Il en dépêcha aussi en Libye, au temple de Jupiter Ammon. Ce prince n'envoya ces députés que pour éprouver ces oracles ; et, au cas qu'ils rendissent des réponses conformes à la vérité, il se proposait de les consulter une seconde fois, pour savoir s'il devait faire la guerre aux Perses.
XLVII. Il donna ordre aux députés qu'il envoyait pour sonder les oracles, de les consulter le centième jour à compter de leur départ de Sardes, de leur demander ce que Crésus, fils d'Alyattes, roi de Lydie, faisait ce jour-là, et de lui rapporter par écrit la réponse de chaque oracle. On ne connaît que la réponse de l'oracle de Delphes, et l'on ignore quelle fut celle des autres oracles. Aussitôt que les Lydiens furent entrés dans le temple pour consulter le dieu, et qu'ils eurent interrogé la Pythie sur ce qui leur avait été prescrit, elle leur répondit ainsi en vers hexamètres : Je connais le nombre des grains de sable et les bornes de la mer ; je comprends le langage du muet ; j'entends la voix de celui qui ne parle point. Mes sens sont frappés de l'odeur d'une tortue qu'on fait cuire avec de la chair d'agneau dans une chaudière d'airain, dont le couvercle est aussi d'airain.
XLVIII. Les Lydiens, ayant mis par écrit cette réponse de la Pythie, partirent de Delphes, et revinrent à Sardes. Quand les autres députés, envoyés en divers pays, furent aussi de retour avec les réponses des oracles, Crésus les ouvrit, et les examina chacune en particulier. Il y en eut sans doute qu'il n'approuva point ; mais, dès qu'il eut entendu celle de l'oracle de Delphes, il la reconnut pour vraie, et l'adora, persuadé que cet oracle était le seul véritable, comme étant le seul qui eût découvert ce qu'il faisait. En effet, après le départ des députés qui allaient consulter les oracles au jour convenu, voici ce dont il s'était avisé. Il avait imaginé la chose la plus impossible à deviner et à connaître. Ayant lui-même coupé par morceaux une tortue et un agneau, il les avait fait cuire ensemble dans un vase d'airain, dont le couvercle était de même métal. Telle fut la réponse de Delphes.
XLIX. Quant à celle que reçurent les Lydiens dans le temple d'Amphiaraüs, après les cérémonies et les sacrifices prescrits par les lois, je n'en puis rien dire. On sait uniquement que Crésus reconnut aussi la véracité de cet oracle.
L. Ce prince tâcha ensuite de se rendre propice le dieu de Delphes par de somptueux sacrifices, dans lesquels on immola trois mille victimes de toutes les espèces d'animaux qu'il est permis d'offrir aux dieux. Il fit ensuite brûler sur un grand bûcher des lits dorés et argentés, des vases d'or, des robes de pourpre et d'autres vêtements, s'imaginant par cette profusion se rendre le dieu plus favorable. Il enjoignit aussi aux Lydiens d'immoler au dieu toutes les victimes que chacun aurait en sa puissance. Ayant fait fondre, après ce sacrifice, une prodigieuse quantité d'or, il en fit faire cent dix-sept demi-plinthes, dont les plus longues avaient six palmes, et les plus petites trois, sur une d'épaisseur. Il y en avait quatre d'or fin, du poids d'un talent et demi ; les autres étaient d'un or pâle, et pesaient deux talents. Il fit faire aussi un lion d'or fin, du poids de dix talents. On le plaça sur ces demi-plinthes ; mais il tomba lorsque le temple de Delphes fut brûlé. Il est maintenant dans le trésor des Corinthiens, et il ne pèse plus que six talents et demi, parce que dans l'incendie du temple il s'en fondit trois talents et demi.
LI. Ces ouvrages achevés, Crésus les envoya à Delphes avec beaucoup d'autres présents, deux cratères extrêmement grands, l'un d'or et l'autre d'argent. Le premier était à droite en entrant dans le temple, et le second à gauche. On les transporta aussi ailleurs, lors de l'incendie du temple. Le cratère d'or est aujourd'hui dans le trésor des Clazoméniens : il pèse huit talents et demi, et douze mines. Celui d'argent est dans l'angle du vestibule du temple : il tient six cents amphores. Les Delphiens y mêlent l'eau avec le vin, aux fêtes appelées Théophanies. Ils disent que c'est un ouvrage de Théodore de Samos ; et je le crois d'autant plus volontiers que cette pièce me paraît d'un travail exquis. Le même prince y envoya aussi quatre muids d'argent, qui sont dans le trésor des Corinthiens ; deux bassins pour l'eau lustrale, dont l'un est d'or et l'autre d'argent. Sur celui d'or est gravé le nom des Lacédémoniens, et ils prétendent avoir fait cette offrande, mais à tort ; il est certain que c'est aussi un présent de Crésus. Un habitant de Delphes y a mis cette inscription pour flatter les Lacédémoniens. J'en tairai le nom, quoique je le sache fort bien. Il est vrai qu'ils ont donné l'enfant à travers la main duquel l'eau coule et se répand ; mais ils n'ont fait présent ni de l'un ni de l'autre de ces deux bassins. A ces dons Crésus en ajouta plusieurs autres de moindre prix ; par exemple, des plats d'argent de forme ronde, et une statue d'or de trois coudées de haut, représentant une femme. Les Delphiens disent que c'est celle de sa boulangère. Il y fit aussi porter les colliers et les ceintures de la reine sa femme. Tels sont les présents qu'il fit à Delphes.
LII. Quant à Amphiaraüs, sur ce qu'il apprit de son mérite et de ses malheurs, il lui consacra un bouclier d'or massif, avec une pique d'or massif, c'est-à-dire dont la hampe était d'or ainsi que le fer. De mon temps on voyait encore l'un et l'autre à Thèbes, dans le temple d'Apollon Isménien.
LIII. Les Lydiens chargés de porter ces présents aux oracles de Delphes et d'Amphiaraüs avaient ordre de leur demander si Crésus devait faire la guerre aux Perses, et joindre à son armée des troupes auxiliaires. A leur arrivée, les Lydiens présentèrent les offrandes, et consultèrent les oracles en ces termes : «Crésus, roi des Lydiens et autres nations, persuadé que vous êtes les seuls véritables oracles qu'il y ait dans le monde, vous envoie ces présents, qu'il croit dignes de votre habileté. Maintenant il vous demande s'il doit marcher contre les Perses, et s'il doit joindre à son armée des troupes auxiliaires». Ce furent là les demandes des députés. Les deux oracles s'accordèrent dans leurs réponses. Ils prédirent l'un et l'autre à ce prince que, s'il entreprenait la guerre contre les Perses, il détruirait un grand empire, et lui conseillèrent de rechercher l'amitié des Etats de la Grèce qu'il aurait reconnus pour les plus puissants.
LIV. Crésus, charmé de ces réponses, et concevant l'espoir de renverser l'empire de Cyrus, envoya de nouveau des députés à Pytho, pour distribuer à chacun des habitants (il en savait le nombre) deux statères d'or par tête. Les Delphiens accordèrent par reconnaissance à Crésus et aux Lydiens la prérogative de consulter les premiers l'oracle, l'immunité, la préséance, et le privilège perpétuel de devenir citoyens de Delphes quand ils le désireraient.
LV. Crésus, ayant envoyé ces présents aux Delphiens, interrogea le dieu pour la troisième fois ; car, depuis qu'il en eut reconnu la véracité, il ne cessa plus d'y avoir recours. Il lui demanda donc si sa monarchie serait de longue durée. La Pythie lui répondit en ces termes : «Quand un mulet sera roi des Mèdes, fuis alors, Lydien efféminé, sur les bords de l'Hermus : garde-toi de résister, et ne rougis point de ta lâcheté».
LVI. Cette réponse fit encore plus de plaisir à Crésus que toutes les autres. Persuadé qu'on ne verrait jamais sur le trône des Mèdes un mulet, il conclut que ni lui ni ses descendants ne seraient jamais privés de la puissance souveraine. Ce prince, ayant recherché avec soin quels étaient les peuples les plus puissants de la Grèce, dans le dessein de s'en faire des amis, il trouva que les Lacédémoniens et les Athéniens tenaient le premier rang, les uns parmi les Doriens, les autres parmi les Ioniens. Ces nations autrefois étaient en effet les plus distinguées, l'une étant pélasgique et l'autre hellénique. La première n'est jamais sortie de son pays, et l'autre a souvent changé de demeure. Les Hellènes habitaient en effet la Phthiotide sous le règne de Deucalion ; et sous celui de Dorus, fils d'Hellen, le pays appelé Histiaeotide, au pied des monts Ossa et Olympe. Chassés de l'Histiaeotide par les Cadméens, ils allèrent s'établir à Pinde, et furent appelés Macednes. De là ils passèrent dans la Dryopide, et de la Dryopide dans le Péloponnèse, où ils ont été appelés Doriens.
LVII. Quelle langue parlaient alors les Pélasges, c'est un article sur lequel je ne puis rien affirmer. S'il est permis de fonder des conjectures sur quelques restes de ces Pélasges, qui existent encore aujourd'hui à Crestone, au-dessus des Tyrrhéniens, et qui jadis, voisins des Doriens d'aujourd'hui, habitaient la terre appelée maintenant Thessaliotide ; si à ces Pélasges on ajoute ceux qui ont fondé Placie et Scylacé sur l'Hellespont, et qui ont demeuré autrefois avec les Athéniens, et les habitants d'autres villes pélasgiques dont le nom s'est changé ; il résulte de ces conjectures, si l'on peut s'en autoriser, que les Pélasges parlaient une langue barbare. Or, si tel était l'idiome de toute la nation, il s'ensuit que les Athéniens, Pélasges d'origine, oublièrent leur langue en devenant Hellènes, et qu'ils apprirent celle de ce dernier peuple ; car le langage des Crestoniates et des Placiens, qui est le même, n'a rien de commun avec celui d'aucuns de leurs voisins : preuve évidente que ces deux peuplades de Pélasges conservent encore de nos jours l'idiome qu'elles portèrent dans ces pays en venant s'y établir.
LVIII. Quant à la nation hellénique, depuis son origine elle a toujours parlé la même langue ; du moins cela me paraît ainsi. Faible, séparée des Pélasges, et tout à fait petite dans son commencement, elle est devenue aussi considérable que plusieurs autres nations, principalement depuis qu'un grand nombre de peuples barbares se sont incorporés avec elle ; et c'est, indépendamment des autres raisons, ce qui, à mon avis, a empêché l'agrandissement des Pélasges, qui étaient barbares.
LIX. Crésus apprit que les Athéniens, l'un de ces peuples, partagés en diverses factions, étaient sous le joug de Pisistrate, fils d'Hippocrates, alors tyran d'Athènes. Hippocrates était un simple particulier. Il lui arriva aux jeux olympiques un prodige mémorable : il avait offert un sacrifice ; les chaudières, près de l'autel, remplies des victimes et d'eau, bouillirent et débordèrent sans feu. Chilon de Lacédémone, qui par hasard était présent, témoin de ce prodige, conseilla à Hippocrates de ne point prendre de femme féconde, ou, s'il en avait une, de la répudier ; et s'il lui était né un fils, de ne le point reconnaître. Hippocrates ne voulut point déférer aux conseils de Chilon. Quelque temps après naquit le Pisistrate dont nous parlons, qui, dans la querelle entre les Paraliens ou habitants de la côte maritime, commandés par Mégaclès, fils d'Alcmaeon, et les habitants de la plaine, ayant à leur tête Lycurgue, fils d'Aristolaïdes, pour se frayer une route à la tyrannie, suscita un troisième parti. Il assembla donc ce parti, sous prétexte de défendre les Hypéracriens. Voici la ruse qu'il imagina : s'étant blessé lui et ses mulets, il poussa son char vers la place publique, comme s'il se fût échappé des mains de ses ennemis, qui avaient voulu le tuer lorsqu'il allait à la campagne. Il conjura les Athéniens de lui accorder une garde : il leur rappela la gloire dont il s'était couvert à la tête de leur armée contre les Mégariens, la prise de Nisée, et leur cita plusieurs autres traits de valeur. Le peuple, trompé, lui donna pour garde un certain nombre de citoyens choisis, qui le suivaient, armés de bâtons au lieu de piques. Pisistrate les fit soulever, et s'empara par leur moyen de la citadelle. Dès ce moment il fut maître d'Athènes, mais sans troubler l'exercice des magistratures, sans altérer les lois. Il mit le bon ordre dans la ville, et la gouverna sagement suivant ses usages. Peu de temps après, les factions réunies de Mégaclès et de Lycurgute chassèrent l'usurpateur.
LX. Ce fut ainsi que Pisistrate pour la première fois se rendit maître d'Athènes, et qu'il fut dépouillé de la tyrannie, qui n'avait pas encore eu le temps de jeter de profondes racines. Ceux qui l'avaient chassé renouvelèrent bientôt après leurs anciennes querelles. Mégaclès, assailli de toutes parts par la faction contraire, fit proposer par un héraut à Pisistrate de le rétablir, s'il voulait épouser sa fille. Pisistrate accepta ses offres ; et, s'étant engagé à remplir cette condition, il imagina, de concert avec Mégaclès, pour son rétablissement, un moyen d'autant plus ridicule, à mon avis, que dès la plus haute antiquité les Hellènes ont été distingués des barbares comme plus adroits et plus éloignés de la sotte bonhomie ; et que les auteurs de cette trame avaient affaire aux Athéniens, peuple qui a la réputation d'être le plus spirituel de la Grèce. Il y avait à Paeania, bourgade de l'Attique, une certaine femme, nommée Phya, qui avait quatre coudées de haut moins trois doigts, et d'ailleurs d'une grande beauté. Ils armèrent cette femme de pied en cap ; et, l'ayant fait monter sur un char, parée de tout ce qui pouvait relever sa beauté, ils lui firent prendre le chemin d'Athènes. Ils étaient précédés de hérauts qui, à leur arrivée dans la ville, se mirent à crier, suivant les ordres qu'ils avaient reçus : «Athéniens, recevez favorablement Pisistrate ; Minerve, qui l'honore plus que tous les autres hommes, le ramène elle-même dans sa citadelle». Les hérauts allaient ainsi de côté et d'autre, répétant la même injonction. Aussitôt le bruit se répand que Minerve ramenait Pisistrate. Les bourgades en sont imbues, la ville ne doute pas que cette femme ne soit la déesse. On lui adresse des voeux, on reçoit le tyran de sa main.
LXI. Pisistrate, ayant ainsi recouvré la puissance souveraine, épousa la fille de Mégaclès, suivant l'accord fait entre eux ; mais comme il avait des fils déjà grands, et que les Alcméonides passaient pour être sous l'anathème, ne voulant point avoir d'enfants de sa nouvelle femme, il n'avait avec elle qu'un commerce contre nature. La jeune femme tint dans les commencements cet outrage secret ; mais dans la suite elle le révéla de son propre mouvement à sa mère, ou sur les questions que celle-ci lui fit. Sa mère en fit part à Mégaclès, son mari, qui, indigné de l'affront que lui faisait son gendre, se réconcilia, dans sa colère, avec la faction opposée. Pisistrate, informé de ce qui se tramait contre lui, abandonna l'Attique et se retira à Erétrie, où il tint conseil avec ses fi1s. Hippias lui conseilla de recouvrer la tyrannie. Son avis prévalut. Des villes auxquelles les Pisistratides avaient rendu auparavant quelque service leur firent des présents ; ils les acceptèrent et les recueillirent. Plusieurs donnèrent des sommes considérables ; mais les Thébains se distinguèrent par leur libéralité. Quelque temps après, pour le dire en peu de mots, tout se trouva prêt pour leur retour. Il leur vint du Péloponnèse des troupes argiennes qu'ils prirent à leur solde, et un Naxien nommé Lygdamis redoubla leur ardeur par un secours volontaire de troupes et d'argent.
LXII. Ils partirent donc d'Erétrie et revinrent dans l'Attique au commencement de la onzième année. D'abord ils s'emparèrent de Marathon ; et, ayant assis leur camp dans cet endroit, ceux de leur parti s'y rendirent en foule, les uns d'Athènes, les autres des bourgades voisines, tous préférant la tyrannie à la liberté. Les habitants de la ville ne firent aucune attention à Pisistrate tant qu'il fut occupé à lever de l'argent, et même après qu'il se fut rendu maître de Marathon. Mais, sur la nouvelle qu'il s'avançait de Marathon droit à Athènes, ils allèrent avec toutes leurs forces à sa rencontre. Cependant Pisistrate et les siens, étant partis de Marathon tous réunis en un même corps, approchaient de la ville. Ils arrivèrent près du temple de Minerve Pallénide, et ce fut en face de ce temple qu'ils assirent leur camp. Là un devin d'Acharnés, nommé Amphilyte, inspiré par les dieux, vint se présenter à Pisistrate, et, l'abordant, lui dit cet oracle en vers hexamètres : Le filet est jeté, les rets sont tendus : la nuit, au clair de la lune, les thons s'y jetteront en foule.
LXIII. Ainsi parla le devin, inspiré par le dieu. Pisistrate saisit le sens de l'oracle, l'accepta, et fit incontinent marcher son armée. Les citoyens d'Athènes avaient déjà pris leur repas, et se livraient les uns au jeu de dés, les autres au sommeil. Pisistrate, tombant sur eux avec ses troupes, les mit en déroute. Pendant la fuite, il s'avisa d'un moyen très sage pour les tenir dispersés et les empêcher de se rallier. Il fit monter à cheval ses fils, et leur ordonna de prendre les devants. Ils atteignirent les fuyards, et les exhortèrent de la part de Pisistrale à prendre courage et à retourner chacun chez soi.
LXIV. Les Athéniens obéirent ; et Pisistrate, s'étant ainsi rendu maître d'Athènes pour la troisième fois, affermit sa tyrannie par le moyen de ses troupes auxiliaires, et des grandes sommes d'argent qu'il tirait en partie de l'Attique, et en partie du fleuve Strymon. Il l'affermit encore par sa conduite avec les Athéniens, qui avaient tenu ferme dans la dernière action, et qui n'avaient pas sur-le-champ pris la fuite. Il s'assura de leurs enfants, qu'il envoya à Naxos ; car il avait conquis cette île, et en avait donné le gouvernement à Lygdamis. Il l'affermit enfin en purifiant l'île de Délos, suivant l'ordre des oracles. Voici comment se fit cette purification : de tous les lieux d'où l'on voyait le temple, il fit exhumer les cadavres, et les fit transporter dans un autre canton de l'île. Pisistrate eut d'autant moins de peine à établir sa tyrannie sur les Athéniens, que les uns avaient été tués dans le combat, et que les autres avaient abandonné leur patrie et s'étaient sauvés avec Mégaclès.
LXV. Tels étaient les embarras où Crésus apprit que se trouvaient alors les Athéniens. Quant aux Lacédémoniens, on lui dit que, après avoir éprouvé des pertes considérables, ils prenaient enfin le dessus dans la guerre contre les Tégéates. En effet, sous le règne de Léon et d'Agasiclès, les Lacédémoniens, vainqueurs dans leurs autres guerres, avaient échoué contre les seuls Tégéates. Longtemps auparavant ils étaient les plus mal policés de presque tous les Grecs, et n'avaient aucun commerce avec les étrangers, ni même entre eux ; mais dans la suite ils passèrent de la manière que je vais dire à une meilleure législation. Lycurgue jouissait à Sparte de la plus haute estime. Arrivé à Delphes pour consulter l'oracle, à peine fut-il entré dans le temple, qu'il entendit ces mots de la Pythie : «Te voilà dans mon temple engraisse de victimes, ami de Jupiter et des habitants de l'Olympe. Mon oracle incertain balance s'il te déclarera un dieu ou un homme ; je te crois plutôt un dieu». Quelques-uns ajoutent que la Pythie lui dicta aussi les lois qui s'observent maintenant à Sparle ; mais, comme les Lacédémoniens en conviennent eux-mêmes, ce fut Lycurgue qui apporta ces lois de Crète, sous le règne de Léobotas son neveu, roi de Sparte. En effet, à peine eut-il la tutelle de ce jeune prince, qu'il réforma les lois anciennes, et prit des mesures contre la transgression des nouvelles. Il régla ensuite ce qui concernait la guerre, les cnomoties, les triacades et les syssities. Outre cela, il institua les éphores et les sénateurs.
LXVI. Ce fut ainsi que les Lacédémoniens substituèrent des lois sages à leurs anciennes coutumes. Ils élevèrent à ce législateur un temple après sa mort, et lui rendent encore aujourd'hui de grands honneurs. Comme ils habitaient un pays fertile et très peuplé, leur république ne tarda pas à s'accroître et à devenir florissante. Mais, ennuyés du repos et se croyant supérieurs aux Arcadiens, ils consultèrent l'oracle de Delphes sur la conquête de l'Arcadie. La Pythie répondit : «Tu me demandes l'Arcadie ; ta demande est excessive, je la refuse. L'Arcadie a des guerriers nourris de gland, qui repousseront ton attaque. Je ne te porte pas cependant envie : je te donne Tégée pour y danser, et ses belles plaines pour les mesurer au cordeau». Sur cette réponse, les Lacédémonieus renoncèrent au reste de l'Arcadie ; et, munis de chaînes, ils marchèrent contre les Tégéates, qu'ils regardaient déjà comme leurs esclaves, sur la foi d'un oracle équivoque ; mais, ayant eu du dessous dans la bataille, tous ceux qui tombèrent vifs entre les mains de l'ennemi furent chargés des chaînes qu'ils avaient apportées ; et, travaillant en cet état aux terres des Tégéates, ils les mesurèrent au cordeau. Ces chaînes subsistent encore à présent à Tégée ; elles sont appendues autour du temple de Minerve Aléa.
LXVII. Les Lacédémoniens avaient été continuellement malheureux dans leur première guerre contre les Tégéates ; mais du temps de Crésus, et sous le règne d'Anaxandrides et d'Ariston à Sparte, ils acquirent de la supériorité par les moyens que je vais dire. Comme ils avaient toujours eu du dessous contre les Tégéates, ils envoyèrent demander à l'oracle de Delphes quel dieu ils devaient se rendre propice pour avoir l'avantage sur leurs ennemis. La Pythie leur répondit qu'ils en triompheraient, s'ils emportaient chez eux les ossements d'Oreste, fils d'Agamemnon. Comme ils ne pouvaient découvrir son monument, ils envoyèrent de nouveau demander à l'oracle en quel endroit reposait ce héros. Voici la réponse de la Pythie : «Dans les plaines de l'Arcadie est une ville (on la nomme Tégée). La puissante nécessité y fait souffler deux vents. L'on y voit le type et l'antitype, le mal sur le mal. C'est là que le sein fécond de la terre enferme le fils d'Agamemnon. Si tu fais apporter ses ossements à Sparte, tu seras vainqueur de Tégée». Sur cette réponse, les Lacédémoniens se livrèrent avec encore plus d'ardeur aux recherches les plus exactes, furetant de tous côtés, jusqu'à ce qu'enfin Lichas, un des Spartiates appelés agathoerges, en fit la découverte. Les agathoerges sont toujours les plus anciens chevaliers à qui on a donné leur congé. Tous les ans on le donne à cinq, et, l'année de leur sortie, ils vont partout où les envoie la république, sans s'arrêter autre part.
LXVIII.De cet ordre était Lichas, qui fit à Tégée la découverte du tombeau d'Oreste, autant par hasard que par son habileté. Le commerce étant alors rétabli avec les Tégéates, il entra chez un forgeron, où il regarda battre le fer. Comme cela lui causait de l'admiration, le forgeron, qui s'en aperçut, interrompt son travail et lui dit : «Lacédémonien, vous auriez été bien plus étonné si vous aviez vu la même merveille que moi, vous pour qui le travail d'une forge est un sujet de surprise ! Creusant un puits dans cette cour, je trouvai un cercueil de sept coudées de long. Comme je ne pouvais me persuader qu'il eût jamais existé des hommes plus grands que ceux d'aujourd'hui, je l'ouvris. Le corps que j'y trouvai égalait la longueur du cercueil. Je l'ai mesuré, puis recouvert de terre». Lichas, faisant réflexion sur ce récit du forgeron, qui lui racontait ce qu'il avait vu, se douta que ce devait être le corps d'Oreste, indiqué par l'oracle. Ses conjectures lui montrèrent dans les deux soufflets les deux vents ; dans le marteau et l'enclume, le type et l'anti-type ; et le fer battu sur l'enclume le mal ajouté sur le mal, parce que le fer n'avait été découvert, suivant lui, que pour le malheur des hommes. L'esprit occupé de ces conjectures, Lichas revient à Sparte, et raconte son aventure à ses compatriotes. On lui intente une accusation simulée, il est banni. Lichas retourne à Tégée, conte sa disgrâce au forgeron, et fait ses efforts pour l'engager à lui louer sa cour. Le forgeron refuse d'abord ; mais s'étant ensuite laissé persuader, Lichas s'y loge, ouvre le tombeau et en tire les ossements d'Oreste, qu'il porte à Sparte. Les Lacédémoniens acquirent depuis ce temps une grande supériorité dans les combats, toutes les fois qu'ils s'essayèrent contre les Tégéates. D'ailleurs la plus grande partie du Péloponnèse leur était déjà soumise.
LXIX. Crésus, informé de toutes ces choses, envoya des ambassadeurs à Sparte avec des présents, pour prier les Lacédémoniens de s'allier avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés ils parlèrent en ces termes, qui leur avaient été prescrits : «Crésus, roi des Lydiens et de plusieurs autres nations, nous a envoyés ici, et vous dit par notre bouche : O Lacédémoniens, le dieu de Delpbes m'ayant ordonné de contracter amitié avec les Grecs, je m'adresse à vous conformément à l'oracle, parce que j'apprends que vous êtes les premiers peuples de la Grèce ; et je désire votre amitié et votre alliance, sans fraude ni tromperie». Tel fut le discours des ambassadeurs. Les Lacédémoniens, qui avaient aussi entendu la réponse faite à Crésus par l'oracle, se réjouirent de l'arrivée des Lydiens, et firent avec eux un traité d'amitié et d'alliance défensive et offensive. Ils avaient reçu auparavant quelques bienfaits de Crésus ; car les Lacédémoniens ayant envoyé à Sardes pour y acheter de l'or, dans l'intention de l'employer à cette statue d'Apollon qu'on voit aujourd'hui au mont Thornax, en Laconie, Crésus leur avait fait présent de cet or.
LXX. Tant de générosité, et la préférence qu'il leur donnait sur tous les Grecs, les déterminèrent à cette alliance. D'un côté, ils se tinrent prêts à lui donner du secours au premier avis ; d'un autre, ils lui firent faire un cratère de bronze, pour reconnaître les dons qu'ils en avaient reçus. Ce cratère tenait trois cents amphores. Il était orné extérieurement, et jusqu'au bord, d'un grand nombre d'animaux en relief. Mais il ne parvint point à Sardes, pour des raisons dites de deux manières, et que voici. Les Lacédémoniens assurent qu'il fut enlevé sur les côtes de Samos par des Samiens qui, ayant eu connaissance de leur voyage, les attaquèrent avec des vaisseaux de guerre. Mais les Samiens soutiennent que les Lacédémoniens chargés de ce cratère, n'ayant point fait assez de diligence, furent informés en route de la prise de Crésus et de celle de Sardes, et qu'ils le vendirent, à Samos, à des particuliers qui en firent une offrande au temple de Junon. Peut-être aussi ceux qui l'avaient vendu dirent-ils, à leur retour à Sparte, que les Samiens le leur avaient enlevé. Voilà comment les choses se sont passées au sujet du cratère.
LXXI. Crésus, n'ayant pas saisi le sens de l'oracle, se disposait à marcher en Cappadoce, dans l'espérance de renverser la puissance de Cyrus et des Perses. Tandis qu'il faisait les préparatifs nécessaires pour cette expédition, un Lydien nommé Sandanis, qui s'était déjà acquis la réputation d'homme sage, et qui se rendit encore plus célèbre parmi les Lydiens par le conseil qu'il donna à Crésus, parla ainsi à ce prince : «Seigneur, vous vous disposez à faire la guerre à des peuples qui ne sont vêtus que de peaux, qui se nourrissent, non de ce qu'ils voudraient avoir, mais de ce qu'ils ont, parce que leur pays est rude et stérile ; à des peuples qui, faute de vin, ne s'abreuvent que d'eau, qui ne connaissent ni les figues, ni aucun autre fruit agréable. Vainqueur, qu'enlèverez-vous à des gens qui n'ont rien ? Vaincu, considérez que de biens vous allez perdre ! S'ils goûtent une fois les douceurs de notre pays, ils ne voudront plus y renoncer ; nul moyen pour nous de les chasser. Quant à moi, je rends grâces aux dieux de ce qu'ils n'inspirent pas aux Perses le dessein d'attaquer les Lydiens». Sandanis ne persuada pas Crésus. Il disait pourtant vrai : les Perses, avant la conquête de la Lydie, ne connaissaient ni le luxe, ni même les commodités de la vie.
LXXII. Les Grecs donnent aux Cappadociens le nom de Syriens. Avant la domination des Perses, ces Syriens étaient sujets des Mèdes ; mais alors ils étaient sous l'obéissance de Cyrus, car l'Halys séparait les Etats des Mèdes de ceux des Lydiens. L'Halys coule d'une montagne d'Arménie (le Taurus) et traverse la Cilicie ; de là continuant son cours, il a les Matianiens a droite et les Phrygiens à gauche. A près avoir passé entre ces deux peuples, il coule vers le nord, renfermant d'un côté les Syriens cappadociens, et à gauche les Paphlagoniens. Ainsi le fleuve Halys sépare presque toute l'Asie mineure de la haute Asie, depuis la mer qui est vis-à-vis l'île de Cypre jusqu'au Pont-Euxin. Ce pays entier forme un détroit qui n'a que cinq journées de chemin, pour un bon marcheur.
LXXIII. Crésus partit donc avec son armée pour la Cappadoce, afin d'ajouter ce pays à ses Etals, animé surtout et par sa confiance en l'oracle, et par le désir de venger Astyages, son beau-frère. Astyages, fils de Cyaxare, roi des Mèdes, avait été vaincu et fait prisonnier par Cyrus, fils de Cambyse. Voici comment il était devenu beau-frère de Crésus. Une sédition avait obligé une troupe de Scythes nomades à se retirer secrètement sur les terres de Médie. Cyaxare, fils de Phraortes et petit-fils de Déjocès, qui régnait alors sur les Mèdes, les reçut d'abord avec humanité, comme suppliants ; et même il conçut tant d'estime pour eux, qu'il leur confia des enfants pour leur apprendre la langue scythe et à tirer de l'arc. Au bout de quelque temps, les Scythes, accoutumés à chasser et à rapporter tous les jours du gibier, revinrent une fois sans avoir rien pris. Revenus ainsi les mains vides, Cyaxare, qui était d'un caractère violent, comme il le montra, les traita de la manière la plus dure. Les Scythes, indignés d'un pareil traitement, qu'ils ne croyaient pas avoir mérité, résolurent entre eux découper par morceaux un des enfants dont on leur avait confié l'éducation, de le préparer de la manière qu'ils avaient coutume d'apprêter le gibier, de le servir à Cyaxare comme leur chasse, et de se retirer aussitôt à Sardes auprès d'Alyattes, fils de Sadyattes. Ce projet fut exécuté. Cyaxare et ses convives mangèrent de ce qu'on leur avait servi ; et les Scythes, après cette vengeance, se retirèrent auprès d'Alyattes, et ils devinrent ses suppliants.
LXXIV. Cyaxare les redemanda. Sur son refus, la guerre s'alluma entre ces deux princes. Pendant cinq années qu'elle dura, les Mèdes et les Lydiens eurent alternativement de fréquents avantages, et la sixième il y eut une espèce de combat nocturne : car, après une fortune égale de part et d'autre, s'étant livré bataille, le jour se changea tout à coup en nuit, pendant que les deux armées en étaient aux mains. Thales de Milet avait prédit aux Ioniens ce changement, et il en avait fixé le temps en l'année où il s'opéra. Les Lydiens et les Mèdes, voyant que la nuit avait pris la place du jour, cessèrent le combat, et n'en furent que plus empressés à faire la paix. Syennésis, roi de Cilicie, et Labynète, roi de Babylone, en furent les médiateurs ; ils hâtèrent le traité, et l'assurèrent par un mariage. Persuadés que les traités ne peuvent avoir de solidité sans un puissant lien, ils engagèrent Alyattes à donner sa fille Aryénis à Astyages, fils de Cyaxare. Ces nations observent dans leurs traités les mêmes cérémonies que les Grecs ; mais ils se font encore de légères incisions aux bras, et lèchent réciproquement le sang qui en découle.
LXXV. Cyrus tenait donc prisonnier Astyages, son aïeul maternel, qu'il avait détrôné pour les raisons que j'exposerai dans la suite de cette histoire. Crésus, irrité à ce sujet contre Cyrus, avait envoyé consulter les oracles pour savoir s'il devait faire la guerre aux Perses. Il lui était venu de Delphes une réponse ambiguë, qu'il croyait favorable, et là dessus il s'était déterminé à entrer sur les terres des Perses. Quand il fut arrivé sur les bords de l'Halys, il le fit, à ce que je crois, passer à son armée sur les ponts qu'on y voit à présent ; mais, s'il faut en croire la plupart des Grecs, Thales de Milet lui en ouvrit le passage. Crésus, disent-ils, étant embarrassé pour faire traverser l'Halys à son armée, parce que les ponts qui sont maintenant sur cette rivière n'existaient point encore en ce temps-la, Thales, qui était alors au camp, fit passer à la droite de l'armée le fleuve, qui coulait à la gauche. Voici de quelle manière il s'y prit. Il fit creuser, en commençant au-dessus du camp, un canal profond en forme de croissant, afin que l'armée pût l'avoir à dos dans la position où elle était. Le fleuve, ayant été détourné de l'ancien canal dans le nouveau, longea derechef l'armée, et rentra au-dessous de son ancien lit. Il ne fut pas plutôt partagé en deux bras, qu'il devint également guéable dans l'un et dans l'autre. Quelques-uns disent même que l'ancien canal fut mis entièrement à sec ; mais je ne puis approuver ce sentiment. Comment en effet Crésus et les Lydiens auraient-ils pu traverser le fleuve à leur retour ?
LXXVI. Après le passage de l'Halys, Crésus avec son armée arriva dans la partie de la Cappadoce appelée la Ptérie. La Ptérie, le plus fort canton de ce pays, est près de Sinope, ville presque située sur le Pont-Euxin. Il assit son camp en cet endroit, et ravagea les terres des Syriens. Il prit la ville des Ptériens, dont il réduisit les habitants en esclavage. Il s'empara aussi de toutes les bourgades voisines, en chassa les Syriens, et les transporta ailleurs, quoiqu'ils ne lui eussent donné aucun sujet de plainte. Cependant Cyrus assembla son armée, prit avec lui tout ce qu'il put trouver d'hommes sur sa route, et vint à sa rencontre. Mais, avant que de mettre ses troupes en campagne, il envoya des hérauts aux Ioniens, pour les engager à se révolter contre Crésus. N'ayant pu les persuader, il se mit en marche, et vint camper à la vue de l'ennemi. Les deux armées s'essayèrent mutuellement dans la Ptérie par de violentes escarmouches. On en vint ensuite à une action générale, qui fut vive, et où il périt beaucoup de monde des deux côtés ; enfin la nuit sépara les combattants, sans que la victoire se fût déclarée en faveur de l'un ou de l'autre parti.
LXXVII. Crésus se reprochant la disproportion de ses troupes, qui étaient beaucoup moins nombreuses que celles de Cyrus, et voyant que le lendemain ce prince ne tentait pas une nouvelle attaque, il retourna à Sardes, dans le dessein d'appeler à son secours les Egyptiens, conformément au traité conclu avec Amasis, leur roi, traité qui était antérieur à celui qu'il avait fait avec les Lacédémoniens. Il se proposait aussi de mander les Babyloniens, avec qui il s'était pareillement allié, et qui avaient alors pour roi Labynète, et de faire dire aux Lacédémoniens de se trouver à Sardes à un temps marqué. Il comptait passer l'hiver tranquillement, et marcher, à l'entrée du printemps, contre les Perses avec les forces de ces peuples réunies aux siennes. D'après ces dispositions, aussitôt qu'il fut de retour à Sardes, il envoya sommer ses alliés, par des hérauts, de se rendre à sa capitale le cinquième mois. Ensuite il congédia les troupes étrangères qu'il avait actuellement à sa solde, et qui s'étaient déjà mesurées contre les Perses, et les dispersa de tous côtés, ne s'imaginant pas que Cyrus, qui n'avait remporté aucun avantage sur lui, dût faire avancer son armée contre Sardes.
LXXVIII. Pendant que Crésus était occupe de ces projets, tous les dehors de la ville se remplirent de serpents ; et les chevaux, abandonnant les pâturages, coururent les dévorer. Ce spectacle, dont Crésus fut témoin, parut aux yeux de ce prince un prodige ; et, en effet, c'en était un. Aussitôt il envoya aux devins de Telmesse , pour en avoir l'interprétation. Ses députés l'apprirent, mais ils ne purent pas la lui communiquer ; car, avant leur retour par mer à Sardes, il avait été fait prisonnier. La réponse fut que Crésus devait s'attendre à voir une armée d'étrangers sur ses terres, et qu'elle subjuguerait les naturels du pays, le serpent étant fils de la terre, et le cheval un ennemi et un étranger. Crésus était déjà pris lorsqu'ils firent cette réponse ; mais ils ignoraient alors le sort de Sardes et du roi.
LXXIX. Lorsque Crésus, après la bataille de Ptérie, se fut retiré, Cyrus, instruit du dessein où il était de congédier ses troupes à son retour, crut, après en avoir délibéré, qu'il lui était avantageux de marcher avec la plus grande diligence vers Sardes, pour ne pas laisser aux Lydiens le temps d'assembler de nouvelles forces. Cette résolution prise, il l'exécuta sans délai, et, faisant passer son armée dans la Lydie, il porta lui-même à Crésus la nouvelle de sa marche. Ce prince, quoique fort inquiet de voir ses mesures déconcertées et son attente déçue, ne laissa pas de faire sortir les Lydiens et de les mener au combat. Il n'y avait point alors en Asie de nation plus brave ni plus belliqueuse que les Lydiens. Ils combattaient à cheval avec de longues piques, et étaient excellents cavaliers.
LXXX. Les deux armées se rendirent dans la plaine située sous les murs de Sardes, plaine spacieuse et découverte, traversée par l'Hyllus et par d'autres rivières qui se jettent dans l'Hennus, la plus grande de toutes. L'Hermus coule d'une montagne consacrée à Cybèle, et va se perdre dans la mer près de la ville de Phocée. A la vue de l'armée lydienne rangée en bataille dans cette plaine, Cyrus, craignant la cavalerie, suivit le conseil du Mède Harpage. Il rassembla tous les chameaux qui portaient à la suite de son armée les vivres et le bagage, et, leur ayant ôté leur charge, il les fit monter par des hommes vêtus en cavaliers, avec ordre de marcher en cet équipage à la tête des troupes, contre la cavalerie de Crésus. Il commanda en même temps à l'infanterie de suivre les chameaux, et posta toute la cavalerie derrière l'infanterie. Les troupes ainsi rangées, il leur ordonna de tuer tous les Lydiens qui se présenteraient devant eux, et de n'épargner que Crésus, quand même il se défendrait encore après avoir été pris. Tels furent les ordres de Cyrus. Il opposa les chameaux à la cavalerie ennemie, parce que le cheval craint le chameau, et qu'il n'en peut soutenir ni la vue ni l'odeur. Ce fut pour cela même qu'il imagina cette ruse dans la disposition de ses troupes, afin de rendre inutile la cavalerie, sur laquelle Crésus fondait l'espérance d'une victoire éclatante. Les deux armées s'étant avancées pour combattre, les chevaux n'eurent pas plutôt aperçu et senti les chameaux, qu'ils reculèrent, et les espérances de Crésus furent perdues. Les Lydiens cependant ne prirent pas pour cela l'épouvante. Ayant reconnu le stratagème, ils descendirent de cheval, et combattirent à pied contre les Perses ; mais enfin, après une perte considérable de part et d'autre, ils prirent la fuite et se renfermèrent dans leurs murailles, où les Perses les assiégèrent.
LXXXI. Crésus, croyant que ce siège traînerait en longueur, fit partir de la citadelle de nouveaux ambassadeurs vers ses alliés. Les premiers n'avaient fixé le rendez-vous à Sardes qu'au cinquième mois ; mais, ce prince étant assiégé, la commission de ceux-ci était de demander le plus prompt secours.
LXXXII. Il envoya vers différentes villes alliées, et particulièrement à Lacédémone. Dans ce même temps, il était aussi survenu une querelle entre les Spartiates et les Argiens, au sujet du lieu nommé Thyrée. Ce canton faisait partie de l'Argolide ; mais les Lacédémoniens l'en avaient retranché et se l'étaient approprié. Tout le pays vers l'occident jusqu'à Malée appartenait aussi aux Argiens, tant ce qui est en terre ferme que l'île de Cythère et les autres îles. Les Argiens étant venus au secours du territoire qu'on leur avait enlevé, on convint dans un pourparler qu'on ferait combattre trois cents hommes de chaque côté ; que ce territoire demeurerait au vainqueur ; que les deux armées ne seraient pas présentes au combat, mais se retireraient chacune dans son pays, de peur que le parti qui aurait le dessous ne fût secouru par les siens. Les deux armées se retirèrent après cet accord, et il ne resta que les guerriers choisis de part et d'autre. Ils combattirent des deux côtés avec tant d'égalité, que de six cents hommes il n'en resta que trois : Alcénor et Chromius du côté des Argiens, et Othryades de celui des Lacédémoniens ; et encore fallut-il que la nuit les séparât. Les deux Argiens coururent à Argos annoncer leur victoire. Pendant ce temps-là, Othryades, guerrier des Lacédémoniens, dépouilla les Argiens tués dans le combat, porta leurs armes à son camp, et se tint dans son poste. Le lendemain, les deux armées arrivent : instruites de l'événement, elles s'attribuent quelque temps la victoire : les Argiens, parce qu'ils avaient l'avantage du nombre ; les Lacédémoniens, parce que les combattants d'Argos avaient pris la fuite tandis que leur guerrier était resté dans son poste, et qu'il avait dépouillé leurs morts. Enfin, la dispute s'étant échauffée, on en vint aux mains ; et, après une perte considérable de part et d'autre, les Lacédémoniens furent vainqueurs. Depuis ce temps-là, les Argiens, qui jusqu'alors avaient été obligés de porter leurs cheveux, se rasèrent la tête ; et, par une loi accompagnée d'imprécations contre les infracteurs, ils défendirent aux hommes de laisser croître leurs cheveux, et aux femmes de porter des ornements d'or, avant qu'on eût recouvré Thyrée. Les Lacédémoniens, qui auparavant avaient des cheveux courts, s'imposèrent la loi contraire, celle de les porter fort longs. Quant à Othryades, resté seul des trois cents Lacédémoniens, on dit que, honteux de retourner à Sparte après la perte de ses compagnons, il se tua sur le champ de bataille, dans le territoire de Thyrée.
LXXXIII. Telle était la situation des affaires à Sparte, lorsqu'il arriva de Sardes un héraut pour prier les Spartiates de donner du secours à Crésus, qui était assiégé dans sa capitale. Sur cette demande, on ne balança pas à lui en envoyer. Déjà les troupes étaient prêtes et les vaisseaux équipés : un autre courrier apporta la nouvelle que la ville des Lydiens était prise et que Crésus avait été fait prisonnier. Les Spartiates en furent très affligés, et se tinrent en repos.
LXXXIV. Voici la manière dont la ville de Sardes fut prise. Le quatorzième jour du siège, Cyrus fit publier, par des cavaliers envoyés par tout le camp, qu'il donnerait une récompense à celui qui monterait le premier sur la muraille. Animée par ces promesses, l'armée fit des tentatives, mais sans succès : on cessa les attaques ; le seul Hyroeadès, Marde de nation, entreprit de monter à un certain endroit de la citadelle où il n'y avait point de sentinelles. On ne craignait pas que la ville fût jamais prise de ce côté. Escarpée, inexpugnable, cette partie de la citadelle était la seule par où Mélès, autrefois roi de Sardes, n'avait point fait porter le lion qu'il avait eu d'une concubine. Les devins de Telmisse lui avaient prédit que Sardes serait imprenable, si l'on portait le lion autour des murailles. Sur cette prédiction, Mélès l'avait fait porter partout où l'on pouvait attaquer et forcer la citadelle. Mais il avait négligé le côté qui regarde le mont Tmolos, comme imprenable et inaccessible. Hyroeadès avait aperçu la veille un Lydien descendre de la citadelle par cet endroit, pour ramasser son casque qui était roulé du haut en bas, et l'avait vu remonter ensuite par le même chemin. Cette observation le frappa, et lui fit faire des réflexions. Il y monta lui-même, et d'autres Perses après lui, qui furent suivis d'une grande multitude. Ainsi fut prise Sardes, et la ville entière livrée au pillage.
LXXXV. Quant à Crésus, voici quel fut son sort. Il avait un fils, dont j'ai déjà fait mention. Ce fils avait toutes sortes de bonnes qualités, mais il était muet. Dans le temps de sa prospérité, Crésus avait mis tout en usage pour le guérir, et, entre autres moyens, il avait eu recours à l'oracle de Delphes. La Pythie avait répondu : «Lydien, roi de plusieurs peuples, insensé Crésus, ne souhaite pas d'entendre en ton palais la voix tant désirée de ton fils. Il te serait plus avantageux de ne jamais l'entendre : il commencera de parler le jour où commenceront tes malheurs». Après la prise de la ville, un Perse allait tuer Crésus sans le connaître. Ce prince le voyait fondre sur lui ; mais, accablé du poids de ses malheurs, il négligeait de l'éviter, et peu lui importait de périr sous ses coups. Le jeune prince muet, à la vue du Perse qui se jetait sur son père, saisi d'effroi, fit un effort qui lui rendit la voix : «Soldat, s'écria-t-il, ne tue pas Crésus !» Tels furent ses premiers mots ; et il conserva la faculté de parler le reste de sa vie.
LXXXVI. A la prise de Sardes les Perses ajoutèrent celle de Crésus, qui tomba vif entre leurs mains. Il avait régné quatorze ans, soutenu un siège d'autant de jours, et, conformément à l'oracle, détruit son grand empire. Les Perses qui l'avaient fait prisonnier le menèrent à Cyrus. Celui-ci le fit monter, chargé de fers, et entouré de quatorze jeunes Lydiens, sur un grand bûcher dressé exprès, soit pour sacrifier à quelques dieux ces prémices de la victoire, soit pour accomplir un voeu, soit enfin pour éprouver si Crésus, dont on vantait la piété, serait garanti des flammes par quelque divinité. Ce fut ainsi, dit-on, qu'il le traita. Crésus, sur le bûcher, malgré son accablement et l'excès de sa douleur, se rappela ces paroles de Solon, que nul homme ne peut se dire heureux tant qu'il respire encore ; et il lui vint à l'esprit que ce n'était pas sans la permission des dieux que ce sage les avait proférées. On assure qu'à cette pensée, revenu à lui-même, il sortit par un profond soupir du long silence qu'il avait gardé, et s'écria par trois fois : «Solon !» que Cyrus, frappé de ce nom, lui fit demander par ses interprètes quel était celui qu'il invoquait. Ils s'approchent, et l'interrogent. Crésus, d'abord, ne répondit pas ; forcé de parler, il dit : «C'est un homme dont je préférerais l'entretien aux richesses de tous les rois». Ce discours leur paraissant obscur, ils l'interrogèrent de nouveau. Vaincu par l'importunité de leurs prières, il répondit qu'autrefois Solon d'Athènes était venu à sa cour ; qu'ayant contemplé toutes ses richesses, il n'en avait fait aucun cas ; que tout ce qu'il lui avait dit se trouvait confirmé par l'événement, et que les avertissemenls de ce philosophe ne le regardaient pas plus, lui en particulier, que tous les hommes en général, et principalement ceux qui se croyaient heureux. Ainsi parla Crésus. Le feu était déjà allumé, et le bûcher s'enflammait par les extrémités. Cyrus, apprenant de ses interprètes la réponse de ce prince, se repent ; il songe qu'il est homme, et que cependant il fait brûler un homme qui n'avait pas été moins heureux que lui. D'ailleurs il redoute la vengeance des dieux, et, réfléchissant sur l'instabilité des choses humaines, il ordonne d'éteindre promptement le bûcher, et d'en faire descendre Crésus, ainsi que ses compagnons d'infortune ; mais les plus grands efforts ne purent surmonter la violence des flammes.
LXXXVII. Alors Crésus, comme le disent les Lydiens instruit du changement de Cyrus à la vue de cette foule empressée à éteindre le feu sans pouvoir y réussir, improre à grands cris Apollon ; le conjure, si ses offrandes lui ont été agréables, de le secourir, de le sauver d'un péril si pressant. Ces prières étaient accompagnées de larmes. Soudain, au milieu d'un ciel pur et serein, des nuages se rassemblent, un orage crève, une pluie abondante éteint le bûcher. Ce prodige apprit à Cyrus combien Crésus était cher aux dieux par sa vertu. Il le fait descendre du bûcher, et lui dit : «0 Crésus ! quel homme vous a conseillé d'entrer sur mes terres avec une armée, et de vous déclarer mon ennemi au lieu d'être mon ami ? - Votre heureux destin et mon infortune m'ont jeté, seigneur, dans cette malheureuse entreprise. Le dieu des Grecs en est la cause ; lui seul m'a persuadé de vous attaquer. Eh ! quel est l'homme assez insensé pour préférer la guerre à la paix ? Dans la paix, les enfants ferment les yeux à leurs pères ; dans la guerre, les pères enterrent leurs enfants. Mais enfin il a plu aux dieux que les choses se passassent de la sorte».
LXXXVIII. Après ce discours, Cyrus lui fit ôter ses fers et asseoir près de lui. Il le traita avec beaucoup d'égards, et ne put, lui et toute sa cour, l'envisager sans étonnement. Crésus, livré à ses pensées, gardait le silence. Bientôt, en retournant la tête, il aperçoit les Perses empressés au pillage de Sardes : «Seigneur, s'adressant à Cyrus, dois-je vous dire ce que je pense, ou mon état actuel me condamne-t-il à me taire ?» Cyrus lui ordonne de parler avec assurance. «Eh bien ! lui demande Crésus, cette multitude, que fait-elle avec tant d'ardeur ? - Elle pille votre capitale, elle enlève vos richesses. - Non, seigneur, ce n'est point ma ville, ce ne sont pas mes trésors qu'on pille. Rien de tout cela ne m'appartient plus ; c'est votre bétail qu'on emmène, ce sont vos richesses qu'on emporte».
LXXXIX. Cyrus, frappé de cette réponse, écarte tout le monde, et demande à Crésus le parti qu'il faut prendre dans cette conjoncture. «Seigneur, répondit-il, puisque les dieux m'ont rendu votre esclave, je me crois obligé de vous avertir de ce qui peut vous être le plus avantageux, lorsque je l'aperçois mieux que vous. Les Perses, naturellement insolents, sont pauvres : si vous souffrez qu'ils pillent cette ville et qu'ils en retiennent le butin, il est probable, et vous devez vous y attendre, que celui qui en aura fait le plus grand n'en sera que plus disposé à la révolte. Si donc vous goûtez mes conseils, ordonnez à quelques-uns de vos gardes de se tenir aux portes de la ville et d'ôter le butin à vos troupes, parce qu'il faut, leur diront-ils, en consacrer la dixième partie à Jupiter. Par ce moyen, vous ne vous attirerez point la haine de vos soldats, quoique vous le leur enleviez de force ; et lorsqu'ils viendront à connaître que vous ne leur demandez rien que de juste, ils obéiront volontiers».
XC. Ce discours fit à Cyrus le plus grand plaisir : il trouva le conseil très sage ; il en combla l'auteur de louanges ; et, après avoir donné à ses gardes les ordres que lui avait suggérés Crésus, il s'adresse à lui : «Crésus, dit-il, puisque vos discours et vos actions me prouvent que vous êtes disposé à vous conduire en roi sage, demandez-moi ce qu'il vous plaira, vous l'obtiendrez sur-le-champ. - Seigneur, répondit Crésus, la plus grande faveur serait de me permettre d'envoyer au dieu des Grecs, celui de tous les dieux que j'ai le plus honoré, les fers que voici, avec ordre de lui demander s'il lui est permis de tromper ceux qui ont bien mérité de lui». Le roi l'interroge, pour savoir quel sujet il avait de s'en plaindre et quel était le motif de sa demande. Crésus répéta les projets qu'il avait eus, et l'entretint des réponses des oracles, de ses offrandes surtout, et des prédictions qui l'avaient animé à la guerre contre les Perses. Il finit en lui demandant de nouveau la permission d'envoyer faire au dieu des reproches. «Non seulement cette permission, dit en riant Cyrus ; mais ce que vous souhaiterez désormais, je vous l'accorde». A ces mots, Crésus envoie des Lydiens à Delphes, avec ordre de placer ses fers sur le seuil du temple, de demander au dieu s'il ne rougissait pas d'avoir par ses oracles excité Crésus à la guerre contre les Perses, dans l'espoir de ruiner l'empire d eCyrus ; de lui montrer ses chaînes, seules prémices qu'il pût lui offrir de cette expédition, et de lui demander si les dieux des Grecs étaient dans l'usage d'être ingrats.
XCI. Les Lydiens ayant exécuté à leur arrivée à Delphes les ordres de Crésus, on assure que la Pythie leur fit cette réponse : «Il est impossible même à un dieu d'éviter le sort marqué par les destins. Crésus est puni du crime de son cinquième ancêtre, qui, simple garde d'un roi de la race des Héraclides, se prêta aux instigations d'une femme artificieuse, tua son maître et s'empara de la couronne, à laquelle il n'avait aucun droit. Apollon a mis tout en usage pour détourner de Crésus le malheur de Sardes, et ne le faire tomber que sur ses enfants ; mais il ne lui a pas été possible de fléchir les Parques. Tout ce qu'elles ont accordé à ses prières, il en a gratifié ce prince. Il a reculé de trois ans la prise de Sardes. Que Crésus sache donc qu'il a été fait prisonnier trois ans plus tard qu'il n'était porté par les destins. En second lieu, il l'a secouru lorsqu'il allait devenir la proie des flammes. Quant à l'oracle rendu, Crésus a tort de se plaindre. Apollon lui avait prédit qu'en faisant la guerre aux Perses, il détruirait un grand empire : s'il eût voulu prendre sur cette réponse un parti salutaire, il aurait dû envoyer demander au dieu s'il entendait l'empire des Lydiens ou celui de Cyrus. N'ayant ni saisi le sens de l'oracle ni fait interroger de nouveau le dieu, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Il n'a pas non plus, en dernier lieu, compris la réponse d'Apollon relativement au mulet. Cyrus était ce mulet, les auteurs de ses jours étant de deux nations différentes : son père était d'une origine moins illustre que sa mère ; celle-ci était Mède et fille d'Astyages, roi des Mèdes ; l'autre, Perse et sujet de la Médie ; et, quoique inférieur en tout, il avait cependant épousé sa souveraine». Les Lydiens s'en retournèrent à Sardes avec cette réponse de la Pythie, et la communiquèrent à Crésus. Alors il reconnut que c'était sa faute, et non celle du dieu. Quant à l'empire de Crésus et au premier asservissement de l'Ionie, les choses sont de la sorte.
XCII. Les offrandes dont j'ai parlé ne sont pas les seules que Crésus fit aux dieux. On en voit encore plusieurs autres en Grèce. Il fit présent à Thèbes, en Béotie, d'un trépied d'or qu'il consacra à Apollon Isménien ; à Ephèse, des génisses d'or et de la plupart des colonnes du temple ; et il envoya à celui de Minerve Pronaia, à Delphes, un grand bouclier d'or. Ces dons subsistaient encore de mon temps ; il s'en est perdu plusieurs autres. Quant à ceux qu'il donna aux Branchides, dans le pays des Milésiens, ils étaient, autant que j'ai pu le savoir, semblables à ceux qu'il fit à Delphes, et de même poids. Les présents qu'il envoya à Delphes et au temple d'Amphiaraüs venaient de son propre bien ; c'étaient les prémices de son patrimoine. Les autres, au contraire, provenaient des biens d'un ennemi qui avait formé un parti contre lui avant son avènement à la couronne, et qui avait pris avec chaleur les intérêts de Pantaleon, qu'il voulait placer sur le trône de Lydie. Pantaleon était fils d'Alyattes et frère de Crésus, mais d'une autre mère ; car Crésus était né d'une Carienne, et Pantaleon d'une Ionienne. Crésus ne se vit pas plutôt en possession de la couronne que son père lui avait donnée, qu'il fit périr cruellement celui qui avait formé un parti contre lui. Quant aux biens de ce conspirateur, qu'il avait destinés auparavant à être offerts aux dieux, il les envoya alors, comme nous l'avons dit, aux temples que nous venons de nommer. Mais en voilà assez sur les offrandes de Crésus.
XCIII. La Lydie n'offre pas, comme certains autres pays, des merveilles qui méritent place dans l'histoire, sinon les paillettes d'or détachées du Tmolus par les eaux du Pactole. On y voit cependant un ouvrage bien supérieur à ceux que l'on admire ailleurs (j'en excepte toutefois les monuments des Egyptiens et des Babyloniens) : c'est le tombeau d'Alyattes, père de Crésus. Le pourtour est composé de grandes pierres, et le reste de terre amoncelée. Il a été construit aux frais des marchands qui vendent sur la place, des artisans et des courtisanes. Cinq termes, placés au haut du monument, subsistaient encore de mon temps, et marquaient par des inscriptions la portion que chacune de ces trois classes avait fait bâtir. D'après les mesures, la portion des courtisanes était visiblement la plus considérable ; car toutes les filles, dans le pays des Lydiens, se livrent à la prostitution : elles y gagnent leur dot, et continuent ce commerce jusqu'à ce qu'elles se marient. Elles ont le droit de choisir leurs époux. Ce monument a six stades deux plèthres de tour, et treize plèthres de largeur. Tout auprès est un grand lac qui ne tarit jamais, à ce que disent les Lydiens. On l'appelle le lac Gygée : cela est tel. Les lois des Lydiens ressemblent beaucoup à celles des Grecs, excepté dans ce qui regarde la prostitution des filles. De tous les peuples que nous connaissions, ce sont les premiers qui aient frappé, pour leur usage, des monnaies d'or et d'argent, et les premiers aussi qui aient fait le métier de revendeurs. A les en croire, ils sont les inventeurs des différents jeux actuellement en usage tant chez eux que chez les Grecs ; et ils ajoutent que, vers le temps où ces jeux furent inventés, ils envoyèrent une colonie dans la Tyrrhénie. Voici comment ils racontent ce fait.
XCIV. Sous le règne d'Atys, fils de Manès, toute la Lydie fut affligée d'une grande famine, que les Lydiens supportèrent quelque temps avec patience. Mais, voyant que le mal ne cessait point, ils y cherchèrent remède, et chacun en imagina à sa manière. Ce fut à cette occasion qu'ils inventèrent les dés, les osselets, la balle, et toutes les autres sortes de jeux, excepté celui des jetons, dont ils ne s'attribuent pas la découverte. Or, voici l'usage qu'ils firent de cette invention pour tromper la faim qui les pressait. On jouait alternativement pendant un jour entier, afin de se distraire du besoin de manger, et, le jour suivant, on mangeait au lieu de jouer. Ils menèrent cette vie pendant dix-huit ans ; mais enfin, le mal, au lieu de diminuer, prenant de nouvelles forces, le roi partagea tous les Lydiens en deux classes, et les fit tirer au sort, l'une pour rester, l'autre pour quitter le pays. Celle que le sort destinait à rester eut pour chef le roi même, et son fils Tyrrhénus se mit à la tête des émigrants. Les Lydiens que le sort bannissait de leur patrie allèrent d'abord à Smyrne, où ils construisirent des vaisseaux, les chargèrent de tous les meubles et instruments utiles, et s'embarquèrent pour aller chercher des vivres et d'autres terres. Après avoir côtoyé différents pays, ils abordèrent en Ombrie, où ils se bâtirent des villes, qu'ils habitent encore à présent ; mais ils quittèrent le nom de Lydiens, et prirent celui de Tyrrhéniens, de Tyrrhénus, fils de leur roi, qui était le chef de la colonie.
XCV. On a vu les Lydiens subjugués par les Perses ; mais quel était ce Cyrus qui détruisit l'empire de Crésus ? Comment les Perses obtinrent-ils la souveraineté de l'Asie ? Ce sont des détails qu'exige l'intelligence de cette histoire. Je prendrai pour modèles quelques Perses qui ont moins cherché à relever les actions de Cyrus qu'à écrire la vérité, quoique je n'ignore point qu'il y ait sur ce prince trois autres sentiments. Il y avait cinq cent vingt ans que les Assyriens étaient les maîtres de la haute Asie, lorsque les Mèdes commencèrent les premiers à se révolter. En combattant pour la liberté contre les Assyriens, les Mèdes s'aguerrirent, et parvinrent à secouer le joug et à se rendre indépendants. Les autres nations les imitèrent.
XCVI. Tous les peuples de ce continent se gouvernèrent d'abord par leurs propres lois ; mais voici comment ils retombèrent sous la tyrannie. Il y avait chez les Mèdes un sage, nommé Déjocès ; il était fils de Phraortes. Ce Déjocès, épris de la royauté, s'y prit ainsi pour y parvenir. Les Mèdes vivaient dispersés en bourgades. Déjocès, considéré depuis longtemps dans la sienne, y rendait la justice avec d'autant plus de zèle et d'application que dans toute la Médie les lois étaient méprisées, et qu'il savait que ceux qui sont injustement opprimés détestent l'injustice. Les habitants de sa bourgade, témoins de ses moeurs, le choisirent pour juge. Déjocès, qui aspirait à la royauté, faisait paraître dans toutes ses actions de la droiture et de la justice. Cette conduite lui attira de grands éloges de la part de ses concitoyens. Les habitants des autres bourgades, jusqu'alors opprimés par d'injustes sentences, apprenant que Déjocès jugeait seul conformément aux règles de l'équité, accoururent avec plaisir à son tribunal, et ne voulurent plus enfin être jugés par d'autres que par lui.
XCVII. La foule des clients augmentait tous les jours par la persuasion où l'on était de l'équité de ses jugements. Quand Déjocès vit qu'il portait seul tout le poids des affaires, il refusa de monter sur le tribunal sur lequel il avait jusqu'alors rendu la justice, et renonça formellement à ses fonctions. Il prétexta le tort qu'il se faisait à lui-même en négligeant ses propres affaires, tandis qu'il passait les jours entiers à terminer les différends d'autrui. Les brigandages et l'anarchie régnèrent donc dans les bourgades avec plus de violence que jamais. Les Mèdes s'assemblèrent, et tinrent conseil sur leur état actuel. Les amis de Déjocès y parlèrent, comme je le pense, à peu près en ces termes : «Puisque la vie que nous menons ne nous permet plus d'habiter ce pays, choisissons un roi : la Médie étant alors gouvernée par de bonnes lois, nous pourrons cultiver en paix nos campagnes, sans craindre d'en être chassés par l'injustice et la violence». Ce discours persuada les Mèdes de se donner un roi.
XCVIII. Aussitôt on délibéra sur le choix. Toutes les louanges, tous les suffrages se réunirent en faveur de Déjocès : il fut élu roi d'un consentement unanime. Il commanda qu'on lui bâtît un palais conforme à sa dignité, et qu'on lui donnât des gardes pour la sûreté de sa personne. Les Mèdes obéirent : on lui construisit à l'endroit qu'il désigna un édifice vaste et bien fortifié, et on lui permit de choisir dans toute la nation des gardes à son gré. Ce prince ne se vit pas plutôt sur le trône, qu'il obligea ses sujets à se bâtir une ville, à l'orner et à la fortifier, sans s'inquiéter des autres places. Les Mèdes, dociles à cet ordre, élevèrent cette ville forte et immense connue aujourd'hui sous le nom d'Agbatanes, dont les murs concentriques sont renfermés l'un dans l'autre et construits de manière que chaque enceinte ne surpasse l'enceinte voisine que de la hauteur des créneaux. L'assiette du lieu, qui s'élève en colline, en facilita les moyens. On fit encore quelque chose de plus : il y avait en tout sept enceintes, et dans la dernière le palais et le trésor du roi. Le circuit de la plus grande égale à peu près celui d'Athènes. Les créneaux de la première enceinte sont peints en blanc ; ceux de la seconde, en noir ; ceux de la troisième, en pourpre ; ceux de la quatrième, en bleu ; ceux de la cinquième sont d'un rouge orangé. C'est ainsi que les créneaux de toutes les enceintes sont ornés de différentes couleurs. Quant aux deux dernières, les créneaux de l'une sont argentés, et ceux de l'autre dorés.
XCIX. Tels furent et le palais que se fit construire Déjocès et les maisons dont il l'environna. Le reste du peuple eut ordre de se loger autour de la muraille. Tous ces édifices achevés, il fut le premier qui établit pour règle que personne n'entrerait chez le roi, que toutes les affaires s'expédieraient par l'entremise de certains officiers qui lui en feraient leur rapport, que personne ne regarderait le roi ; il ordonna outre cela qu'on ne rirait ni ne cracherait en sa présence, et qu'il serait honteux à tout le monde de faire ces choses en présence les uns des autres. Déjocès institua ce cérémonial imposant, afin que les personnes du même âge que lui, et avec qui il avait été élevé, et que ceux dont la naissance n'était pas moins distinguée que la sienne, et qui ne lui étaient inférieurs ni en bravoure ni en mérite, ne lui portassent point envie et ne conspirassent point contre sa personne. Il croyait qu'en se rendant invisible à ses sujets il passerait pour un être d'une espèce différente.
C. Ces règlements faits et son autorité affermie, il rendit sévèrement la justice. Les procès lui étaient envoyés par écrit : il les jugeait et les renvoyait avec sa décision. Telle était sa méthode pour les procès. Quant à la police, s'il apprenait que quelqu'un eût fait une injure, il le mandait, et lui infligeait une peine proportionnée au délit ; et pour cet effet il avait dans tous ses Etats des émissaires qui veillaient sur les actions et les discours de ses sujets.
CI. Déjocès rassembla tous les Mèdes en un seul corps, et ne régna que sur eux. Cette nation comprend plusieurs peuples : les Buses, les Parétacéniens, les Struchates, les Arizantes, les Budiens, les Mages. Ce sont là les peuples des Mèdes.
CII. Déjocès mourut après un règne de cinquante-trois ans. Son fils Phraortes lui succéda. Le royaume de Médie ne suffit pas à son ambition. Il attaqua d'abord les Perses, et ce fut le premier peuple qu'il assujettit. Avec ces deux nations, l'une et l'autre très puissantes, il subjugua ensuite l'Asie, et marcha de conquête en conquête jusqu'à son expédition contre les Assyriens et contre la partie de cette même nation qui habitait Ninive. Quoique les Assyriens, autrefois maîtres de l'Asie, fussent alors seuls et abandonnés de leurs alliés, qui avaient secoué le joug, ils se trouvaient cependant encore dans un état florissant. Phraortes périt dans cette expédition avec la plus grande partie de son armée, après avoir régné vingt-deux ans.
CIII. Ce prince étant mort, Cyaxare son fils, et petit-fils de Déjocès, lui succéda. On dit qu'il fut encore plus belliqueux que ses pères. Il sépara le premier les peuples d'Asie en différents corps de troupes, et assigna aux piquiers, à la cavalerie, aux archers, chacun un rang à part : avant lui tous les ordres étaient confondus. Ce fut lui qui fit la guerre aux Lydiens, et qui leur livra une bataille pendant laquelle le jour se changea en nuit. Ce fut encore lui qui, après avoir soumis toute l'Asie au-dessus du fleuve Halys, rassembla toutes les forces de son empire, et marcha contre Ninive, résolu de venger son père par la destruction de cette ville. Déjà il avait vaincu les Assyriens en bataille rangée, déjà il assiégeait Ninive, lorsqu'il fut assailli par une nombreuse armée de Scythes, ayant à leur tête Madyas, leur roi, fils de Protothyès. C'était en chassant d'Europe les Cimmériens qu'ils s'étaient jetés sur l'Asie : la poursuite des fuyards les avait conduits jusqu'au pays des Mèdes.
CIV. Du Palus-Méotis au Phase et à la Colchide, on compte trente journées pour quelqu'un qui marche bien. Pour se rendre de la Colchide en Médie, on passe des montagnes ; et le trajet n'est pas long, car il ne se trouve entre ces deux pays que celui des Sapires. Lorsqu'on l'a traversé, on est sur les terres des Mèdes. Les Scythes néanmoins n'y entrèrent pas de ce côté ; mais ils passèrent plus haut et par une route beaucoup plus longue, laissant le mont Caucase sur leur droite. Les Mèdes ayant livré bataille aux Scythes, la perdirent avec l'empire de l'Asie.
CV. Les Scythes, maîtres de toute l'Asie, marchèrent de là en Egypte ; mais, quand ils furent dans la Syrie de Palestine, Psammitichus, roi d'Egypte, vint au-devaut d'eux, et, à force de présents et de prières, il les détourna d'aller plus avant. Ils revinrent donc sur leurs pas, et passèrent par Ascalon, en Syrie, d'où ils sortirent la plupart sans y faire aucun dégât, à l'exception de quelques-uns d'entre eux qui, ayant été laissés en arrière, pillèrent le temple de Vénus Uranie. Ce temple, autant que je l'ai pu savoir par mes informations, est le plus ancien de tous les temples de cette déesse. Celui de Cypre lui doit son origine, de l'aveu même des Cypriens. Celui de Cythère a été aussi bâti par des Phéniciens originaires de cette Syrie. La déesse envoya une maladie de femme à ceux d'entre les Scythes qui avaient pillé le temple d'Ascalon, et ce châtiment s'étendit à jamais sur leur postérité. Les Scythes disent que cette maladie est une punition de ce sacrilège, et que les étrangers qui voyagent dans leur pays s'aperçoivent de l'état de ceux que les Scythes appellent Enarées.
CVI. Les Scythes conservèrent vingt-huit ans l'empire de l'Asie. Ils ruinèrent tout par leur violence et leur négligence. Outre les tributs ordinaires, ils exigeaient encore de chaque particulier un impôt arbitraire ; et, indépendamment de ces contributions, ils parcouraient tout le pays, pillant et enlevant à chacun ce qui lui appartenait. Cyaxare et les Mèdes, en ayant invité chez eux la plus grande partie, les massacrèrent après les avoir enivrés. Les Mèdes recouvrèrent par ce moyen et leurs Etats et l'empire sur les pays qu'ils avaient auparavant possédés. Ils prirent ensuite la ville de Ninive. Quant à la manière dont ils s'en rendirent maîtres, j'en parlerai dans un autre ouvrage. Enfin, ils subjuguèrent les Assyriens, excepté le pays de Babylone. Ces conquêtes achevées, Cyaxare mourut. Il avait régné quarante ans, y compris le temps que dura la domination des Scythes.
CVII. Astyages, son fils, lui succéda. Il naquit à ce prince une fille, qu'il nomma Mandane. Il s'imagina en dormant qu'elle urinait en si grande abondance, que sa capitale et l'Asie entière en étaient inondées. Ayant communiqué ce songe à ceux d'entre les mages qui faisaient profession de les interpréter, il fut effrayé des détails de leur explication ; et il le fut au point que, lorsque sa fille fut nubile, il ne voulut pas lui donner pour époux un Mède digne de lui par sa naissance ; mais il lui fit épouser un Perse, nommé Cambyse, qu'il connaissait pour un homme d'une grande maison et de moeurs douces et tranquilles, parce qu'il le regardait comme bien inférieur à un Mède de médiocre condition.
CVIII. La première année du mariage de Cambyse avec Mandane, Astyages eut un autre songe : il lui sembla voir sortir du sein de sa fille une vigne qui couvrait toute l'Asie. Ayant communiqué ce songe aux interprètes, il fit venir de Perse Mandane, sa fille, qui était enceinte et proche de son terme. Aussitôt après son arrivée, il la fit garder, dans le dessein de faire périr l'enfant dont elle serait mère ; les mages, interprètes des songes, lui ayant prédit, d'après cette vision, que l'enfant qui naîtrait de cette princesse régnerait un jour à sa place. Comme Astyagesse tenait en garde contre cet événement, Cyrus fut à peine né, qu'il manda Harpage, son parent, celui de tous les Mèdcs qui lui était le plus attaché, et sur lequel il se reposait du soin de toutes ses affaires. «Harpage, lui dit-il, exécute fidèlement l'ordre que je vais te donner, sans chercher à me tromper, de crainte qu'en rattachant à d'autres maîtres que moi tu ne travailles à ta propre perte. Prends l'enfant qui vient de naître de Mandane, porte-le dans ta maison, fais-le mourir, et l'inhume ensuite comme il te plaira. - Seigneur, répondit Harpage, j'ai toujours cherché à vous plaire, et je ferai mon possible pour ne jamais vous offenser. Si vous voulez que l'enfant meure, j'obéirai exactement à vos ordres, du moins autant qu'il dépendra de moi».
CIX. Après cette réponse, on remit l'enfant, couvert de riches ornements, entre les mains d'Harpage, afin qu'il le fît mourir. Il s'en retourna chez lui les larmes aux yeux ; et, en abordant sa femme, il lui raconta tout ce qu'Astyages lui avait dit. «Quelle est votre résolution ? reprit-elle. - Je n'exécuterai point les ordres d'Astyages, répondit-il, dût-il devenir encore plus emporté et plus furieux qu'il ne l'est maintenant ; je n'obéirai point à ses volontés, je ne me prêterai point à ce meurtre. Non, je ne le ferai point, par plusieurs raisons : premièrement, je suis parent de l'enfant ; secondement, Astyages est avancé en âge, et n'a point d'enfant mâle. Si, après sa mort, la couronne passe à la princesse sa fille, dont il veut aujourd'hui que je fasse mourir le fils, que me reste-t-il, sinon la perspective du plus grand danger ? Pour ma sûreté, il faut que l'enfant périsse ; mais que ce soit par les mains de quelqu'un des gens d'Astyage, et non par le ministère des miens».
CX. I1 dit, et sur-le-champ il envoya un exprès à celui des bouviers d'Astyages qu'il savait mener ses troupeaux dans les meilleurs pâturages, et sur les montagnes les plus fréquentées par les bêtes sauvages. Il s'appelait Mitradates. Sa femme, esclave d'Astyages ainsi que lui, se nommait Spaco, nom qui, dans la langue des Mèdes, signifie la même chose que Cyno dans celle des Grecs ; car les Mèdes appellent une chienne spaco. Les pâturages où il gardait les boeufs du roi étaient au pied des montagnes, au nord d'Agbatanes, et vers le Pont-Euxin. De ce côté-là, vers les Sapires, la Médie est un pays élevé, rempli de montagnes et couvert de forêts, au lieu que le reste du royaume est plat et uni. Le bouvier, que l'on avait mandé en diligence, étant arrivé, Harpage lui parla ainsi : «Astyages te commande de prendre cet enfant, et de l'exposer sur la montagne la plus déserte, afin qu'il périsse promptement. Il m'a ordonné aussi de te dire que, si tu ne le fais pas mourir, et que tu lui sauves la vie de quelque manière que ce soit, il te fera périr par le supplice le plus cruel. Ce n'est pas tout : il veut encore que je sache par moi-même si tu as exposé cet enfant».
CXI. Aussitôt Mitradates prit l'enfant, et retourna dans sa cabane par le même chemin. Tandis qu'il allait à la ville, sa femme, qui n'attendait de jour en jour que le moment d'accoucher, mit au monde un fils, par une permission particulière des dieux. Ils étaient inquiets l'un de l'autre, le mari craignant pour sa femme, prête à accoucher, la femme pour son mari, parce qu'Harpage n'avait pas coutume de le mander. Dès qu'il fut de retour, sa femme, surprise de le voir au moment où elle s'y attendait le moins, lui parla la première, et voulut savoir pourquoi Harpagc l'avait envoyé chercher avec tant d'empressement. «Ma femme, lui dit-il, je n'ai pas plutôt été dans la ville, que j'ai vu et entendu des choses que je voudrais bien n'avoir ni vues ni entendues ; et plût aux dieux qu'elles ne fussent jamais arrivées à nos maîtres ! Toute la maison d'Harpage était en pleurs. Frappé d'effroi, je pénètre dans l'intérieur : je vois à terre un enfant qui pleurait, qui palpitait. Il était couvert de drap d'or et de langes de diverses couleurs. Harpage ne m'eut pas plutôt aperçu qu'il me commanda d'emporter promptement cet enfant, et de l'exposer sur la montagne la plus fréquentée par les bêtes féroces. Il m'a assuré que c'était Astyages lui-même qui me donnait cet ordre, et m'a fait de grandes menaces si je manquais à l'exécuter. J'ai donc pris cet enfant et l'ai emporté, croyant qu'il était à quelqu'un de sa maison ; car je n'aurais jamais imaginé quel était son véritable père. J'étais cependant étonné de le voir couvert d'or et de langes si précieux. Je ne l'étais pas moins de voir toute la maison d'Harpage en pleurs. Enfin, chemin faisant, j'ai bientôt appris du domestique qui m'a accompagné hors de la ville, et qui m'a remis l'enfant, qu'il est à Mandane, fille d'Astyages, et à Cambyse, fils de Cyrus, et qu'Astyages ordonne qu'on le fasse mourir. Le voici, cet enfant».
CXII. En achevant ces mots, Mitradates découvre l'enfant, et le montre à sa femme. Charmée de sa grandeur et de sa beauté, elle embrasse les genoux de son mari, et le supplie, les larmes aux yeux, de ne point exposer cet enfant. Il lui dit qu'il ne pouvait s'en dispenser, qu'il devait venir des surveillants de la part d'Harpage, et que, s'il n'obéissait pas, il périrait de la manière la plus cruelle. Spaco, voyant que ses discours ne faisaient aucune impression sur son mari, reprit la parole : «Puisque je ne saurais, dit-elle, te persuader, et qu'il faut absolument qu'on voie un enfant exposé, fais du moins ce que je vais te dire. Je suis accouchée d'un enfant mort : va le porter sur la montagne, et nourrissons celui de la fille d'Astyages comme s'il était à nous. Par ce moyen, on ne pourra te convaincre d'avoir offensé tes maîtres, et nous aurons pris un bon parti : notre enfant mort aura une sépulture royale, et celui qui reste ne perdra point la vie».
CXIII. Le bouvier sentit que, dans cette conjoncture, sa femme avait raison ; et sur-le-champ il suivit son conseil. Il lui remet l'enfant qu'il avait apporté pour le faire mourir, prend le sien qui était mort, le met dans le berceau du jeune prince avec tous ses ornements, et va l'exposer sur la montagne la plus déserte. Le troisième jour après, ayant laissé, pour garder le corps, un de ceux qui avaient soin des troupeaux sous ses ordres, il alla à la ville, et, s'étant rendu chez Harpage, il lui dit qu'il était prêta lui montrer le corps mort de l'enfant. Harpage, ayant envoyé avec lui ses gardes les plus affidés, fit, sur leur rapport, donner la sépulture au fils de Mitradates. A l'égard du jeune prince, Spaco en prit soin et l'éleva. Il fut dans la suite connu sous le nom de Cyrus ; mais Spaco lui donna quelque autre nom.
CXIV. Cet enfant, étant âgé de dix ans, eut une aventure qui le fit reconnaître. Un jour que, dans le village où étaient les troupeaux du roi, il jouait dans la rue avec d'autres enfants de son âge, ceux-ci l'élurent pour leur roi, lui qui était connu sous le nom de fils du bouvier. Il distribuait aux uns les places d'intendants de ses bâtiments, aux autres celles de gardes du corps ; celui-ci était l'oeil du roi, celui-là devait lui présenter les requêtes des particuliers : chacun avait son emploi, selon ses talents et le jugement qu'en portait Cyrus. Le fils d'Artembarès, homme de distinction chez les Mèdes, jouait avec lui. Ayant refusé d'exécuter ses ordres, Cyras le fit saisir par les autres enfants, et maltraiter à coups de verges. On ne l'eut pas plutôt relâché, qu'outré d'un traitement si indigne de sa naissance, il alla à la ville porter ses plaintes à son père contre Cyrus. Ce n'est pas qu'il lui donnât ce nom, Cyrus ne le portait point encore ; mais il l'appelait le fils du bouvier d'Astyages. Dans la colère où était Artembarès, il alla trouver le roi avec son fils, et se plaignit du traitement odieux qu'il avait reçu. «Seigneur, dit-il en découvrant les épaules de son fils, c'est ainsi que nous a outragés un de vos esclaves, le fils de votre bouvier».
CXV. A ce discours, à cette vue, Astyages, voulant venger le fils d'Artembarès, par égard pour le père, envoya chercher Mitradates et son fi1s. Lorsqu'ils furent arrivés : «Comment, dit le prince à Cyrus en le regardant, étant ce que tu es, as-tu eu l'audace de traiter d'une manière si indigne le fils d'un des premiers de ma cour ? - Je l'ai fait, seigneur, avec justice, répondit Cyrus. Les enfants du village, du nombre desquels il était, m'avaient choisi en jouant pour être leur roi ; je leur en paraissais le plus digne : tous exécutaient mes ordres. Le fils d'Artembarès n'y eut aucun égard, et refusa de m'obéir. Je l'en ai puni : si cette action mérite quelque châtiment, me voici prêt à le subir».
CXVI. La ressemblance des traits de cet enfant avec les siens, sa réponse noble, son âge qui s'accordait avec le temps de l'exposition de son petit-fils, tout concourait, en un mot, à le faire reconnaître d'Astyages. Frappé de ces circonstances, ce prince demeura quelque temps sans pouvoir parler ; mais enfin, revenu à lui, et voulant renvoyer Artembarès, afin de sonder Mitradates en particulier : «Artembarès, lui dit-il, vous n'aurez aucun sujet de vous plaindre de moi, ni vous, ni votre fils». Ensuite il ordonna à ses officiers de conduire Cyrus dans l'intérieur du palais. Resté seul avec Mitradates, il lui demanda où il avait pris cet enfant, et de qui il le tenait. Celui-ci répondit qu'il en était le père, que sa mère vivait encore, et demeurait avec lui. Astyages répliqua qu'il ne prenait pas un bon parti, et qu'il voulait de gaîté de coeur se rendre malheureux. En disant cela, il fit signe à ses gardes de le saisir. Mitradates, voyant qu'on le menait à la question, avoua enfin la vérité. Il reprit l'histoire dès son commencement, découvrit tout sans rien dissimuler, et, descendant aux plus humbles supplications, il pria le roi de lui pardonner.
CXVII. La vérité découverte, Astyages ne tint pas grand compte de Mitradates ; mais, violemment irrité contre Harpage, il commanda à ses gardes de le faire venir ; et lorsqu'il parut devant lui, il lui parla en ces termes : «Harpage, de quel genre de mort as-tu fait périr l'enfant de ma fille, que je t'ai remis ?» Harpage, apercevant Mitradates dans l'appartement du roi, avoua tout sans détour, de crainte d'être convaincu par des preuves sans répliques. «Seigneur, dit-il, quand j'eus reçu l'enfant, j'examinai comment je pourrais, en me conformant à vos volontés, et sans m'écarter de ce que je vous dois, n'être coupable d'un meurtre ni à l'égard de la princesse votre fille, ni même au vôtre. Je mandai en conséquence Mitradates : je lui remis l'enfant entre les mains, et lui dis que c'était vous-même qui ordonniez sa mort. Je ne me suis point écarté en cela de la vérité, puisque vous m'aviez commandé de le faire mourir. En lui livrant cet enfant, je lui enjoignis de l'exposer sur une montagne déserte, et de rester auprès de lui jusqu'à ce qu'il fût mort. Enfin, je le menaçai des plus rigoureux tourments s'il n'accomplissait tout de point en point. Ces ordres exécutés, et l'enfant étant mort, j'envoyai là les plus fidèles de mes eunuques ; je vis par leurs yeux, et je l'enterrai. Les choses, seigneur, se sont passées de cette manière, et tel est le sort qu'a éprouvé cet enfant».
CXVIII. Harpage parla sans détour ; mais Astyages, dissimulant son ressentiment, lui répéta d'abord toute l'histoire comme il l'avait apprise de Mitradates ; et, après qu'il l'eut répétée, il ajouta que l'enfant vivait, et qu'il en était content. «Car enfin, dit-il, la manière dont on l'avait traité me faisait beaucoup de peine, et j'étais très sensible aux reproches de ma fille. Mais, puisque la fortune nous a été favorable, envoyez-moi votre fils pour tenir compagnie au jeune prince nouvellement arrivé, et ne manquez pas de venir souper avec moi ; je veux offrir, pour le recouvrement de mon petit-fils, des sacrifices aux dieux, à qui cet honneur est réservé».
CXIX. Harpage s'étant, à ces paroles, prosterné devant le roi, s'en retourna chez lui, également flatté de l'heureuse issue de sa faute, et de ce que le roi l'avait invité au festin qu'il donnait en réjouissance des bienfaits de la fortune. Il ne fut pas plutôt entré chez lui, qu'il appela sou fils unique, âgé d'environ treize ans, l'envoya au palais d'Astyages, avec ordre de faire tout ce que ce prince lui commanderait ; et, transporté de joie, il raconta cette aventure à sa femme. Dès que le fils d'Harpage fut arrivé au palais, Astyages le fit égorger ; on le coupa ensuite par morceaux, dont les uns furent rôtis et bouillis ; on les apprêta de diverses manières, et on tint le tout prêt à être servi. L'heure du repas venue, les convives s'y rendirent, et Harpage avec eux. On servit à Astyages et aux autres seigneurs du mouton, et à Harpage le corps de son fils, excepté la tête et les extrémités des mains et des pieds, que le roi avait fait mettre à part dans une corbeille couverte. Lorsqu'il parut avoir assez mangé, Astyages lui demanda s'il était content de ce repas. «Très content», répondit Harpage. Aussitôt ceux qui en avaient reçu l'ordre, apportant dans une corbeille couverte la tête, les mains et les pieds de son fils, et se tenant devant lui, lui dirent de la découvrir, et d'en prendre ce qu'il voudrait. Harpage obéit, et, découvrant la corbeille, il aperçut les restes de son fils. Il ne se troubla point, et sut se posséder. Astyages lui demanda s'il savait de quel gibier il avait mangé. Il répondit qu'il le savait, mais que tout ce que faisait un roi lui était agréable. Après cette réponse, il s'en retourna chez lui avec les restes de son fils, qu'il n'avait, à ce que je pense, rassemblés que pour leur donner la sépulture.
CXX. Le roi, s'étant ainsi vengé d'Harpage, manda les mêmes mages qui avaient interprété son songe de la manière que nous avons dit, afin de délibérer avec eux sur ce qui concernait Cyrus. Les mages arrivés, il leur demanda quelle explication ils avaient autrefois donnée du songe qu'il avait eu. Ils lui firent la même réponse : «Si l'enfant, dirent-ils, n'est pas mort, en un mot, s'il vit encore, il faut qu'il règne. - L'enfant vit et se porte bien, leur dit Astyages ; il a été élevé à la campagne : les enfants de son village l'ont élu pour leur roi. Il a fait tout ce que font les véritables rois ; il s'est donné des gardes du corps, des gardes de la porte, des officiers pour lui faire le rapport des affaires ; en un mot, il a créé toutes les autres charges. Que pensez-vous que cela puisse présager ? - Puisque l'enfant vit, répondirent les mages, et qu'il a régné sans aucun dessein prémédité, rassurez-vous, seigneur, vous n'avez plus rien à craindre, il ne régnera pas une seconde fois. Il y a des oracles dont l'accomplissemcnt s'est réduit à un événement frivole, et des songes qui ont abouti à bien peu de chose. - Je suis moi-même aussi de cet avis, reprit Astyages ; l'enfant ayant déjà porté le nom de roi, le songe est accompli ; je crois n'en avoir plus rien à craindre. Cependant réfléchissez-y mûrement, et donnez-moi le conseil que vous penserez le plus avantageux à votre sûreté et à la mienne. - Seigneur, dirent les mages, la stabilité et la prospérité de votre règne nous importent beaucoup ; car enfin la puissance souveraine, venant à tomber entre les mains de cet enfant qui est Perse, passerait à une autre nation ; et les Perses, nous regardant comme des étrangers, n'auraient pour nous aucune considération, et nous traiteraient en esclaves. Mais vous, seigneur, qui êtes notre compatriote, tant que vous occuperez le trône, vous nous comblerez de faveurs, et nous régnerons en partie avec vous. Ainsi notre intérêt nous oblige, à tous égards, à pourvoir à votre sûreté et à celle de votre empire. Si nous pressentions maintenant quelque danger, nous aurions grand soin de vous en avertir ; mais, puisque l'issue de votre songe est frivole, nous nous rassurons, et nous vous exhortons à vous tranquilliser de même : éloignez de vous cet enfant, et renvoyez-le en Perse à ceux dont il tient le jour».
CXXI. Astyages, charmé de cette réponse, manda Cyrus. «Mon fils, lui dit-il, je vous ai traité avec injustice, sur la foi d'un vain songe ; mais enfin votre heureux destin vous a conservé, et vous vivez. Soyez tranquille ; partez pour la Perse, escorté par ceux que je vous donnerai pour vous accompagner : vous y verrez votre père et votre mère, qui sont bien différents de Mitradates et de sa femme».
CXXII. Astyages, ayant ainsi parlé, renvoya Cyrus en Perse. Cambyse et Mandane, ayant appris ce qu'il était, le reçurent et l'embrassèrent, comme un enfant qu'ils avaient cru mort en naissant. Ils lui demandèrent comment il avait été conservé : Cyrus leur répondit que jusqu'alors il l'avait ignoré, et qu'à cet égard il avait été dans une très grande erreur ; qu'en chemin il avait été instruit de ses malheurs ; qu'il s'était cru fils du bouvier d'Astyages, mais que, depuis son départ, il avait tout appris de ses conducteurs. Il leur conta comment il avait été nourri par Cyno, la femme du bouvier, dont il ne cessait de se louer et de répéter le nom. Son père et sa mère, se servant de ce nom pour persuader aux Perses que leur fils avait été conservé par une permission particulière des dieux, publièrent partout que Cyrus ayant été exposé dans un lieu désert, une chienne l'avait nourri. Voila ce qui donna lieu au bruit qui courut.
CXXIII. Cyrus étant parvenu à l'âge viril, comme il était le plus brave et le plus aimable des jeunes gens de son âge, Harpage, qui désirait ardemment se venger d'Astyages, lui envoyait des présents, et le pressait de le seconder. Etant d'une condition privée, il ne voyait pas qu'il lui fût possible de se venger par lui-même de ce prince ; mais ayant observé que Cyrus, en croissant, lui donnait l'espoir de la vengeance, et venant à comparer les aventures de ce prince et ses malheurs avec les siens, il s'attacha à lui et se l'associa. Il avait déjà pris quelques mesures, et il avait su profiter des traitements trop rigoureux que le roi faisait aux Mèdes, pour s'insinuer dans l'esprit des grands, et leur persuader d'ôter la couronne à Astyages, et de la mettre sur la tête de Cyrus. Cette trame ourdie, et tout étant prêt, Harpage voulut découvrir à Cyrus son projet ; mais comme ce prince était en Perse, et que les chemins étaient gardés, il ne put trouver, pour lui en faire part, d'autre expédient que celui-ci. S'étant fait apporter un lièvre, il ouvrit le ventre de cet animal d'une manière adroite, et sans en arracher le poil ; et, dans l'état où il était, il y mit une lettre où il avait écrit ce qu'il avait jugé à propos. L'ayant ensuite recousu, il le remit à celui de ses domestiques en qui il avait le plus de confiance, avec un filet, comme s'il eût été un chasseur, et lui ordonna de vive voix de le porter en Perse à Cyrus, et de lui dire, en le lui présentant, de l'ouvrir lui-même et sans témoins.
CXXIV. Le domestique ayant exécuté ses ordres, Cyrus ouvrit le lièvre, et y ayant trouvé une lettre, il la lut. Elle était conçue en ces termes : «Fils de Cambyse, les dieux veillent sur vous ; autrement vous ne seriez jamais parvenu à un si haut degré de fortune. Vengez-vous d'Astyages, votre meurtrier : il a tout fait pour vous ôter la vie : si vous vivez, c'est aux dieux et à moi que vous le devez. Vous avez sans doute appris, il y a longtemps, tout ce qu'il a fait pour vous perdre, et ce que j'ai souffert moi-même pour vous avoir remis à Mitradates, au lieu de vous faire mourir. Si vous voulez suivre aujourd'hui mes conseils, tous les Etats d'Astyages seront à vous. Portez les Perses à secouer le joug, venez à leur tête attaquer les Mèdes ; l'entreprise vous réussira, soit qu'Astyages me donne le commandement des troupes qu'il enverra contre vous, soit qu'il le confie à quelque autre des plus distingués d'entre les Mèdes. Les principaux de la nation seront les premiers à l'abandonner ; ils se joindront à vous, et feront les plus grands efforts pour détruire sa puissance. Tout est ici disposé pour l'exécution. Faites donc ce que je vous mande, et faites-le sans différer».
CXXV. Cyrus, ayant lu cette lettre, ne songea plus qu'à chercher les moyens les plus sages pour engager les Perses à se révolter. Après y avoir bien réfléchi, voici ce qu'il imagina de plus expédient, et il s'y tint. Il écrivit une lettre conforme à ses vues, l'ouvrit dans l'assemblée des Perses, et leur en fit lecture. Elle portait qu'Astyages le déclarait leur gouverneur. «Maintenant donc, leur dit-il, je vous commande de vous rendre tous ici chacun avec une faux». Tels furent les ordres de Cyrus. Les tribus qui composent la nation perse sont en grand nombre. Cyrus en convoqua quelques-unes, et les porta à se soulever contre les Mèdes. Ce sont celles qui ont le plus d'influence sur tous les autres Perses, savoir, les Pasargades, les Maraphiens et les Maspiens. Les Pasargades sont les plus illustres ; les Achéménides, d'où descendent les rois de Perse, en sont une branche. Les Panthialéens, les Dérusiéens, les Germaniens, sont tous laboureurs. Les autres, savoir, les Daens, les Mardes, les Dropiques et les Sagartiens, sont nomades, et ne s'occupent que de leurs troupeaux.
CXXVI. Lorsqu'ils se furent tous présentés armés de faux, Cyrus, leur montrant un certain canton de la Perse, d'environ dix-huit à vingt stades, entièrement couvert de ronces et d'épines, leur commanda de l'essarter tout entier en un jour. Ce travail achevé, il leur ordonna de se baigner le lendemain, et de se rendre ensuite auprès de lui. Cependant, ayant fait mener au même endroit tous les troupeaux de son père, tant de chèvres que de moutons et de boeufs, il les fit tuer et apprêter. Outre cela, il fit apporter du vin et les mets les plus exquis, pour régaler l'armée. Le lendemain, les Perses étant arrivés, il les fit asseoir sur l'herbe, et leur donna un grand festin. Le repas fini, Cyrus leur demanda laquelle de ces deux conditions leur paraissait préférable, la présente, ou celle de la veille. Ils s'écrièrent qu'il y avait une grande différence entre l'une et l'autre : que le jour précédent ils avaient éprouvé mille peines, au lieu qu'actuellement ils goûtaient toutes sortes de biens et de douceurs. Cyrus saisit cette réponse pour leur découvrir ses projets. «Perses, leur dit-il, tel est maintenant l'état de vos affaires : si vous voulez m'obéir, vous jouirez de ces biens, et d'une infinité d'autres encore, sans être exposés à des travaux serviles. Si, au contraire, vous ne voulez pas suivre mes conseils, vous ne derez attendre que des peines sans nombre, et pareilles à celles que vous souffrîtes hier. Devenez donc libres en m'obéissant ; car il semble que je sois né, par un effet particulier de la bonté des dieux, pour vous faire jouir de ces avantages : et d'ailleurs je ne vous crois nullement inférieurs aux Mèdes, soit dans ce qui concerne la guerre, soit en toute autre chose. Secouez donc au plus tôt le joug sous lequel Astyages vous tient asservis».
CXXVII. Les Perses, qui depuis longtemps étaient indignés de se voir assujettis aux Mèdes, ayant trouvé un chef, saisirent avec plaisir l'occasion de se mettre en liberté. Astyages, ayant eu connaissance des menées de Cyrus, le manda auprès de lui par un exprès. Cyrus commanda au porteur de cet ordre de lui dire qu'il irait le trouver plus tôt qu'il ne souhaitait. Sur cette réponse, Astyages fit prendre les armes à tous les Mèdes ; et, comme si les dieux lui eussent ôté le jugement, il donna le commandement de son armée à Harpage, ne se souvenant plus de la manière dont il l'avait traité. Les Mèdes, s'étant mis en campagne, en vinrent aux mains avec les Perses. Tous ceux à qui Harpage n'avait point fait part de ses projets se battirent avec courage. Quant aux autres, il y en eut une partie qui passa d'elle-même du côté des Perses ; mais le plus grand nombre se comporta lâchement de dessein prémédité.
CXXVIII. Astyages n'eut pas plutôt appris la déroute honteuse des Mèdes, et que son armée était entièrement dissipée, qu'il s'emporta en menaces contre Cyrus. «Non, dit-il, Cyrus n'aura pas sujet de s'en réjouir». Il n'en dit pas davantage ; mais il commença par faire mettre en croix les mages, interprètes des songes, qui lui avaient conseillé de laisser partir Cyrus. Il fit ensuite prendre les armes à ce qui restait de Mèdes dans la ville, jeunes et vieux, les mena contre les Perses, et leur livra bataille. Il la perdit, avec la plus grande partie de ses troupes, et tomba lui-même entre les mains des ennemis.
CXXIX. Harpage, charmé de le voir dans les fers, se présenta devant lui, l'insulta ; et, entre autres reproches, lui ayant rappelé ce repas où il avait fait servir la chair de son fils, il lui demanda quel goût il trouvait à l'esclavage qui en était une suite, et s'il le préférait à une couronne. Astyages lui demanda à son tour s'il s'attribuait l'entreprise de Cyrus. Harpage reprit qu'il le pouvait avec justice, puisque c'était lui qui l'avait préparée en écrivant à ce prince. Astyages lui fit voir qu'il était le plus inconséquent et le plus injuste de tous les hommes : le plus inconséquent, puisque, pouvant se faire roi, si du moins il était l'auteur de la révolte actuelle, il avait mis la couronne sur la tête d'un autre ; et le plus injuste, puisque, pour le repas dont il s'agissait, il avait réduit les Mèdes en servitude. En effet, s'il était absolument nécessaire de donner la couronne à un autre, et s'il ne voulait pas la garder pour lui-même, il aurait été plus juste de la mettre sur la tête d'un Mède que sur celle d'un Perse ; qu'enfin il avait donné des fers à sa patrie, quoiqu'elle ne fût point coupable ; et qu'il avait rendu les Perses maîtres des Mèdes, eux qui en avaient été les esclaves.
CXXX. Astyages perdit ainsi la couronne, après un règne de trente-cinq ans. Les Mèdes, qui avaient possédé cent vingt-huit ans l'empire de la haute Asie, jusqu'au fleuve Halys, sans cependant y comprendre le temps qu'y régnèrent les Scythes, passèrent sous le joug des Perses à cause de l'inhumanité de ce prince. Il est vrai que, s'en étant repentis par la suite, ils le secouèrent sous Darius ; mais, ayant été vaincus dans un combat, ils furent de nouveau subjugués. Cyrus et les Perses, s'étant alors soulevés contre les Mèdes sous le règne d'Astyages, furent dès lors maîtres de l'Asie. Quant à Astyages, Cyrus le retint près de lui jusqu'à sa mort, et ne lui fit point d'autre mal. Telles furent la naissance de Cyrus, son éducation, et la manière dont il monta sur le trône. Il battit dans la suite Crésus, qui lui avait fait le premier une guerre injuste, comme je l'ai déjà dit, et par la défaite de ce prince il devint maître de toute l'Asie.
CXXXI. Voici les coutumes qu'observent, à ma connaissance, les Perses. Leur usage n'est pas d'élever aux dieux des statues, des temples, des autels ; ils traitent au contraire d'insensés ceux qui le font : c'est, à mon avis, parce qu'ils ne croient pas, comme les Grecs, que les dieux aient une forme humaine. Ils ont coutume de sacrifier à Jupiter sur le sommet des plus hautes montagnes, et donnent le nom de Jupiter à toute la circonférence du ciel. Ils font encore des sacrifices au Soleil, à la Lune, à la Terre, au Feu, à l'Eau et aux Vents, et n'en offrent de tout temps qu'à ces divinités. Mais ils y ont joint dans la suite le culte de Vénus Céleste ou Uranie, qu'ils ont emprunté des Assyriens et des Arabes. Les Assyriens donnent à Vénus le nom de Mylitta, les Arabes celui d'Alitta, et les Perses l'appellent Mitra.
CXXXII. Voici les rites qu'observent les Perses en sacrifiant aux dieux dont je viens de parler. Quand ils veulent leur immoler des victimes, ils ne dressent point d'autel, n'allument point de feu, ne font pas de libations, et ne se servent ni de flûtes, ni de bandelettes sacrées, ni d'orge mêlée avec du sel. Un Perse veut-il offrir un sacrifice à quelqu'un de ces dieux, il conduit la victime dans un lieu pur, et, la tête couverte d'une tiare couronnée le plus ordinairement de myrte, il invoque le dieu. Il n'est pas permis à celui qui offre le sacrifice de faire des voeux pour lui seul en particulier ; il faut qu'il prie pour la prospérité du roi et celle de tous les Perses en général, car il est compris sous cette dénomination. Après qu'il a coupé la victime par morceaux, et qu'il en a fait bouillir la chair, il étend de l'herbe la plus tendre, et principalement du trèfle. Il pose sur cette herbe les morceaux de la victime, et les y arrange. Quand il les a ainsi placés, un mage, qui est là présent (car sans mage il ne leur est pas permis d'offrir un sacrifice), un mage, dis-je, entonne une théogonie ; c'est le nom qu'ils donnent à ce chant. Peu après, celui qui a offert le sacrifice emporte les chairs de la victime, et en dispose comme il jugea propos.
CXXXIII. Les Perses pensent devoir célébrer plus particulièrement le jour de leur naissance que tout autre, et qu'alors leur table doit être garnie d'un plus grand nombre de mets. Ce jour-là, les gens heureux se font servir un cheval, un chameau, un âne et un boeuf entiers, rôtis aux fourneaux. Les pauvres se contentent de menu bétail. Les Perses mangent peu de viande, mais beaucoup de dessert, qu'on apporte en petite quantité à la fois. C'est ce qui leur fait dire que les Grecs en mangeant cessent seulement d'avoir faim, parce qu'après le repas on ne leur sert rien de bon, et que, si on leur en servait, ils ne cesseraient pas de manger. Ils sont fort adonnés au vin, et il ne leur est pas permis de vomir ni d'uriner devant le monde. Ils observent encore aujourd'hui ces usages. Ils ont coutume de délibérer sur les affaires les plus sérieuses après avoir bu avec excès ; mais, le lendemain, le maître de la maison où ils ont tenu conseil remet la même affaire sur le tapis avant que de boire. Si on l'approuve à jeun, elle passe ; sinon on l'abandonne. Il en est de même des délibérations faites à jeun ; on les examine de nouveau lorsqu'on a bu avec excès.
CXXXIV. Quand deux Perses se rencontrent dans les rues, on distingue s'ils sont de même condition, car ils se saluent en se baisant à la bouche ; si l'un est d'une naissance un peu inférieure à l'autre, ils se baisent seulement à la joue; et si la condition de l'un est fort au-dessous de celle de l'autre, l'inférieur se prosterne devant le supérieur. Les nations voisines sont celles qu'ils estiment le plus, toutefois après eux-mêmes. Celles qui les suivent occupent le second rang dans leur esprit ; et, réglant ainsi leur estime proportionnellement au degré d'éloignement, ils font le moins de cas des plus éloignées. Cela vient de ce que, se croyant en tout d'un mérite supérieur, ils pensent que le reste des hommes ne s'attache à la vertu que dans la proportion dont on vient de parler, et que ceux qui sont les plus éloignés d'eux sont les plus méchants. Sous l'empire des Mèdes, il y avait de la subordination entre les divers peuples. Les Mèdes les gouvernaient tous ensemble, aussi bien que leurs plus proches voisins. Ceux-ci commandaient à ceux qui étaient dans leur proximité, et ces derniers à ceux qui les touchaient. Les Perses, dont l'empire et l'administration s'étendent au loin, ont aussi dans la même proportion des égards pour les peuples qui leur sont soumis.
CXXXV. Les Perses sont les hommes les plus curieux des usages étrangers. Ils ont pris en effet l'habillement des Mèdes, s'imaginant qu'il est plus beau que le leur ; et dans la guerre ils se servent de cuirasses à l'égyptienne. Ils se portent avec ardeur aux plaisirs de tous genres dont ils entendent parler, et ils ont emprunté des Grecs l'amour des garçons. Ils épousent chacun plusieurs jeunes vierges, mais ils ont encore un plus grand nombre de concubines.
CXXXVI. Après les vertus guerrières, ils regardent comme un grand mérite d'avoir beaucoup d'enfants. Le roi gratifie tous les ans ceux qui en ont le plus. C'est dans le grand nombre qu'ils font consister la force. Ils commencent à cinq ans à les instruire, et depuis cet âge jusqu'à vingt ils ne leur apprennent que trois choses : ç montera cheval, à tirer de l'arc et à dire la vérité. Avant l'âge de cinq ans un enfant ne se présente pas devant son père, il reste entre les mains des femmes. Cela s'observe afin que, s'il meurt dans ce premier âge, sa perte ne cause aucun chagrin au père.
CXXXVII. Cette coutume me paraît louable ; j'approuve aussi la loi qui ne permet a personne, pas même au roi, de faire mourir un homme pour un seul crime, ni à aucun Perse de punir un de ses esclaves d'une manière trop atroce pour une seule faute. Mais si, par un examen réfléchi, il se trouve que les fautes du domestique soient en plus grand nombre et plus considérables que ses services, son maître peut alors suivre les mouvements de sa colère. Ils assurent que jamais personne n'a tué ni son père ni sa mère, mais que, toutes les fois que de pareils crimes sont arrivés, on découvre nécessairement, après d'exactes recherches, que ces enfants étaient supposés ou adultérins. Car il est, continuent-ils, contre toute vraisemblance qu'un enfant tue les véritables auteurs de ses jours.
CXXXVIII. Il ne leur est pas permis de parler des choses qu'il n'est pas permis de faire. Ils ne trouvent rien de si honteux que de mentir, et, après le mensonge, que de contracter des dettes ; et cela pour plusieurs raisons, mais surtout parce que, disent-ils, celui qui a des dettes ment nécessairement. Un citoyen infecté de la lèpre proprement dite, ou de l'espèce de lèpre appelée leucé, ne peut entrer dans la ville, ni avoir aucune communication avec le reste des Perses ; c'est, selon eux, une preuve qu'il a péché contre le Soleil. Tout étranger attaqué de ces maladies est chassé du pays ; et, par la même raison, ils n'y veulent point souffrir de pigeons blancs. Ils n'urinent ni ne crachent dans les rivières ; ils ne s'y lavent pas même les mains, et ne permettent pas que personne y fasse rien de semblable ; car ils rendent un culte aux fleuves.
CXXXIX. Ils ont aussi quelque chose de singulier qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, mais qui ne nous a point échappé. Leurs noms, qui sont empruntés ou des qualités du corps ou de la dignité des personnes, se terminent par cette même lettre que les Doriens appellent san, et les Ioniens sigma ; et, si vous y faites attention, vous trouverez que les noms des Perses finissent tous de la même manière, sans en excepter un seul.
CXL. Ces usages m'étant connus, je puis en parler d'une manière affirmative ; mais ceux qui se pratiquent relativement aux morts étant cachés, on n'en peut rien dire de certain. Ils prétendent qu'on n'enterre point le corps d'un Perse qu'il n'ait été auparavant déchiré par un oiseau ou par un chien. Quant aux mages, j'ai la certitude qu'ils observent cette coutume, car ils la pratiquent à la vue de tout le monde. Une autre chose que je puis assurer, c'est que les Perses enduisent de cire les corps morts, et qu'ensuite ils les mettent en terre. Les mages diffèrent beaucoup des autres hommes, et particulièrement des prêtres d'Egypte. Ceux-ci ont toujours les mains pures du sang des animaux, et ne tuent que ceux qu'ils immolent aux dieux. Les mages, au contraire, tuent de leurs propres mains toutes sortes d'animaux, à la réserve de l'homme et du chien ; ils se font même gloire de tuer également les fourmis, les serpents et autres animaux, tant reptiles que volatiles. Mais, quant à cet usage, laissons-le tel qu'il a été originairement établi, et reprenons le fil de notre narration.
CXLI. Les Lydiens n'eurent pas plutôt été subjugués par les Perses, que les Ioniens et les Eoliens envoyèrent à Sardes des ambassadeurs à Cyrus, pour le prier de les recevoir au nombre de ses sujets aux mêmes conditions qu'ils l'avaient été de Crésus. Ce prince répondit à leur proposition par cet apologue : Un joueur de flûte, leur dit-il, ayant aperçu des poissons dans la mer, joua de la flûte, s'imaginant qu'ils viendraient à terre ; se voyant trompé dans son attente, il prit un filet, enveloppa une grande quantité de poissons qu'il tira sur le bord, et, comme il les vit sauter : «Cessez, leur dit-il, cessez maintenant de danser, puisque vous n'avez pas voulu le faire au son de la flûte». Il tint ce discours aux Ioniens et aux Eoliens, parce que, ayant fait auparavant solliciter les Ioniens par ses envoyés d'abandonner le parti de Crésus, il n'avait pu les y engager, et qu'il ne les voyait disposés à lui obéir que parce qu'il était venu à bout de toutes ses entreprises. Telle fut la réponse qu'il leur fit dans sa colère. Sur le rapport des députés, les Ioniens fortifièrent chacun leurs villes, et s'assemblèrent tous au Panionium, à la réserve des Milésiens, les seuls avec qui Cyrus fit un traité aux mêmes conditions que celles qui leur avaient été accordées par Crésus. Dans ce conseil, il fut unanimement résolu d'envoyer demander du secours à Sparte.
CXLII. Ces Ioniens, à qui appartient aussi le Panionium, ont bâti leurs villes dans la contrée la plus agréable que je connaisse, soit pour la beauté du ciel, soit pour la température des saisons. En effet, les pays qui environnent l'Ionie, soit au-dessus, soit au-dessous, à l'est ou à l'ouest, ne peuvent entrer en comparaison avec elle, les uns étant exposés aux pluies et au froid, les autres aux chaleurs et à la sécheresse. Ces Ioniens n'ont pas le même dialecte ; leurs mots ont quatre sortes de terminaisons. Milet est la première de leurs villes du côté du midi, et ensuite Myonte et Priène : elles sont en Carie, et leur langage est le même. Ephese, Colophon, Lébédos, Téos, Clazomènes, Phocée, sont en Lydie. Elles parlent entre elles une même langue, mais qui ne s'accorde en aucune manière avec celle des villes que je viens de nommer. Il y a encore trois autres villes ioniennes, dont deux sont dans les îles de Samos et de Chios ; et la troisième, qu'on appelle Erythrée, est en terre ferme. Le langage de ceux de Chios et d'Erythrée est le même ; mais les Samiens ont eux seuls une langue particulière. Tels sont les quatre idiomes qui caractérisent l'ionien.
CXLIII. Parmi ces Ioniens, il n'y eut que les habitants de Milet qui, pour se mettre à couvert de tout danger, firent un traité avec Cyrus. Quant aux insulaires, ils n'avaient pour lors rien à craindre, les Phéniciens n'étant pas encore soumis aux Perses, et ceux-ci n'ayant pas de marine. Les Milésiens, au reste, s'étaient séparés des autres Ioniens, parce que si tous les Grecs réunis étaient alors très faibles, les Ioniens l'étaient encore plus, et parce qu'ils ne jouissaient d'aucune sorte de considération. En effet, si l'on excepte Athènes, ils n'avaient pas une seule ville qui eût de la célébrité. Le reste des Ioniens et des Athéniens ne voulaient pas qu'on les appelât Ioniens ; ce nom leur déplaisait, et même encore aujourd'hui la plupart rougissent de le porter. Les douze villes dont je viens de parler s'en faisaient honneur. Elles firent construire un temple, qu'elles appelèrent de leur nom Panionium, et prirent la résolution d'en exclure les autres villes ioniennes : les Smyrnéens furent les seuls qui demandèrent à y être reçus.
CXLIV. Il en est de même des Doriens de la Pentapole, pays qui s'appelait auparavant Hexapole. Ils se gardent bien d'admettre au temple triopique aucun Dorien de leur voisinage ; et même s'il est arrive à quelque-un d'entre eux de violer les lois de ce temple, ils l'en ont exclu. En voici un exemple. Dans les jeux qui se célèbrent en l'honneur d'Apollon Triopien, on proposait autrefois des trépieds d'airain pour les vainqueurs ; mais il ne leur était pas permis de les emporter du temple, il fallait les y consacrer au dieu. Un habitant d'Halicarnasse, nommé Agasiclès, ayant obtenu le prix à ces jeux, emporta, au mépris de cette loi, le trépied dans sa maison, et l'y appendit. Les cinq villes doriennes, Linde, Ialyssos, Camiros, Cos et Cnide, punirent Halicarnasse, qui était la sixième, en l'excluant de leur association.
CXLV. Les Ioniens se sont, je crois, partagés en douze cantons, et n'en veulent pas admettre un plus grand nombre dans leur confédération, parce que, dans le temps qu'ils habitaient le Péloponnèse, ils étaient divisés en douze parties, de même que le sont encore maintenant les Achéens, qui les en ont chassés. Pellène est la première ville des Achéens du côté de Sicyone ; l'on trouve ensuite Aegire, Aeges, que traverse le Crathis, qui n'est jamais à sec, et qui a donné son nom à une rivière d'Italie. On voit après Bure, Hélice, où les Ioniens se réfugièrent après avoir été défaits par les Achéens. Viennent ensuite Aegium, Rhypes, Patres, Phares et Olenus, qu'arrose le Pirus, rivière considérable. Les deux dernières enfin sont Dyme, et la ville des Tritéens, la seule qui soit située au milieu des terres.
CXLVI. Ces douze cantons, qui sont aujourd'hui aux Achéens, appartenaient alors aux Ioniens, et ce fut cette raison qui engagea ceux-ci à se bâtir douze villes en Asie. Ce serait une insigne folie de dire que ces Ioniens sont plus distingués ou d'une naissance plus illustre que le reste des Ioniens, car les Abantes de l'Eubée en font une partie assez considérable ; et cependant ces peuples n'ont rien de commun avec les habitants de l'Ionie, pas même le nom. Ces Ioniens sont un mélange de Minyens Orchoméniens, de Cadméens, de Dryopes, d'une portion de Phocidiens, de Molosses, d'Arcadiens Pélasges, de Doriens Epidauriens, et de plusieurs autres nations. Ceux d'entre ces peuples qui sortirent autrefois du Prytanée des Athéniens s'estiment les plus nobles et les plus illustres des Ioniens. Lorsqu'ils allèrent fonder cette colonie, ils ne menèrent point de femmes avec eux ; mais ils épousèrent des Cariennes, dont ils avaient tué les pères. Ces femmes, furieuses du massacre de leurs pères, de leurs maris et de leurs enfants, et de ce qu'après une telle action ils les avaient épousées, s'imposèrent la loi de ne jamais prendre leurs repas avec leurs maris, et de ne jamais leur donner ce nom : loi qu'elles firent serment d'observer, et qu'elles transmirent à leurs filles. Ce fut à Milet que cela se passa.
CXLVII. Ces Ioniens élurent pour rois, les uns des Lyciens issus de Glaucus, fils d'Hippolochus ; les autres, des Caucons Pyliens, qui descendaient de Codrus, fils de Mélanthus ; d'autres enfin en prirent de l'une et de l'autre de ces deux maisons. Mais on me dira sans doute que ces Ioniens sont plus attachés à ce nom d'Ionien que le reste de la nation. Qu'ils soient aussi les purs, les véritables Ioniens, j'y consens ; cependant tous ceux qui sont originaires d'Athènes, et qui célèbrent la fête des Apaturies, sont aussi Ioniens. Or, ils la célèbrent tous, excepté les Ephésiens et les Colophoniens, qui en ont été exclus à cause d'un meurtre.
CXLVIII. Le Panionium est un lieu sacré du mont Mycale, que les Ioniens ont dédié en commun à Neptune Héliconien. Il regarde le septentrion. Mycale est un promontoire du continent, lequel s'étend à l'ouest vers Samos. Les Ioniens s'y assemblaient de toutes leurs villes, pour célébrer une fête qu'ils appelaient Panionies. Les fêtes des Ioniens ne sont pas les seules qui se terminent par la même lettre ; elles ont cela de commun avec celles de tous les Grecs, et avec les noms propres des Perses.
CXLIX. Voila ce que j'avais à dire concernant les villes des Ioniens. Celles des Eoliens sont : Cyme, qu'on appelle aussi Phriconis, Larisse, Néon Tichos, Tèmnos, Cilla, Notium, Aegirousa, Pitane, Aegée, Myrine, Grynia. Ce sont là les onze anciennes villes des Eoliens. Ils en avaient douze aussi sur le continent ; mais les Ioniens leur enlevèrent Smyrne. Le pays de ces Eoliens est meilleur que celui des Ioniens ; mais, quant à la température des saisons, il n'en approche pas.
CL. Voici à quelle occasion les Eoliens perdirent Smyrne. Des Colophoniens, ayant eu du désavantage dans une sédition, avaient été obligés de s'expatrier. Les habitants de Smyrne leur donnèrent un asile parmi eux. Quelque temps après, ces fugitifs ayant observé que les Smyrnéens célébraient hors de leur ville une fête en l'honneur de Bacchus, ils en fermèrent les portes, et s'en emparèrent. Les Eoliens vinrent tous au secours ; mais enfin il fut arrêté, d'un commun accord, qu'ils laisseraient les Ioniens en possession de la ville, et que ceux-ci leur rendraient tous leurs effets mobiliers. Les Smyrnéens ayant accepté cette condition, on les distribua dans les onze autres villes éoliennes, qui leur accordèrent le droit de cité.
CLI. Telles sont les villes que les Eoliens possèdent actuellement en terre ferme, sans y compter celles qu'ils ont au mont Ida, parce qu'elles ne font point corps avec elles. Ils ont aussi cinq villes dans l'île de Lesbos. Quant à la sixième, nommée Arisba, les Méthymnéens en ont réduit les habitants en esclavage, quoiqu'ils leur fussent unis par les liens du sang. Ils ont aussi une ville dans l'île de Ténédos, et une autre dans les îles qu'on appelle Hécatonnèses. Les Lesbiens et les Ténédiens n'avaient alors rien à craindre, non plus que ceux d'entre les Ioniens qui habitaient dans les îles ; mais les autres villes résolurent dans leur conseil de suivre les Ioniens partout où ils voudraient les mener.
CLII. Les ambassadeurs des Ioniens et des Eoliens, s'étant rendus à Sparte en diligence, choisirent, aussitôt après leur arrivée, un Phocéen, nommé Pythermus, pour porter la parole au nom de tous les autres. Pythermus se revêtit d'une robe de pourpre, afin que, sur cette nouvelle, les Spartiates se trouvassent à l'assemblée en plus grand nombre. S'étant avancé au milieu d'eux, il les exhorta, par un long discours, à prendre leur défense ; mais les Lacédémoniens, sans aucun égard pour leur demande, résolurent entre eux de ne leur accorder aucun secours. Les Ioniens se retirèrent. Quoique les Lacédémoniens eussent rejeté leur demande, ils ne laissèrent pas de faire partir, sur un vaisseau à cinquante rames, des gens qui, à ce qu'il me semble, devaient observer l'état où se trouvaient les affaires de Cyrus et de l'Ionie. Lorsque ce vaisseau fut arrivé à Phocée, ces députés envoyèrent à Sardes Lacrinès, le plus considérable d'entre eux, pour faire part à Cyrus du décret des Lacédémoniens, qui portait qu'il se gardât bien de faire tort à aucune ville de la Grèce ; qu'autrement Sparte ne le souffrirait pas.
CLIII. Lacrinès ayant exécuté ses ordres, on dit que Cyrus demanda aux Grecs qui étaient présents quelle sorte d'hommes c'était que les Lacédémoniens, et quelles étaient leurs forces pour oser lui faire de pareilles défenses. Sur la réponse qu'ils lui firent, il parla ainsi au héraut des Spartiates : «Je n'ai jamais redouté cette espèce de gens qui ont au milieu de leur ville une place où ils s'assemblent pour se tromper les uns les autres par des serments réciproques. Si les dieux me conservent la santé, ils auront plus sujet de s'entretenir de leurs malheurs que de ceux des Ioniens». Cyrus lança ces paroles menaçantes contre tous les Grecs, parce qu'ils ont dans leurs villes des places ou marchés où l'on vend et où l'on achète, et que les Perses n'ont pas coutume d'acheter ni de vendre ainsi dans des places, et que l'on ne voit point chez eux de marchés. Ce prince donna ensuite le gouvernement de Sardes à un Perse, nommé Tabalus ; et, ayant chargé Pactyas, Lydien, de transporter en Perse les trésors de Crésus et des autres Lydiens, il retourna à Agbatanes, et emmena Crésus avec lui, ne faisant point assez de cas des Ioniens pour aller d'abord contre eux. Babylone, les Bactriens, les Saces et les Egyptiens étaient autant d'obstacles à ses desseins. Il résolut de marcher en personne contre ces peuples, et d'envoyer un autre général contre les Ioniens.
CLIV. Cyrus ne fut pas plutôt parti de Sardes, que Pactyas fit soulever les Lydiens contre ce prince et contre Tabalus. Comme il avait entre les mains toutes les richesses de cette ville, il descendit sur le bord de la mer, prit des troupes à sa solde, engagea les habitants de la côte à s'armer en sa faveur, et, marchant contre Sardes, il assiégea Tabalus, qui se renferma dans la citadelle.
CLV. Sur cette nouvelle, que Cyrus apprit en chemin, ce prince dit à Crésus : «Quand verrai-je donc la fin de ces troubles ? Les Lydiens ne cesseront point, suivant toutes les apparences, de me susciter des affaires, et de s'en faire à eux-mêmes. Que sais-je s'il ne serait pas plus avantageux de les réduire en servitude ? J'en ai agi, du moins à ce qu'il me semble, comme quelqu'un qui aurait épargné les enfants de celui qu'il aurait fait mourir. Vous étiez pour les Lydiens quelque chose de plus qu'un père, je vous emmène prisonnier ; je leur ai remis leur ville, et je m'étonne ensuite qu'ils se révoltent !» Ce discours exprimait la manière de penser de ce prince : aussi Crésus, qui craignait qu'il ne détruisît entièrement la ville de Sardes, et qu'il n'en transplantât ailleurs les habitants, reprit la parole : «Ce que vous venez de dire, seigneur, est spécieux ; mais ne vous abandonnez pas entièrement aux mouvements de votre colère, et ne détruisez point une ville ancienne, qui n'est coupable ni des troubles précédents, ni de ceux qui arrivent aujourd'hui. J'ai été la cause des premiers, et j'en porte la peine. Pactyas a offensé celui à qui vous avez confié le gouvernement de Sardes : qu'il en soit puni. Pardonnez aux Lydiens ; mais, de crainte qu'à l'avenir ils ne se soulèvent, et qu'ils ne se rendent redoutables, envoyez-leur défendre d'avoir des armes chez eux, et ordonnez-leur de porter des tuniques sous leurs manteaux, de chausser des brodequins, de faire apprendre à leurs enfants à jouer de la cithare, à chanter, et les arts propres à les rendre efféminés. Par ce moyen, seigneur, vous verrez bientôt des hommes changés en femmes, et il n'y aura plus à craindre de révolte de leur part».
CLVI. Crésus lui donna ce conseil, qu'il croyait plus avantageux pour les Lydiens que d'être vendus comme de vils esclaves. Il sentait que, à moins de lui alléguer de bonnes raisons, il ne réussirait pas à le faire changer de résolution ; et d'ailleurs il appréhendait que si les Lydiens échappaient au danger présent, ils ne se soulevassent dans la suite contre les Perses, et n'attirassent sur eux une ruine totale. Ce conseil causa beaucoup de joie à Cyrus, qui, étant revenu de sa colère, témoigna à Crésus qu'il le suivrait. En même temps il manda un Mède, nommé Mazarès, lui ordonna de déclarer aux Lydiens l'avis que Crésus lui avait suggéré ; et de plus il lui commanda de réduire en servitude tous ceux qui s'étaient ligués avec eux pour assiéger Sardes ; mais surtout de lui amener Pactyas vivant. Ces ordres donnés en chemin, il continua sa route vers la Perse.
CLVII. Pactyas, apprenant que l'armée qui marchait contre lui approchait de Sardes, prit l'épouvante, et se sauva à Cyme. Cependant Mazarès arriva à Sardes avec une très petite partie de l'armée de Cyrus ; mais, n'y ayant pas trouvé Pactyas, il fit d'abord exécuter les ordres du roi. Les Lydiens se soumirent, et changèrent leur ancienne manière de vivre. Il envoya ensuite à Cyme sommer les habitants de lui livrer Pactyas. Il fut résolu, dans l'assemblée des Cyméens, qu'on enverrait consulter l'oracle des Branchides sur le parti qu'il fallait prendre ; car il y avait là un ancien oracle, auquel les Ioniens et les Eoliens avaient tous coutume de recourir. Ce lieu est dans le territoire de Milet, au-dessus du port de Panorme.
CLVIII. Les Cyméens, ayant envoyé des députés aux Branchides, demandèrent à l'oracle de quelle manière ils devaient se conduire à l'égard de Pactyas, pour se rendre agréables aux dieux. L'oracle répondit qu'il fallait le livrer aux Perses. Sur le rapport des députés, les Cyméens se disposèrent à rendre Pactyas ; mais, quoique le peuple se mît en devoir de le faire, Aristodicus, fils d'Héraclides, homme de distinction parmi les citoyens de Cyme, s'opposa à cette résolution, et empêcha qu'on ne la suivît, jusqu'à ce qu'on eût fait au sujet de Pactyas une seconde députation, dans laquelle il fut admis, soit qu'il se défiât de l'oracle, soit qu'il soupçonnât d'infidélité le rapport des députés.
CLIX. Les députés étant arrivés aux Branchides, Aristodicus, portant la parole pour eux, consulta le dieu en ces termes : «Grand dieu, le Lydien Pactyas est venu chercher un asile parmi nous pour éviter la mort dont le menacent les Perses. Ils le redemandent, et nous ordonnent de le remettre enlre leurs mains ; mais, quoique nous redoutions leur puissance, nous n'avons pas osé jusqu'ici leur livrer ce suppliant que nous n'ayons appris de vous avec certitude ce que nous devons faire». Le dieu lui fit la même réponse, et lui commanda de rendre Pactyas aux Perses. Sur cela, Aristodicus alla, de dessein prémédité, autour du temple, et enleva les moineaux et toutes les autres espèces d'oiseaux qui y avaient fait leurs nids. On raconte que tandis qu'il exécutait son dessein, il sortit du sanctuaire une voix qui s'adressait à lui, et lui disait : «O le plus scélérat de tous les hommes, as-tu bien la hardiesse d'arracher de mon temple mes suppliants ?» et qu'Aristodicus, sans se déconcerter, lui répondit : «Quoi ! grand dieu, vous secourez vous-même vos suppliants, et vous ordonnez aux Cyméens de livrer le leur ? - Oui, je le veux, reprit la même voix ; et c'est afin que, ayant commis une impiété, vous en périssiez plus tôt, et que vous ne veniez plus consulter l'oracle pour savoir si vous devez livrer des suppliants».
CLX. Sur le rapport des députés, les Cyméens envoyèrent Pactyas à Mitylène, ne voulant ni s'exposer en le livrant, ni se faire assiéger en continuant de lui donner un asile. Mazarès ayant fait redemander Pactyas aux Mityléniens, ils se disposaient à le lui remettre moyennant une certaine récompense ; ce que je n'ose cependant assurer, parce que la convention n'eut pas lieu. Les Cyméens, ayant eu connaissance des desseins des Mityléniens, envoyèrent à Lesbos un vaisseau qui transporta Pactyas à Chios. Les habitants de cette île l'arrachèrent du temple de Minerve Poliouchos, et le livrèrent à Mazarès, à condition qu'on leur donnerait l'Atarnée, pays de la Mysie, vis-à-vis de Lesbos. Lorsque les Perses eurent Pactyas en leur puissance, ils le gardèrent étroitement, à dessein de le présenter à Cyrus. Depuis cet événement, il se passa beaucoup de temps sans que les habitants de Chios osassent, dans les sacrifices, répandre sur la tête de la victime de l'orge d'Atarnée, ni offrira aucun dieu des gâteaux faits avec de la farine de ce canton, et on excluait des temples tout ce qui en provenait.
CLXI. Les habitants de Chios n'eurent pas plutôt livré Pactyas, que Mazarès marcha contre ceux qui s'étaient joints à ce rebelle pour assiéger Tabajus. Il réduisit les Priéniens en servitude, fit une incursion dans la plaine du Méandre, et permit à ses soldats de tout piller. Il traita de même la Magnésie ; après quoi, étant tombé malade, il mourut.
CLXII. Harpage lui succéda dans le commandement de l'armée. Il était Mède de nation, aussi bien que Mazarès ; et c'est celui à qui Astyages avait donné un repas abominable, et qui avait aidé Cyrus à s'emparer du trône de Médie. Dès que Cyrus l'eut nommé général, il passa en Ionie ; et, ayant forcé les habitants à se renfermer dans les villes, il s'en rendit ensuite maître par le moyen de cavaliers ou terrasses qu'il fit élever près des murs. Phocée fut la première ville d'Ionie qu'il attaqua de la sorte.
CLXIII. Les Phocéens sont les premiers chez les Grecs qui aient entrepris de longs voyages sur mer, et qui aient fait connaître la mer Adriatique, la Tyrrhénie, l'Ibérie et Tartessus. Ils ne se servaient point de vaisseaux ronds, mais de vaisseaux à cinquante rames. Etant arrivés à Tartessus, ils se rendirent agréables à Arganthonius, roi des Tartessiens, dont le règne fut de quatre-vingts ans, et qui en vécut en tout cent vingt. Les Phocéens surent tellement se faire aimer de ce prince, qu'il voulut d'abord les porter à quitter l'Ionie pour venir s'établir dans l'endroit de son pays qui leur plairait le plus ; mais, n'ayant pu les y engager, et ayant dans la suite appris d'eux que les forces de Crésus allaient toujours en augmentant, il leur donna une somme d'argent pour entourer leur ville de murailles. Cette somme devait être considérable, puisque l'enceinte de leurs murs est d'une vaste étendue, toute de grandes pierres jointes avec art. C'est ainsi que le mur des Phocéens fut bâti.
CLXIV. Harpage n'eut pas plutôt approché de la place, qu'il en forma le siège, faisant dire en même temps aux Phocéens qu'il serait content s'ils voulaient seulement abattre une tour de la ville, et consacrer une maison. Comme ils ne pouvaient souffrir l'esclavage, ils demandèrent un jour pour délibérer sur sa proposition, promettant, après cela, de lui faire réponse. Ils le prièrent aussi de retirer ses troupes de devant leurs murailles pendant qu'on serait au conseil. Harpage répondit que, quoiqu'il n'ignorât pas leurs projets, il ne laissait pas cependant de leur permettre de délibérer. Pendant qu'Harpage retirait ses troupes de devant la ville, les Phocéens lancèrent leurs vaisseaux en mer, y mirent leurs femmes, leurs enfants et leurs meubles, et, de plus, les statues et les offrandes qui se trouvèrent dans les temples, excepté les peintures et les statues de bronze et de pierre. Lorsqu'ils eurent porté tous leurs effets à bord de ces vaisseaux, ils s'embarquèrent et firent voile à Chios : les Perses, ayant trouvé la ville abandonnée, s'en emparèrent.
CLXV. Les Phocéens demandèrent à acheter les îles Oenusses ; mais voyant que les habitants de Chios ne voulaient pas les leur vendre, dans la crainte qu'ils n'y attirassent le commerce et que leur île n'en fût exclue, ils mirent à la voile pour se rendre en Cyrne, où vingt ans auparavant ils avaient bâti la ville d'Alalie pour obéir à un oracle. D'ailleurs Arganthonius était mort dans cet intervalle. Ayant donc mis à la voile pour s'y rendre, ils allèrent d'abord à Phocée, et égorgèrent la garnison qu'Harpage y avait laissée. Faisant ensuite les plus terribles imprécations contre ceux qui se sépareraient de la flotte, ils jetèrent dans la mer une masse de fer ardente, et firent serment de ne retourner jamais à Phocée que cette masse ne revînt sur l'eau. Tandis qu'ils étaient en route pour aller en Cyrne, plus de la moitié, touchés de compassion, et regrettant leur patrie et leurs anciennes demeures, violèrent leur serment, et retournèrent à Phocée. Les autres, plus religieux, partirent des îles Oenusses, et continuèrent leur route.
CLXVI. Lorsqu'ils furent arrivés en Cyrne, ils élevèrent des temples, et demeurèrent cinq ans avec les colons qui les avaient précédés ; mais comme ils ravagaient et pillaient tous leurs voisins, les Tyrrhéniens et les Carthaginois mirent les uns et les autres en mer, d'un commun accord, soixante vaisseaux. Les Phocéens, ayant aussi équipé de leur côté pareil nombre de vaisseaux, allèrent à leur rencontre sur la mer de Sardaigne. Ils remportèrent une victoire cadméienne ; mais elle leur coûta cher, car ils perdirent quarante vaisseaux, et les vingt autres ne purent servir dans la suite, les éperons ayant été faussés. Ils retournèrent à Alalie, et, prenant avec eux leurs femmes, leurs enfants, et tout ce qu'ils purent emporter du reste de leurs biens, ils abandonnèrent l'île de Cyrne, et firent voile vers Rhegium.
CLXVII. Les Carthaginois et les Tyrrhéniens ayant tiré au sort les Phocéens qui avaient été faits prisonniers sur les vaisseaux détruits, ceux-ci en eurent un beaucoup plus grand nombre. Les uns et les autres, les ayant menés à terre, les assommèrent à coups de pierres. Depuis ce temps-là, ni le bétail, ni les bêtes de charge, ni les hommes même, en un mot rien de ce qui appartenait aux Agylléens ne pouvait traverser le champ où les Phocéens avaient été lapidés sans avoir les membres disloqués, sans devenir perclus, ou sans tomber dans une espèce d'apoplexie. Les Agylléens envoyèrent à Delphes pour expier leur crime. La Pythie leur ordonna de faire aux Phocéens de magnifiques sacrifices funèbres, et d'instituer en leur honneur des jeux gymniques et des courses de chars. Les Agylléens observent encore maintenant ces cérémonies. Tel fut donc le sort de ces Phocéens. Ceux qui s'étaient réfugiés à Rhegium, en étant partis, bâtirent dans les campagnes d'Oenotrie la ville qu'on appelle aujourd'hui Hyèle. Ce fut par le conseil d'un habitant de Posidonia, qui leur dit que la Pythie ne leur avait pas ordonné, par sa réponse, d'établir une colonie dans l'île de Cyrne, mais d'élever un monument au héros Cyrnus. Ce qui regarde Phocée en Ionie se passa de la sorte.
CLXVIII. Les Téiens se conduisirent à peu près comme les Phocéens. En effet, Harpage ne se fut pas plutôt rendu maître de leurs murs par le moyen d'une terrasse, qu'ils s'embarquèrent, et passèrent en Thrace, où ils bâtirent la ville d'Abdères. Timésias de Clazomènes l'avait fondée auparavant ; mais les Thraces l'ayant chassé, il n'en jouit pas. Les Téiens d'Abdères lui rendent maintenant des honneurs comme à un héros.
CLXIX. Ces peuples furent les seuls parmi les Ioniens qui aimèrent mieux abandonner leur patrie que de porter le joug. Il est vrai que le reste des Ioniens, si l'on excepte ceux de Milet, en vinrent aux mains avec Harpage, de même que ceux qui avaient quitté l'Ionie, et qu'ils donnèrent des preuves de leur valeur en défendant chacun sa patrie mais, ayant été vaincus et étant tombés en la puissance de l'ennemi, ils furent contraints de rester dans le pays et de se soumettre au vainqueur. Quant aux Milésiens, ils avaient, comme je l'ai dit plus haut, prêté serment de fidélité à Cyrus, et jouissaient d'une parfaite tranquillité. L'Ionie fut donc ainsi réduite en esclavage pour la seconde fois. Les Ioniens qui habitaient les îles, craignant un sort pareil à celui qu'Harpage avait fait éprouver à ceux du continent, se rendirent d'eux-mêmes a Cyrus.
CLXX. Quoique accablés de maux, les Ioniens ne s'en assemblaient pas moins au Panionium. Bias de Priène leur donna, comme je l'ai appris, un conseil très avantageux, qui les eût rendus les plus heureux de tous les Grecs, s'ils eussent voulu le suivre. Il les exhorta à s'embarquer tous ensemble sur une même flotte, à se rendre en Sardaigne, et à y fonder une seule ville pour tous les Ioniens. Il leur fit voir que, par ce moyen, ils sortiraient d'esclavage, qu'ils s'enrichiraient, et qu'habitant la plus grande de toutes les îles, les autres tomberaient en leur puissance ; au lieu que, s'ils restaient en Ionie, il ne voyait pour eux aucune espérance de recouvrer leur liberté. Tel fut le conseil que donna Bias aux Ioniens, après qu'ils eurent été réduits en esclavage ; mais, avant que leur pays eût été subjugué, Thales de Milet, dont les ancêtres étaient originaires de Phénicie, leur en donna aussi un qui était excellent. Ce fut d'établir à Téos, au centre de l'Ionie, un conseil général pour toute la nation, sans préjudicier au gouvernement des autres villes, qui n'en auraient pas moins suivi leurs usages particuliers que si elles eussent été autant de cantons différents.
CLXXI. Harpage, ayant subjugué l'Ionie, marcha contre les Cariens, les Cauniens et les Lyciens, avec un renfort de troupes que lui avaient fourni les Ioniens et les Eoliens. Les Cariens avaient passé des îles sur le continent ; ils avaient été anciennement sujets de Minos : on les appelait Lélèges. Ils habitaient alors les îles et ne payaient aucune sorte de tribut, autant que j'ai pu l'apprendre par les plus anciennes traditions ; mais ils fournissaient à Minos des hommes de mer toutes les fois qu'il en avait besoin. Pendant que ce prince, heureux à la guerre, étendait au loin ses conquêtes, les Cariens acquéraient de la célébrité et se distinguaient plus que tous les peuples connus jusqu'alors. On leur doit trois inventions dont les Grecs ont fait depuis usage. Ce sont, en effet, les Cariens qui, les premiers, ont enseigné à mettre des panaches sur les casques, qui ont orné de figures leurs boucliers, et qui ont ajouté une anse de cuir à cette arme défensive ; car, jusqu'alors, tous ceux qui avaient coutume de se servir du bouclier le gouvernaient par le moyen d'un baudrier de cuir qui se tenait suspendu au cou et sur l'épaule gauche. Longtemps après, les Doriens et les Ioniens chassèrent les Cariens des îles, et c'est ainsi que les Cariens passèrent sur le continent. Voilà ce que les Crétois racontent des Cariens : mais ceux-ci pensent différemment sur leur origine. Ils se disent nés dans le continent même, et croient qu'ils n'ont jamais porté d'autre nom que celui qu'ils ont présentement. Ils montrent aussi à Mylasses un ancien temple de Jupiter Carien où ils n'admettent que les Mysiens et les Lydiens, à cause de l'affinité qu'ils ont avec ces peuples. Ils disent, en effet, que Lydus et Mysus étaient frères de Car ; et ce motif les leur a fait admettre dans ce temple d'où sont exclus ceux de toute autre notion, quoiqu'ils parlent la même langue.
CLXXII. Quant aux Cauniens, il me semble qu'ils sont autochthones, quoiqu'ils se disent originaires de Crète. S'ils ont formé leur langue sur celle des Cariens ou les Cariens sur celle des Cauniens, je ne puis en juger avec certitude. Ils ont cependant des coutumes bien différentes de celles des Cariens et du reste des hommes. Il est chez eux très honnête de s'assembler pour boire, hommes, femmes et enfants, suivant les liaisons que forment entre eux l'âge et l'amitié. Ils avaient des dieux étrangers ; mais, ayant changé de sentiment à leur égard, il fut résolu qu'on n'adresserait à l'avenir ses voeux qu'à ceux du pays. Toute la jeunesse caunienne se revêtit donc de ses armes, et, frappant l'air de ses piques, elle les accompagna jusqu'aux frontières des Calyndiens en criant qu'elle chassait les dieux étrangers.
CLXXIII. Les Lyciens sont originaires de Crète et remontent à la plus haute antiquité, car dès les temps les plus reculés cette île tout entière n'était occupée que par des barbares. Sarpédon et Minos, tous deux fils d'Europe, s'en disputèrent la souveraineté. Minos eut l'avantage, et Sarpédon fut chassé avec tous ceux de son parti. Ceux-ci passèrent dans la Milyade, canton de l'Asie ; car le pays qu'habitent aujourd'hui les Lyciens s'appelait autrefois Myliade, et les Myliens portaient alors le nom de Solymes. Tant que Sarpédon régna sur eux, on les appela Termiles ; nom qu'ils avaient apporté dans le pays, et que leurs voisins leur donnent encore maintenant. Mais Lycus, fils de Pandion, ayant été aussi chassé d'Athènes par son frère Egée, et s'étant réfugié chez les Termiles, auprès de Sarpédon, ces peuples s'appelèrent, avec le temps, Lyciens, du nom de ce prince. Ils suivent en partie les lois de Crète, et en partie celles de Carie. Ils en ont cependant une qui leur est tout à fait particulière, et qui ne s'accorde avec aucune de celles des autres hommes : ils prennent en effet le nom de leurs mères, au lieu de celui de leurs pères. Si l'on demande à un Lycien de quelle famille il est, il fait la généalogie de sa mère et des aïeules de sa mère. Si une femme du pays épouse un esclave, ses enfants sont réputés nobles. Si, au contraire, un citoyen, celui même du rang le plus distingué, se marie à une étrangère ou prend une concubine, ses enfants sont exclus des honneurs.
CLXXIV. Les Cariens furent réduits en servitude par Harpage, sans avoir rien fait de mémorable. Ils ne furent pas les seuls. Tous les Grecs qui habitent ce pays ne se distinguèrent pas davantage. On compte parmi eux les Cnidiens, colonie de Lacédémone. Leur pays, qu'on appelle Triopium, regarde la mer. La Bybassie commence à la péninsule ; et toute la Cnidie, si l'on en excepte un petit espace, est environnée par la mer : au nord, par le golfe Céramique ; au midi, par la mer de Syme et de Rhodes. C'est ce petit espace, qui n'a environ que cinq stades d'étendue, que les Cnidiens, voulant faire de leur pays une île, entreprirent de creuser pendant qu'Harpage était occupé à la conquête de l'Ionie ; car tout leur territoire était en dedans de l'isthme, et ne tenait au continent que par cette langue de terre qu'ils voulaient couper. Ils employèrent un grand nombre de travailleurs ; mais les éclats de pierre les blessant en différents endroits, et principalement aux yeux, d'une manière si extraordinaire qu'il paraissait bien qu'il y avait là quelque chose de divin, ils envoyèrent demander à Delphes quelle était la puissance qui s'opposait à leurs efforts. La Pythie, comme les Cnidiens le disent eux-mêmes, leur répondit en ces termes, en vers trimètres : Ne fortifiez pas l'isthme, et ne le creusez pas. Jupiter aurait fait une île de votre pays, si c'eût été sa volonté. Sur cette réponse de la Pythie, les Cnidiens cessèrent de creuser ; et, lorsque Harpage se présenta avec son année, ils se rendirent sans combattre.
CLXV. Les Pédasiens habitent le milieu des terres au-dessus d'Halicarnasse. Toutes les fois que ces peuples et que leurs voisins sont menacés de quelque malheur, une longue barbe pousse à la prêtresse de Minerve. Ce prodige est arrivé trois fois. Les Pédasiens furent les seuls peuples de Carie qui résistèrent longtemps à Harpage, et qui lui causèrent beaucoup d'embarras, en fortifiant la montagne de Lida ; mais enfin ils furent subjugués.
CLXXVI. Les Lyciens allèrent au-devant d'Harpage, dès qu'il parut avec son année dans les plaines de Xanthus. Quoiqu'ils ne fussent qu'une poignée de monde en comparaison des ennemis, ils se battirent, et firent des prodiges de valeur. Mais ayant perdu la bataille, et se voyant forcés de se renfermer dans leurs murs, ils portèrent dans la citadelle leurs richesses ; et y ayant rassemblé leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves, ils y mirent le feu, et la réduisirent en cendres avec tout ce qui était dedans. S'étant, après cette action, réciproquement engagés par les serments les plus terribles, ils firent secrètement une sortie contre les Perses, et périrent tous en combattant généreusement. Ainsi la plupart des Lyciens d'aujourd'hui, qui se disent Xanthiens, sont étrangers, si l'on en excepte quatre-vingts familles qui, étant alors éloignées de leur patrie, échappèrent à la ruine commune. Ainsi fut prise la ville de Xanthus. Harpage s'empara de celle de Caune à peu près de la même manière ; car les Cauniens suivirent en grande partie l'exemple des Lyciens.
CLXXVII. Pendant qu'Harpage ravageait l'Asie mineure, Cyrus subjuguait en personne toutes les nations de l'Asie supérieure, sans en omettre aucune. Je les passerai la plupart sous silence, me contentant de parler de celles qui lui donnèrent le plus de peine, et qui méritent le plus de trouver place dans l'histoire. Lorsque ce prince eut réduit sous sa puissance tout le continent, il songea à attaquer les Assyriens.
CLXXVIII. L'Assyrie contient plusieurs grandes villes, mais Babylone est la plus célèbre et la plus forte. C'était là que les rois du pays faisaient leur résidence depuis la destruction de Ninive. Cette ville, située dans une grande plaine, est de forme carrée ; chacun de ses côtés a six vingts stades de long, ce qui fait pour l'enceinte de la place quatre cent quatre-vingts stades. Elle est si magnifique que nous n'en connaissons pas une qu'on puisse lui comparer. Un fossé large, profond et plein d'eau, règne tout autour ; on trouve ensuite un mur de cinquante coudées de roi d'épaisseur sur deux cents en hauteur. La coudée de roi est de trois doigts plus grande que la moyenne.
CLXXIX. Il est à propos d'ajouter à ce que je viens de dire l'emploi qu'on fit de la terre des fossés, et de quelle façon la muraille fut bâtie. A mesure qu'on creusait les fossés, on en convertissait la terre en briques ; et, lorsqu'il y en eut une quantité suffisante, on les fit cuire dans des fourneaux. Ensuite, pour servir de liaison, on se servit de bitume chaud, et, de trente couches en trente couches de briques, on mit des lits de roseaux entrelacés ensemble. On bâtit d'abord de cette manière les bords du fossé. On passa ensuite aux murs, qu'on construisit de même. Au haut et sur le bord de cette muraille on éleva des tours qui n'avaient qu'une seule chambre, les unes vis-à-vis des autres, entre lesquelles on laissa autant d'espace qu'il en fallait pour faire tourner un char à quatre chevaux. Il y avait à cette muraille cent portes d'airain massif comme les jambages et les linteaux. A huit journées de Babylone est la ville d'Is, située sur une petite rivière de même nom, qui se jette dans l'Euphrate. Cette rivière roule avec ses eaux une grande quantité de bitume : on en tira celui dont furent cimentés les murs de Babylone.
CLXXX. L'Euphrate traverse cette ville par le milieu, et la partage en deux quartiers. Ce fleuve est grand, profond et rapide ; il vient de l'Arménie, et se jette dans la mer Erythrée. L'une et l'autre muraille forme un coude sur le fleuve. A cet endroit commence un mur de briques cuites, dont sont bordés les deux côtés de l'Euphrate. Les maisons sont à trois et quatre étages. Les rues sont droites, et coupées par d'autres qui aboutissent au fleuve. En face de celles-ci on a pratiqué, dans le mur construit le long du fleuve, de petites portes pareillement d'airain, par où l'on descend sur ses bords. Il y en a autant que de rues de traverse.
CLXXXI. Le mur extérieur sert de défense. L'intérieur n'est pas moins fort, mais il est plus étroit. Le centre de chacun de ces deux quartiers de la ville est remarquable : l'un, par le palais du roi, dont l'enceinte est grande et bien fortifiée ; l'autre, par le lieu consacré à Jupiter Bélus, dont les portes sont d'airain, et qui subsiste encore actuellement. C'est un carré régulier qui a deux stades en tout sens. On voit au milieu une tour massive qui a un stade tant en longueur qu'en largeur ; sur cette tour s'en élève une autre, et sur cette seconde encore une autre, et ainsi de suite : de sorte que l'on en compte jusqu'à huit. On a pratiqué en dehors des degrés qui vont en tournant, et par lesquels on monte à chaque tour. Au milieu de cet escalier on trouve une loge et des sièges, où se reposent ceux qui montent. Dans la dernière tour est une grande chapelle, dans cette chapelle un grand lit bien garni, et près de ce lit une table d'or. On n'y voit point de statues. Personne n'y passe la nuit, à moins que ce ne soit une femme du pays, dont le dieu a fait choix, comme le disent les Chaldéens, qui sont les prêtres de ce dieu.
CLXXXII. Ces mêmes prêtres ajoutent que le dieu vient lui-même dans la chapelle, et qu'il se repose sur le lit. Cela ne me paraît pas croyable. La même chose arrive à Thèbes en Egypte, s'il faut en croire les Egyptiens ; car il y couche une femme dans le temple de Jupiter Thébéen, et l'on dit que ces deux femmes n'ont commerce avec aucun homme. La même chose s'observe aussi à Patares en Lycie, lorsque le dieu honore cette ville de sa présence. Alors on enferme la grande prêtresse la nuit dans le temple ; car il ne rend point en ce lieu d'oracles en tout temps.
CLXXXIII. Dans ce temple de Babylone il y a une autre chapelle en bas, où l'on voit une grande statue d'or qui représente Jupiter assis. Près de cette statue est une grande table d'or ; le trône et le marchepied sont du même métal. Le tout, au rapport des Chaldéens, vaut huit cents talents d'or. On voit hors de cette chapelle un autel d'or, et, outre cela, un autre autel très grand, sur lequel on immole du bétail d'un âge fait ; car il n'est permis de sacrifier sur l'autel d'or que des animaux encore à la mamelle. Les Chaldéens brûlent aussi sur ce grand autel, tous les ans, à la fête de ce dieu, mille talents pesant d'encens. Il y avait encore en ce temps-là, dans l'enceinte sacrée, une statue d'or massif de douze coudées de haut. Je ne l'ai point vue, je me contente de rapporter ce qu'en disent les Chaldéens. Darius, fils d'Hyslaspes, forma le projet de l'enlever ; mais il n'osa l'exécuter. Xerxès, fils de Darius, fit tuer le prêtre qui s'opposait à son entreprise, et s'en empara. Telles sont les richesses de ce temple. On y voit aussi beaucoup d'autres offrandes particulières.
CLXXXIV. Babylone a eu un grand nombre de rois, dont je ferai mention dans mon Histoire d'Assyrie. Ce sont eux qui ont environné cette ville de murailles, et qui l'ont embellie par les temples qu'ils y ont élevés. Parmi ces princes on compte deux reines. La première précéda l'autre de cinq générations ; elle s'appelait Sémiramis. Elle fit faire ces digues remarquables qui retiennent l'Euphrate dans son lit et l'empêchent d'inonder les campagnes, comme il le faisait auparavant.
CLXXXV. La seconde reine, nommée Nitocris, était plus prudente que la première. Parmi plusieurs ouvrages dignes de mémoire dont je vais parler, elle fit celui-ci. Ayant remarqué que les Mèdes, devenus puissants, ne pouvaient rester en repos, qu'ils s'étaient rendus maîtres de plusieurs villes, et entre autres de Ninive, elle se fortifia d'avance contre eux autant qu'elle le put. Premièrement elle fit creuser des canaux au-dessus de Babylone ; par ce moyen, l'Euphrate, qui traverse la ville par le milieu, de droit qu'il était auparavant devint oblique et tortueux, au point qu'il passe trois fois par Ardéricca, bourgade d'Assyrie ; et encore maintenant ceux qui se transportent de cette mer-ci à Babylone rencontrent, en descendant l'Euphrate, ce bourg trois fois en trois jours. Elle fit faire ensuite de chaque côté une levée digne d'admiration, tant pour sa largeur que pour sa hauteur. Bien loin au-dessus de Babylone, et à une petite distance du fleuve, elle fit creuser un lac destiné à recevoir les eaux du fleuve quand il vient à se déborder. Il avait quatre cent vingt stades de tour : quant à la profondeur, on le creusa jusqu'à ce qu'on trouvât l'eau. La terre qu'on en tira servit à relever les bords de la rivière. Ce lac achevé, on en revêtit les bords de pierres. Ces deux ouvrages, savoir, l'Euphrate rendu tortueux et le lac, avaient pour but de ralentir le cours de ce fleuve en brisant son impétuosité par un grand nombre de sinuosités, et d'obliger ceux qui se rendraient par eau à Babylone d'y aller en faisant plusieurs détours, et de les forcer, au sortir de ces détours, à entrer dans un lac immense. Elle fit faire ces travaux dans la partie de ses Etats la plus exposée aux irruptions des Mèdes, et du côté où ils ont moins de chemin à faire pour entrer sur ses terres, afin que, n'ayant point de commerce avec les Assyriens, ils ne pussent prendre aucune connaissance de ses affaires.
CLXXXVI. Ce fut ainsi que celle princesse fortifia son pays. Quand ces ouvrages furent achevés, voici ceux qu'elle y ajouta : Babylone est divisée en deux parties, et l'Euphrate la traverse par le milieu. Sous les rois précédents, quand on voulait aller d'un côté de la ville à l'autre, il fallait nécessairement passer le fleuve en bateau, ce qui était, à mon avis, fort incommode. Nitocris y pourvut ; le lac qu'elle creusa pour obvier aux débordements du fleuve lui permit d'ajouter à ce travail un autre ouvrage qui a éternisé sa mémoire. Elle fit tailler de grandes pierres ; et lorsqu'elles furent prêtes à être mises en oeuvre, et que le lac eut été creusé, elle détourna les eaux de l'Euphrate dans ce lac. Pendant qu'il se remplissait, l'ancien lit du fleuve demeura à sec. Ce fut alors qu'on en revêtit les bords de briques cuites en dedans de la ville, ainsi que les descentes qui conduisent des petites portes à la rivière ; et l'on s'y prit comme l'on avait fait pour construire le mur : on bâtit aussi au milieu de la ville un pont avec les pierres qu'on avait tirées des carrières, et on les lia ensemble avec du fer et du plomb. Pendant le jour on y passait sur des pièces de bois carrées qu'on retirait le soir, de crainte que les habitants n'allassent de l'un et de l'autre côté du fleuve, pour se voler réciproquement. Lorsqu'on eut fait passer dans le lac les eaux du fleuve, on travailla au pont. Le pont achevé, on fit rentrer l'Euphrate dans son ancien lit ; et ce fut alors que les Babyloniens s'aperçurent de l'utilité du lac, et qu'ils reconnurent la commodité du pont.
CLXXXVII. Voici la ruse qu'imagina aussi cette même reine : elle se fit ériger un tombeau sur la terrasse d'une des portes de la ville les plus fréquentées, avec l'inscription suivante, qu'on y grava par son ordre : «Si quelqu'un des rois qui me succéderont à Babylone vient à manquer d'argent, qu'il ouvre ce sépulcre, et qu'il en prenne autant qu'il voudra ; mais qu'il se garde bien de l'ouvrir par d'autres motifs, et s'il n'en a du moins un grand besoin : cette infraction lui serait funeste». Ce tombeau demeura fermé jusqu'au règne de Darius ; mais ce prince, s'indignant de ne pas faire usage de cette porte, parce qu'il n'aurait pu y passer sans avoir un corps mort sur sa tête, et de ne point se servir de l'argent qui y était en dépôt, et qui semblait l'inviter à le prendre, le fit ouvrir ; mais il n'y trouva que le corps de Nitocris, avec cette inscription : «Si tu n'avais pas été insatiable d'argent, et avide d'un gain honteux, tu n'aurais pas ouvert les tombeaux des morts».
CLXXXVIII. Ce fut contre le fils de cette reine que Cyrus fit marcher ses troupes. Il était roi d'Assyrie, et s'appelait Labynète, de même que son père. Le grand roi ne se met point en campagne qu'il n'ait avec lui beaucoup de vivres et de bétail, qu'il tire de son pays. On porte aussi à sa suite de l'eau du Choaspes, fleuve qui passe à Suses. Le roi n'en boit pas d'autre. On la renferme dans des vases d'argent, après l'avoir fait bouillir, et on la transporte à la suite de ce prince sur des chariots à quatre roues traînés par des mulets.
CLXXXIX. Cyrus, marchant contre Babylone, arriva sur les bords du Gyndès. Ce fleuve a ses sources dans les monts Matianiens, et, après avoir traversé le pays des Darnéens, il se perd dans le Tigre, qui passe le long de la ville d'Opis, et se jette dans la mer Erythrée (le golfe Persique). Pendant que Cyrus essayait de traverser le Gyndès, quoiqu'on ne pût le faire qu'en bateau, un de ces chevaux blancs qu'on appelle sacrés, emporté par son ardeur, sauta dans l'eau ; et s'efforçant de gagner la rive opposée, la rapidité du courant l'enleva, le submergea, et le fit entièrement disparaître. Cyrus, indigné de l'insulte du fleuve, le menaça de le rendre si petit et si faible, que dans la suite les femmes mêmes pourraient le traverser sans se mouiller les genoux. Ces menaces faites, il suspend l'expédition contre Babylone, partage son armée en deux corps, trace au cordeau, de chaque côté de la rivière, cent quatre-vingts canaux qui venaient y aboutir en tout sens, et les fait ensuite creuser par ses troupes. On en vint à bout, parce qu'on y employa un grand nombre de travailleurs ; mais cette entreprise les occupa pendant tout l'été.
CXC. Cyrus, s'étant vengé du Gyndès en le coupant en trois cent soixante canaux, continua sa marche vers Babylone dès que le second printemps eut commencé à paraître. Les Babyloniens, ayant mis leurs troupes en campagne, l'attendirent de pied ferme. Il ne parut pas plutôt près de la ville, qu'ils lui livrèrent bataille ; mais, ayant été vaincus, ils se renfermèrent dans leurs murailles. Comme ils savaient depuis longtemps que ce prince ne pouvait rester tranquille, et qu'il attaquait également toutes les nations, ils avaient fait un amas de provisions pour un grand nombre d'années. Aussi le siège ne les inquiétait-il en aucune manière. Cyrus se trouvait dans un grand embarras ; il assiégeait la place depuis longtemps, et n'était pas plus avancé que le premier jour.
CXCI. Enfin, soit que de lui-même il eût connu ce qu'il fallait faire, soit que quelqu'un, le voyant embarrassé, lui eût donné un bon conseil, voici le moyen qu'il employa. Il plaça son armée, partie à l'endroit où le fleuve entre dans Babylone, partie à l'endroit d'où il en sort, avec ordre de s'introduire dans la ville par le lit du fleuve dès qu'il serait guéable. Son armée ainsi postée, et cet ordre donné, il se rendit au lac avec ses plus mauvaises troupes. Lorsqu'il y fut arrivé, il détourna, à l'exemple de la reine de Babylone, par le canal de communication, le fleuve dans le lac, qui était un grand marais. Les eaux s'y écoulèrent, et l'ancien lit de l'Euphrate devint guéable. Cela fait, les Perses, qui avaient été placés exprès sur les bords du fleuve, entrèrent dans Babylone par le lit de la rivière, dont les eaux s'étaient tellement retirées, qu'ils n'en avaient guère que jusqu'au milieu des cuisses. Si les Babyloniens eussent été instruits d'avance du dessein de Cyrus, ou s'ils s'en fussent aperçus au moment de l'exécution, ils auraient fait périr l'armée entière, loin de la laisser entrer. Ils n'auraient eu qu'à fermer toutes les petites portes qui conduisaient au fleuve, et qu'à monter sur le mur dont il est bordé ; ils l'auraient prise comme dans un filet. Mais les Perses survinrent lorsqu'ils s'y attendaient le moins. Si l'on en croit les Babyloniens, les extrémités de la ville étaient déjà au pouvoir de l'ennemi, que ceux qui demeuraient au milieu n'en avaient aucune connaissance, tant elle était grande. Comme ses habitants célébraient par hasard en ce jour une fête, ils ne s'occupaient alors que de danses et de plaisirs, qu'ils continuèrent jusqu'au moment où ils apprirent le malheur qui venait d'arriver. C'est ainsi que Babylone fut prise pour la première fois.
CXCII. Entre autres preuves que je vais rapporter de la puissance des Babyloniens, j'insiste sur celle-ci. Indépendamment des tributs ordinaires, tous les Etats du grand roi entretiennent sa table et nourrissent son armée. Or, de douze mois dont l'année est composée, la Babylonie fait cette dépense pendant quatre mois, et celle des huit autres se répartit sur le reste de l'Asie. Ce pays égale donc en richesses et en puissance le tiers de l'Asie. Le gouvernement de cette province (les Perses donnent le nom de satrapies à ces gouvernements) est le meilleur de tous. Il rapportait par jour une artabe d'argent à Tritantaechmès, fils d'Artabaze, à qui le roi l'avait donné. L'artabe est une mesure de Perse, plus grande de trois chénices attiques que le médimne attique. Cette province entretenait encore au roi, en particulier, sans compter les chevaux de guerre, un haras de huit cents étalons et de seize mille cavales ; de sorte qu'on comptait vingt juments pour chaque étalon. On y nourrissait aussi une grande quantité de chiens indiens. Quatre grands bourgs, situés dans la plaine, étaient chargés de les nourrir, et exempts de tout autre tribut.
CXCIII. Les pluies ne sont pas fréquentes en Assyrie ; l'eau du fleuve y nourrit la racine du grain, et fait croître les moissons, non point comme le Nil, en se répandant dans les campagnes, mais à force de bras, et par le moyen de machines propres à élever l'eau ; car la Babylonie est, comme l'Egypte, entièrement coupée de canaux, dont le plus grand porte des navires. Il regarde le lever d'hiver, et communique de l'Euphrate au Tigre, sur lequel était située Ninive. De tous les pays que nous connaissons, c'est, sans contredit, le meilleur et le plus fertile en grains de Cérès (le blé). La terre n'essaye pas du tout d'y porter de figuiers, de vignes, ni d'oliviers : mais en récompense elle y est si propre à toutes sortes de grains, qu'elle rapporte toujours deux cents fois autant qu'on a semé, et que, dans les années où elle se surpasse elle-même, elle rend trois cents fois autant qu'elle a reçu. Les feuilles du froment et de l'orge y ont bien quatre doigts de large. Quoique je n'ignore pas à quelle hauteur y viennent les tiges de millet et de sésame, je n'en ferai point mention, persuadé que ceux qui n'ont point été dans la Babylonie ne pourraient ajouter foi à ce que j'ai rapporté des grains de ce pays. Les Babyloniens ne se servent que de l'huile qu'ils expriment du sésame. La plaine est couverte de palmiers. La plupart portent du fruit ; on en mange une partie, et de l'autre on tire du vin et du miel. Ils les cultivent de la même manière que nous cultivons les figuiers. On lie et on attache le fruit des palmiers que les Grecs appellent palmiers mâles, aux palmiers qui portent des dattes, afin que le moucheron, s'introduisant dans la datte, la fasse mûrir et l'empêche de tomber ; car il se forme un moucheron dans le fruit des palmiers mâles, comme dans celui des figuiers sauvages.
CXCIV. Je vais parler d'une autre merveille qui, du moins après la ville, est la plus grande de toutes celles qu'on voit en ce pays. Les bateaux dont on se sert pour se rendre à Babylone sont faits avec des peaux, et de forme ronde. On les fabrique dans la partie de l'Arménie qui est au-dessus de l'Assyrie, avec des saules dont on forme la carène et les varangues, qu'on revêt par dehors de peaux, à qui on donne la figure d'un plancher. On les arrondit comme un bouclier, sans aucune distinction de poupe ni de proue, et on en remplit le fond de paille. On les abandonne au courant de la rivière, chargés de marchandises, et principalement de vin de palmier. Deux hommes debout les gouvernent chacun avec un pieu, que l'un tire en dedans et l'autre en dehors. Ces bateaux ne sont point égaux, il y en a de grands et de petits. Les plus grands portent jusqu'à cinq mille talents pesant. On transporte un âne dans chaque bateau ; les plus grands en ont plusieurs. Lorsqu'on est arrivé à Babylone, et qu'on a vendu les marchandises, on met aussi en vente les varangues et la paille. Ils chargent ensuite les peaux sur leurs ânes, et retournent en Arménie en les chassant devant eux : car le fleuve est si rapide qu'il n'est pas possible de le remonter ; et c'est par cette raison qu'ils ne font pas leurs bateaux de bois, mais de peaux. Ils en construisent d'autres de même manière, lorsqu'ils sont de retour en Arménie avec leurs ânes. Voilà ce que j'avais à dire de leurs bateaux.
CXCV. Quant à leur habillement, ils portent d'abord une tunique de lin qui leur descend jusqu'aux pieds, et par-dessus une autre tunique de laine ; ils s'enveloppent ensuite d'un petit manteau blanc. La chaussure qui est à la mode de leur pays ressemble presque à celle des Béotiens. Ils laissent croître leurs cheveux, se couvrent la tête d'une mitre, et se frottent tout le corps de parfums. Ils ont chacun un cachet, et un bâton travaillé à la main, au haut duquel est ou une pomme, ou une rose, ou un lis, ou un aigle, ou toute autre figure ; car il ne leur est pas permis de porter de canne ou bâton sans un ornement caractéristique. C'est ainsi qu'ils se parent : passons maintenant à leurs lois.
CXCVI. La plus sage de toutes, à mon avis, est celle-ci ; j'apprends qu'on la retrouve aussi chez les Vénètes, peuple d'Illyrie. Dans chaque bourgade, ceux qui avaient des filles nubiles les amenaient tous les ans dans un endroit où s'assemblaient autour d'elles une grande quantité d'hommes. Un crieur public les faisait lever, et les vendait toutes l'une après l'autre. Il commençait d'abord par la plus belle, et, après en avoir trouvé une somme considérable, il criait celles qui en approchaient davantage ; mais il ne les vendait qu'à condition que les acheteurs les épouseraient. Tous les riches Babyloniens qui étaient en âge nubile, enchérissant les uns sur les autres, achetaient les plus belles.Quant aux jeunes gens du peuple, comme ils avaient moins besoin d'épouser de belles personnes que d'avoir une femme qui leur apportât une dot, ils prenaient les plus laides, avec l'argent qu'on leur donnait. En effet, le crieur n'avait pas plutôt fini la vente des belles, qu'il faisait lever la plus laide, ou celle qui était estropiée, s'il s'en trouvait, la criait au plus bas prix, demandant qui voulait l'épouser à cette condition, et l'adjugeait à celui qui en faisait la promesse. Ainsi, l'argent qui provenait de la vente des belles servait à marier les laides et les estropiées. Il n'était point permis à un père de choisir un époux à sa fille, et celui qui avait acheté une fille ne pouvait l'emmener chez lui qu'il n'eût donné caution de l'épouser. Lorsqu'il avait trouvé des répondants, il la conduisait à sa maison. Si l'on ne pouvait s'accorder, la loi portait qu'on rendrait l'argent. Il était aussi permis indistinctement à tous ceux d'un autre bourg de venir à cette vente, et d'y acheter des filles. Cette loi, si sagement établie, ne subsiste plus ; ils ont depuis peu imaginé un autre moyen pour prévenir les mauvais traitements qu'on pourrait faire à leurs filles, et pour empêcher qu'on ne les menât dans une autre ville. Depuis que Babylone a été prise, et que, maltraités par leurs ennemis, les Babyloniens ont perdu leurs biens, il n'y a personne parmi le peuple qui, se voyant dans l'indigence, ne prostitue ses filles pour de l'argent.
CXCVII. Après la coutume concernant les mariages, la plus sage est celle qui regarde les malades. Comme ils n'ont point de médecins, ils transportent les malades à la place publique ; chacun s'en approche, et s'il a eu la même maladie, ou s'il a vu quelqu'un qui l'ait eue, il aide le malade de ses conseils, et l'exhorte à faire ce qu'il a fait lui-même, ou ce qu'il a vu pratiquer à d'autres pour se tirer d'une semblable maladie. Il n'est pas permis de passer auprès d'un malade sans lui demander quel est son mal.
CXCVIII. Ils mettent les morts dans du miel ; mais leur deuil et leurs cérémonies funèbres ressemblent beaucoup à ceux des Egyptiens. Toutes les fois qu'un Babylonien a eu commerce avec sa femme, il brûle des parfums, et s'assied auprès pour se purifier. Sa femme fait la même chose d'un autre côté. Ils se lavent ensuite l'un et l'autre à la pointe du jour ; car il ne leur est pas permis de toucher à aucun vase qu'ils ne se soient lavés : les Arabes observent le même usage.
CXCIX. Les Babyloniens ont une loi bien honteuse. Toute femme née dans le pays est obligée, une fois en sa vie, de se rendre au temple de Vénus, pour s'y livrer à un étranger. Plusieurs d'entre elles, dédaignant de se voir confondues avec les autres, à cause de l'orgueil que leur inspirent leurs richesses, se font porter devant le temple dans des chars couverts. Là, elles se tiennent assises, ayant derrière elles un grand nombre de domestiques qui les ont accompagnées ; mais la plupart des autres s'asseyent dans la pièce de terre dépendante du temple de Vénus, avec une couronne de ficelles autour de la tête. Les unes arrivent, les autres se retirent. On voit en tout sens des allées séparées par des cordages tendus : les étrangers se promènent dans ces allées, et choisissent les femmes qui leur plaisent le plus. Quand une femme a pris place en ce lieu, elle ne peut retourner chez elle que quelque étranger ne lui ait jeté de l'argent sur les genoux, et n'ait eu commerce avec elle hors du lieu sacré. Il faut que l'étranger, en lui jetant de l'argent, lui dise : J'invoque la déesse Mylitta. Or les Assyriens donnent à Vénus le nom de Mylitta. Quelque modique que soit la somme, il n'éprouvera point de refus, la loi le défend ; car cet argent devient sacré. Elle suit le premier qui lui jette de l'argent, et il ne lui est pas permis de repousser personne. Enfin, quand elle s'est acquittée de ce qu'elle devait à la déesse, en s'abandonnant à un étranger, elle retourne chez elle. Après cela, quelque somme qu'on lui donne, il n'est pas possible de |a séduire. Celles qui ont en partage une taille élégante et de la beauté ne font pas un long séjour dans le temple ; mais les laides y restent davantage, parce qu'elles ne peuvent satisfaire à la loi : il y en a même qui y demeurent trois ou quatre ans. Une coutume à peu près semblable s'observe en quelques endroits de l'île de Cypre.
CC. Telles sont les lois et les coutumes des Babyloniens. Il y a parmi eux trois tribus qui ne vivent que de poissons. Quand ils les ont péchés, ils les font sécher au soleil, les broient dans un mortier, et les passent ensuite à travers un linge. Ceux qui en veulent manger en font des gâteaux, ou les font cuire comme du pain.
CCI. Lorsque Cyrus eut subjugué cette nation, il lui prit envie de réduire les Massagètes sous sa puissance. On dit que ces peuples forment une nation considérable, et qu'ils sont braves et courageux. Leur pays est à l'est, au delà de l'Araxe, vis-à-vis des Issédons. Il en est qui prétendent qu'ils sont aussi Scythes de nation.
CCII L'Araxe (la Volga), selon quelques-uns, est plus grand que l'Ister (le Danube) ; selon d'autres, il est plus petit. On dit qu'il y a dans ce fleuve beaucoup d'îles dont la grandeur approche de celle de Lesbos ; que les peuples qui les habitent se nourrissent l'été de diverses sortes de racines, et qu'ils réservent pour l'hiver les fruits mûrs qu'ils trouvent aux arbres. Ou dit aussi qu'ils ont découvert un arbre dont ils jettent le fruit dans un feu autour duquel ils s'assemblent par troupes ; qu'ils en aspirent la vapeur par le nez, et que cette vapeur les enivre, comme le vin enivre les Grecs ; que plus ils jettent de ce fruit dans le feu, plus ils s'enivrent, jusqu'à ce qu'enfin ils se lèvent, et se mettent tous à chanter et à danser. Quant à l'Araxe, il vient du pays des Matianiens, d'où coule aussi le Gyndès, que Cyrus coupa en trois cent soixante canaux. Il a quarante embouchures, qui, si l'on en excepte une, se jettent toutes dans des lieux marécageux et pleins de fange, où l'on prétend qu'habitent des hommes qui vivent de poissons crus, et sont dans l'usage de s'habiller de peaux de veaux marins. Cette bouche unique, dont je viens de parler, se rend dans la mer Caspienne par un canal propre et net. Cette mer est une mer par elle-même, et n'a aucune communication avec l'autre ; car toute la mer où naviguent les Grecs, celle qui est au delà des colonnes d'Hercule, qu'on appelle mer Atlantide, et la mer Erythrée ne font ensemble qu'une même mer.
CCIII. La mer Caspienne est une mer par elle-même, et bien différente de l'autre. Elle a autant de longueur qu'un vaisseau qui va à la rame peut faire de chemin en quinze jours, et, dans sa plus grande largeur, autant qu'il en peut faire en huit. Le Caucase borne cette mer à l'occident. C'est la plus grande de toutes les montagnes, tant par son étendue que par sa hauteur. Elle est habitée par plusieurs nations différentes, dont la plupart ne vivent que de fruits sauvages. On assure que ces peuples ont chez eux une sorte d'arbre dont les feuilles, broyées et mêlées avec de l'eau, leur fournissent une couleur avec laquelle ils peignent sur leurs habits des figures d'animaux. L'eau n'efface point ces figures, et, comme si elles avaient été tissues, elles ne s'usent qu'avec l'étoffe. On assure aussi que ces peuples voient publiquement leurs femmes, comme les bêtes.
CCIV. La mer Caspienne est donc bornée à l'ouest par le Caucase, et à l'est par une plaine immense et à perte de vue. Les Massagètes, à qui Cyrus voulait faire la guerre, occupent la plus grande partie de cette plaine spacieuse. Plusieurs considérations importantes engageaient ce prince dans cette guerre, et l'y animaient. La première était sa naissance, qui lui paraissait avoir quelque chose de plus qu'humain ; la seconde, le bonheur qui l'avait toujours accompagné dans ses guerres. Toutes les nations, en effet, contre qui Cyrus tourna ses armes, furent subjuguées ; aucune ne put l'éviter.
CCV. Tomyris, veuve du dernier roi, régnait alors sur les Massagètes. Cyrus lui envoya des ambassadeurs, sous prétexte de la rechercher en mariage. Mais cette princesse, comprenant qu'il était plus épris de la couronne des Massagètes que de sa personne, lui interdit l'entrée de ses Etats. Cyrus, voyant que ses artifices n'avaient point réussi, marcha ouvertement contre les Massagètes, et s'avança jusqu'à l'Araxe. Il jeta un pont sur ce fleuve pour en faciliter le passage, et fit élever des tours sur des bateaux destinés à passer ses troupes.
CCVI. Pendant qu'il était occupé de ces travaux, Tomyris lui envoya un ambassadeur, qu'elle chargea de lui parler ainsi : «Roi des Mèdes, cesse de hâter une entreprise dont tu ignores si l'événement tournera à ton avantage, et, content de régner sur tes propres sujets, regarde-nous tranquillement régner sur les nôtres. Si tu ne veux pas suivre mes conseils, si tu préfères tout autre parti au repos, enfin si tu as tant d'envie d'éprouver tes forces contre celles des Massagètes, discontinue le pont que tu as commencé. Nous nous retirerons à trois journées de ce fleuve, pour te donner le temps de passer dans notre pays ; ou, si tu aimes mieux nous recevoir dans le tien, fais comme nous». Cyrus convoqua là-dessus les principaux d'entre les Perses, et, ayant mis l'affaire en délibération, il voulut avoir leur avis. Ils s'accordèrent tous à recevoir Tomyris et son armée sur leurs terres.
CCVII. Crésus, qui était présent aux délibérations, désapprouva cet avis, et en proposa un tout opposé. «Seigneur, dit-il à Cyrus, je vous ai toujours assuré que, Jupiter m'ayant livré en votre puissance, je ne cesserais de faire tous mes efforts pour tâcher de détourner de dessus votre tête les malheurs qui vous menacent. Mes adversités me tiennent lieu d'instructions. Si vous vous croyez immortel, si vous pensez commander une armée d'immortels, peu vous importe ma manière de penser. Mais si vous reconnaissez que vous êtes aussi un homme, et que vous ne commandez qu'à des hommes comme vous, considérez d'abord les vicissitudes humaines : Figurez-vous une roue qui tourne sans cesse, et ne nous permet pas d'être toujours heureux. Pour moi, sur l'affaire qui vient d'être proposée, je suis d'un avis totalement contraire à celui de votre conseil. Si nous recevons l'ennemi dans notre pays, et qu'il nous batte, n'est-il pas à craindre que vous perdiez votre empire ? car si les Massagètes ont l'avantage, il est certain qu'au lieu de retourner en arrière ils attaqueront vos provinces. Je veux que vous remportiez la victoire : sera-t-elle jamais aussi complète que si, après avoir défait vos ennemis sur leur propre territoire, vous n'aviez plus qu'à les poursuivre ? J'opposerai toujours à ceux qui ne sont pas de votre avis que, si vous obtenez la victoire, rien ne pourra plus vous empêcher de pénétrer sur-le-champ jusqu'au centre des Etats de Tomyris. Indépendamment de ces motifs, ne serait-ce pas une chose aussi insupportable que honteuse pour Cyrus, flls de Cambyse, de reculer devant une femme ? J'opine donc que vos troupes passent le fleuve, que vous avanciez à mesure que l'ennemi s'éloignera, et qu'ensuite vous cherchiez tous les moyens de le vaincre. Je sais que les Massagètes ne connaissent pas les délices des Perses, et qu'ils manquent des commodités de la vie. Qu'on égorge donc une grande quantité de bétail, qu'on l'apprête, et qu'on le serve dans le camp ; on y joindra du vin pur en abondance dans des cratères, et toutes sortes de mets. Ces préparatifs achevés, nous laisserons au camp nos plus mauvaises troupes, et nous nous retirerons vers le fleuve avec le reste de l'armée. Les Massagètes, si je ne me trompe, voyant tant d'abondance, y courront, et c'est alors que nous trouverons l'occasion de nous signaler».
CCVIII. De ces deux avis opposés, Cyrus rejeta le premier, et préféra celui de Crésus. Il fit dire en conséquence, à Tomyris de se retirer, parce qu'il avait dessein de traverser la rivière. La reine se retira, suivant la convention. Cyrus déclara son fils Carabyse pour son successeur ; et, lui ayant remis Crésus entre les mains, il lui recommanda d'honorer ce prince et de le combler de bienfaits, quand même cette expédition ne réussirait pas. Ces ordres donnés, il les renvoya en Perse, et traversa le fleuve avec son armée.
CCIX. Cyrus ayant passé l'Araxe, et la nuit étant venue, il s'endormit dans le pays des Massagètes ; et, pendant son sommeil, il eut cette vision : il lui sembla voir en songe l'aîné des fils d'Hystaspes ayant deux ailes aux épaules, dont l'une couvrait l'Asie de son ombre, et l'autre couvrait l'Europe. Cet aîné des enfants d'Hystaspes, nommé Darius, avait alors environ vingt ans. Son père, fils d'Arsames, et de la race des Achéménides, l'avait laissé en Perse, parce qu'il n'était pas encore en âge de porter les armes. Cyrus ayant, à son réveil, réfléchi sur cette vision , et la croyant d'une très grande importance, il manda Hystaspes, le prit en particulier, et lui dit : «Hystaspes, votre fils est convaincu d'avoir conspiré contre moi et contre mon royaume. Je vais vous apprendre comment je le sais, à n'en pouvoir douter. Les dieux prennent soin de moi, et me découvrent ce qui doit m'arriver. La nuit dernière, pendant que je dormais, j'ai vu l'aîné de vos enfants avec des ailes aux épaules, dont l'une couvrait de son ombre l'Asie, et l'autre l'Europe. Je ne puis douter, après cela, qu'il n'ait formé quelque trame contre moi. Partez donc promptement pour la Perse, et ne manquez pas, à mon retour, après la conquête de ce pays-ci, de me représenter votre fils, afin que je l'examine».
CCX. Ainsi parla Cyrus, persuadé que Darius conspirait contre lui ; mais le dieu lui présageait par ce songe qu'il devait mourir dans le pays des Massagètes, et que sa couronne passerait sur la tête de Darius. Hystaspes répondit : «Seigneur, aux dieux ne plaise qu'il se trouve parmi les Perses un homme qui veuille attenter à vos jours ! s'il s'en trouvait quelqu'un, qu'il périsse au plus tôt. D'esclaves qu'ils étaient, vous en avez fait des hommes libres ; et, au lieu de recevoir les ordres d'un maître, ils commandent à toutes les nations. Au reste, seigneur, si quelque vision vous a fait connaître que mon fils conspire contre votre personne, je vous le livre moi-même, pour le traiter comme il vous plaira». Hystaspes traversa l'Araxe après cette réponse, et retourna en Perse pour s'assurer de Darius son fils, et le représenter à Cyrus.
CCXI. Cyrus, s'étant avancé à une journée de l'Araxe, laissa dans son camp, suivant le conseil de Crésus, ses plus mauvaises troupes, et retourna vers le fleuve avec ses meilleures. Les Massagètes vinrent attaquer, avec la troisième partie de leurs forces, les troupes que Cyrus avait laissées à la garde du camp, et les passèrent au fil de l'épée après quelque résistance. Voyant ensuite tout prêt pour le repas, ils se mirent à table ; et, après avoir mangé et bu avec excès, ils s'endormirent. Mais les Perses survinrent, en tuèrent un grand nombre, et firent encore plus de prisonniers, parmi lesquels se trouva Spargapisès, leur général, fils de la reine Tomyris.
CCXII. Cette princesse, ayant appris le malheur arrivé à ses troupes et à son fils, envoya un héraut à Cyrus : «Prince altéré de sang, lui dit-elle par la bouche du héraut, que ce succès ne t'enfle point ; tu ne le dois qu'au jus de la vigne, qu'à cette liqueur qui vous rend insensés, et ne descend dans vos corps que pour faire remonter sur vos lèvres des paroles insolentes. Tu as remporté la victoire sur mon fils, non dans une bataille et par tes propres forces, mais par l'appas de ce poison séducteur. Ecoute, et suis un bon conseil : rends-moi mon fils, et, après avoir défait le tiers de mon armée, je veux bien encore que tu te retires impunément de mes Etats ; sinon, j'en jure par le Soleil, le souverain maître des Massagètes, oui, je t'assouvirai de sang, quelque altéré que tu en sois».
CCXIII. Cyrus ne tint aucun compte de ce discours. Quant à Spargapisès, étant revenu de son ivresse, et apprenant le fâcheux état où il se trouvait, il pria Cyrus de lui faire ôter ses chaînes. Il ne se vit pas plutôt en liberté, qu'il se tua. Telle fut la triste fin de ce jeune prince.
CCXIV. Tomyris, voyant que Cyrus n'était pas disposé à suivre son conseil, rassembla toutes ses forces, et lui livra bataille. Ce combat fut, je crois, le plus furieux qui se soit jamais donné entre des peuples barbares. Voici, autant que je l'ai pu savoir, comment les choses se passèrent. Les deux armées étant à quelque distance l'une de l'autre, on se tira d'abord une multitude de flèches. Les flèches épuisées, on fondit les uns sur les autres à coups de lances, et l'on se mêla l'épée à la main. On combattit longtemps de pied ferme, avec un avantage égal et sans reculer. Enfin la victoire se déclara pour les Massagètes : la plus grande partie de l'armée des Perses périt en cet endroit, et Cyrus lui-même fut tué dans le combat, après un règne de vingt-neuf ans accomplis. Tomyris, ayant fait chercher ce prince parmi les morts, maltraita son cadavre, et lui fit plonger la tête dans une outre pleine de sang humain. «Quoique vivante et victorieuse, dit-elle, tu m'as perdue en faisant périr mon fils, qui s'est laissé prendre à tes pièges ; mais je t'assouvirai de sang, comme je l'en ai menacé». On raconte diversement la mort de Cyrus ; pour moi, je me suis borné à ce qui m'a paru le plus vraisemblable.
CCXV. Les Massagètes s'habillent comme les Scythes, et leur manière de vivre est la même. Ils combattent à pied et à cheval, et y réussissent également. Ils sont gens de trait et bons piquiers, et portent des sagares, suivant l'usage du pays. Ils emploient à toutes sortes d'usages l'or et le cuivre. Ils se servent de cuivre pour les piques, les pointes des flèches et les sagares, et réservent l'or pour orner les casques, les baudriers et les larges ceintures qu'ils portent sous les aisselles. Les plastrons dont est garni le poitrail de leurs chevaux sont aussi de cuivre ; quant aux brides, aux mors et aux bosselles, ils les embellissent avec de l'or. Le fer et l'argent ne sont point en usage parmi eux, et on n'en trouve point dans leur pays ; mais l'or et le cuivre y sont abondants.
CCXVI. Passons à leurs usages. Ils épousent chacun une femme ; mais elles sont communes entre eux. C'est chez les Massagètes que s'observe cette coutume, et non chez les Scythes, comme le prétendent les Grecs. Lorsqu'un Massagète devient amoureux d'une femme, il suspend son carquois à son chariot, et en jouit sans honte et sans crainte. Ils ne prescrivent point de bornes à la vie ; mais lorsqu'un homme est cassé de vieillesse, ses parents s'assemblent et l'immolent avec du bétail. Ils en font cuire la chair, et s'en régalent. Ce genre de mort passe chez ces peuples pour le plus heureux. Ils ne mangent point celui qui est mort de maladie ; mais ils l'enterrent, et regardent comme un malheur de ce qu'il n'a pas été immolé. Ils n'ensemencent point la terre et vivent de leurs troupeaux, et des poissons que l'Araxe leur fournit en abondance. Le lait est leur boisson ordinaire. De tous les dieux, ils n'adorent que le Soleil. Ils lui sacrifient des chevaux, parce qu'ils croient juste d'immoler au plus vite des dieux le plus vite des animaux.