Notice sur Ovide
 Ce poète que tu lis, et qui chanta les tendres amours, si tu veux le connaître, ô postérité, voici son histoire.
Ce poète que tu lis, et qui chanta les tendres amours, si tu veux le connaître, ô postérité, voici son histoire.
Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre par l'abondance et la fraîcheur de ses eaux, et située à quatre-vingt-dix milles de Rome. C'est là que je naquis, et, pour préciser l'époque, ce fut l'année où les deux Consuls, Hirtius et Pansa, périrent l'un et l'autre, frappés d'une mort semblable.
S'il faut y attacher quelque prix, c'est d'une longue suite d'aïeux que j'héritai de mon rang, et je ne dus pas à la faveur de la fortune de devenir chevalier.
Je n'étais pas l'aîné de la famille, et ne vis la lumière qu'après un frère qui m'avait précédé de trois fois quatre mois. La même étoile présida à nos naissances, et le même jour était célébré par l'offrande de deux gâteaux. Ce jour est, des cinq fêtes de la belliqueuse Minerve, celui qui le premier est ordinairement ensanglanté par des combats.
On cultiva notre esprit de bonne heure, et, grâce aux soins de mon père, nous pûmes suivre les leçons des maîtres les plus célèbres à Rome par leur talent. Mon frère, dès sa jeunesse, se destinait à l'art de la parole, et semblait né pour la lutte et les combats bruyants du barreau. Mais pour moi, dès l'enfance, les mystères sacrés furent pleins de charmes, et les Muses m'attirèrent en secret à leur culte. Souvent mon père me disait : «Pourquoi tenter une étude stérile ? Homère lui-même mourut dans l'indigence». J'étais ébranlé par ces paroles ; je disais adieu à l'Hélicon, et tâchais d'écrire sans m'astreindre au rythme poétique, mais les mots venaient d'eux-mêmes remplir le cadre de la mesure, et chaque pensée que j'exprimais était un vers.
Cependant les années s'écoulaient insensiblement ; nous prîmes, mon frère et moi, la robe virile. Nos épaules revêtent la pourpre du laticlave ; mais nos goûts restent ce qu'ils étaient auparavant. Déjà mon frère venait d'atteindre deux fois dix ans, lorsqu'il me fut enlevé. Je perdis en lui la moitié de moi-même.
Je gérai alors les premiers honneurs accordés à la jeunesse : je fus créé triumvir. Restait encore le Sénat. Mais je me contentai de l'angusticlave : le fardeau eût été trop pesant pour ma faiblesse, incompatible avec ma santé ; et mon esprit, peu propre à un travail suivi, fuyait les soucis de l'ambition. Les Nymphes de l'Aonie me conviaient à goûter de paisibles loisirs, qui toujours eurent pour moi mille charmes.
Je cultivai, je chéris les poètes de cette époque ; quand j'étais auprès d'eux, je croyais être auprès des dieux mêmes. Souvent le vieux Macer me lut ses Oiseaux, quel serpent donne la mort, quels simples rendent la vie ; souvent j'écoutai Properce lire ses élégies érotiques, Properce dont je fus le camarade et l'ami ; Ponticus, célèbre par ses poésies héroïques, Bassus, par ses ïambes, furent encore mes compagnons chéris ; Horace, l'harmonieux Horace, charma aussi mes oreilles en chantant d'élégantes odes sur la lyre aussonienne. Je n'ai fait qu'entrevoir Virgile ; les Destins jaloux ravirent trop tôt Tibulle à mon amitié. Ce poète fleurit après toi, Gallus, et Properce après lui ; je vins donc le quatrième par ordre de date. Je leur rendis hommage comme à mes aînés ; de plus jeunes me rendirent hommage aussi, et ma Muse ne tarda pas à être connue.
Quand je lus au peuple les premières poésies, ouvrage de ma jeunesse, ma barbe n'était tombée que deux ou trois fois sous le rasoir. Ma verve s'enflamma lorsque je vis chanter dans toute la ville celle que j'avais célébrée sous le nom emprunté de Corinne.
Je composai bien des pièces ; mais celles qui me parurent trop faibles, je ne les corrigeai qu'en les livrant aux flammes. Au moment de mon exil, plusieurs aussi, qui devaient me plaire, furent brûlées de ma main, dans mon dépit contre ma manie et mes vers.
Mon coeur tendre ne fut pas invulnérable aux traits de Cupidon ; la plus légère impression pouvait l'émouvoir. Malgré ce caractère, et quoique une étincelle suffit pour m'enflammer, je ne donnai jamais le moindre sujet de scandale.
Je n'étais presque qu'un enfant quand je contractai une union où je trouvai peu de convenance et de sympathie ; elle fut bientôt rompue. Une seconde la suivit, qui fut à l'abri de tout reproche. Mais cette épouse nouvelle ne devait pas longtemps partager ma couche. Une troisième resta ma compagne jusqu'à mes vieux ans, et ne rougit pas d'être l'épouse d'un exilé. Ma fille, au printemps de son âge, donna deux fois des gages de sa fécondité en me rendant aïeul, mais ce fut avec deux époux différents.
Mon père avait terminé sa destinée après avoir atteint son dix-huitième lustre. Je le pleurai comme il aurait lui-même pleuré ma perte. Bientôt je rendis les derniers devoirs à ma mère. Heureux l'un et l'autre d'avoir été ensevelis lorsqu'il en était temps encore, d'être morts avant le jour de ma disgrâce ! Heureux moi-même de ne les avoir pas pour témoins de mon infortune, de n'avoir pas été pour eux un sujet de douleur ! Si pourtant il reste après la mort autre chose qu'un vain nom, si notre ombre légère échappe au fatal bûcher, si la renommée de mon malheur est parvenue jusqu'à vous, ombres de mes parents, si mes fautes sont portées au tribunal des enfers, sachez, sachez, et je ne saurais vous tromper, que c'est par une méprise, non par un crime, que j'ai mérité mon exil !
C'est assez donner aux mânes. Je reviens à vous, esprits curieux de connaître les particularités de ma vie.
Mes belles années avaient fui ; les neiges du vieil âge venaient se mêler à l'antique nuance de ma chevelure. Depuis ma naissance, dix fois ceint de l'olivier olympique, le vainqueur à la course des chars avait obtenu la palme, lorsque Tomes, située sur la rive occidentale du Pont-Euxin, est le séjour où me condamne à me rendre le courroux du prince offensé. La cause de ma perte, trop connue de tout le monde, ne doit point être signalée par mon témoignage.
Rappellerai-je la trahison de mes amis, la perfidie de mes gens ?
J'ai passé par mille épreuves non moins rudes que l'exil. Mon esprit s'indigna de succomber à ses maux ; il rappela toutes ses forces, et sut en triompher. Ne songeant plus à la paix, aux loisirs de ma vie passée, j'obéis aux circonstances et pris des armes étrangères à mon bras.
J'endurai sur terre et sur mer autant de malheurs qu'il y a d'étoiles entre le pôle invisible et celui que nous apercevons, et, après bien des détours, j'abordai enfin chez les Sarmates, voisins des Gètes aux flèches acérées. Ici, quoique les armes des peuples limitrophes retentissent autour de moi, je cherche un soulagement à mon triste destin dans la poésie, seule ressource qui me reste ; et quoique je ne trouve pas une oreille pour écouter mes vers, j'abrège et je trompe ainsi la longueur des journées.
Si donc j'existe encore, si je résiste à tant de fatigues et de peines, si je ne prends point en dégoût cette vie rongée de soucis, grâces t'en soient rendues, ô Muse ! près de toi seule je trouve des consolations. Tu calmes mes ennuis, tu es un baume pour mes maux, tu es mon guide, ma compagne fidèle ; tu m'éloignes de l'Ister et me donnes asile au sein de l'Hélicon. C'est toi qui, par un bien rare privilège, me fais jouir pendant ma vie de cette célébrité que la Renommée n'accorde qu'après la mort.
L'envie, qui rabaisse le mérite contemporain, n'a imprimé sa dent sur aucun de mes ouvrages ; et, malgré les grands poètes qu'a produits notre siècle, la Renommée ne fut pas malveillante à l'égard de mon talent ; il en est plusieurs que je place au-dessus de moi, et pourtant on me dit leur égal, et j'ai trouvé une foule de lecteurs par tout l'univers.
Si les pressentiments des poètes ne sont pas entièrement illusoires, à l'heure de mon trépas, terre, je ne serai pas ta proie. Que je doive cette renommée à la faveur ou au talent, lecteur bienveillant, reçois ici le légitime hommage de ma reconnaissance.
OVIDE, Les Tristes, IV, x.
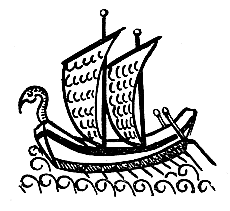 |