LVIII - La monarchie |
IV - CONSPIRATION ; ASSASSINAT DE CESAR
Les épées brisées à
Pharsale, à Thapsus et à Munda allaient se
changer en poignards. Depuis plusieurs mois, une
conjuration était formée, car tous les
républicains n'étaient pas tombés
dans les batailles de la guerre civile ; il s'en trouvait
jusque dans l'entourage et parmi les amis de
César. |

Jules César - Musée de Naples |
D'autres, anciens consuls, préteurs, gouverneurs de
province, qui avaient eu chacun deux ou trois ans de
royauté, ne se faisaient pas à l'idée de
tomber, eux les vainqueurs du monde, à la condition de
ces populations serviles de l'Orient toujours
prosternées aux pieds d'un homme. On comptait parmi
eux de fort honnêtes gens, Cicéron par exemple,
qui avait fait sa fortune par des discours et que le silence
exaspérait. N'ayant plus à parler, il
écrivait des livres sombres, comme la première
Tusculane sur le mépris de la mort, ce qui
voulait dire qu'on ne pouvait vivre sous le gouvernement de
César. D'autres personnages, nommés à de
hautes fonctions, montraient dans l'intimité les
mêmes colères, tout en jouissant grassement des
faveurs du maître : ainsi Turfanius qui commandait en
Sicile, Cornificius en Afrique, Servilius Isauricus en Asie,
Sulpicius en Grèce. Ils s'entretenaient
confidentiellement des malheurs de la république ; et
l'un d'eux, pour consoler Cicéron de la mort de sa
fille, lui écrivait : «La Fortune nous a ravi
des biens que nous devons aimer à l'égal de nos
enfants, la patrie, la dignité et tous nos honneurs.
Qu'est-ce qu'une nouvelle disgrâce ajoutée
à tous nos malheurs ? Dans les tristes temps où
nous vivons, ceux-là sont les plus heureux qui, sans
douleur, échangent leur vie contre la mort». La
patrie aimée à l'égal des enfants, c'est
bien ; mais, dans les mains de César, la patrie ne se
trouvait pas en péril ; une seule chose
l'était, et ils le disent eux-mêmes : leurs
honneurs et leurs dignités. Ils avaient raison de
regretter cette grande existence et quelques beaux discours
qu'on ne prononçait plus dans ce Forum où
cessaient de gronder les orages ; mais moins
d'éloquence et plus de sécurité
étaient un échange qui convenait alors au
monde, et nous aurions tort d'être pour cet ancien
régime qui, ayant donné tous ses effets utiles
et ne produisant plus que des maux, ressemblait à ces
instruments usés qu'il faut remplacer par une machine
nouvelle. En histoire, les machines nouvelles sont faites par
les réformes ou par les révolutions.
A Pharsale, on avait pu croire en y mettant quelque
complaisance que la lutte était le conflit de deux
ambitions qui s'éteindraient, comme celle de Sylla,
dans la jouissance de pouvoirs constitutionnels ;
après Thapsus, après Munda, personne ne pouvait
plus douter que la monarchie ne s'établît.
Depuis la fondation de la république, l'aristocratie
romaine avait adroitement nourri dans le peuple l'horreur
pour le nom de roi. Avec ce mot, elle s'était
débarrassée de Sp. Cassius, de Manlius, de
Maelius et du premier des Gracques ; avec lui encore elle
réussit à se délivrer de César.
C'est toi, s'écriait plus tard Cicéron
dans une de ses Philippiques contre Antoine, c'est
toi qui as tué César, aux fêtes des
Lupercales, quand tu lui as offert le bandeau royal. Et
Cicéron disait vrai. Si la solution monarchique
répondait aux besoins du temps, il était
à peu près inévitable que le premier
monarque payerait de la vie sa royauté, comme notre
Henri IV a payé de la sienne sa couronne.
Le chef de la conjuration était C. Cassius Longinus,
ce général qui avait sauvé
l'armée de Crassus, et, presque sans troupes,
défendu la Syrie contre les Parthes. Après
Pharsale, il avait été gracié, et
César venait de lui donner la préture avec le
gouvernement de la Syrie ; mais cette âme ambitieuse et
haineuse ne pardonna pas au dictateur d'avoir nommé
avant lui à la préture urbaine M. Junius
Brutus. Il avait de plus anciens griefs. Avant son
édilité, il nourrissait des lions à
Mégare : César les lui avait pris ; d'ailleurs
il se croyait fait pour jouer un grand rôle ; or tout
dépendait maintenant d'un seul, et, dans la faveur du
maître, il ne se sentait qu'au second rang. Il
résolut de l'abattre par l'assassinat, puisque la
guerre ouverte n'avait pas réussi. Des complices lui
étaient nécessaires ; naturellement il les
chercha dans le parti pompéien où, grâce
à tant de batailles, il ne voyait personne qui
pût un jour lui faire obstacle. Il sonda Brutus.
Neveu et gendre de Caton, Brutus était comme
l'héritier de ses vertus, et il finit par l'être
de sa passion pour ce gouvernement oligarchique qui
réservait l'égalité à un petit
nombre, mais donnait à ce peu d'hommes une
singulière grandeur. Il resta longtemps sans prendre
couleur. Si, durant la première guerre civile, il se
décida pour Pompée, l'assassin de son
père, ce fut avec fort peu d'ardeur, car la veille de
Pharsale, quand tout le camp était en tumulte, il
lisait tranquillement Polybe et l'annotait. Sa mère
Servilia avait été la plus vive et la plus
persévérante affection de César, qui,
avant l'action, recommanda qu'on prît soin
d'épargner Brutus. De Larisse, il envoya sa soumission
au vainqueur, en fut reçu avec bonté et obtint
de lui le gouvernement de la Cisalpine, quoiqu'il n'eût
pas encore géré de grandes charges. Il s'en
montra reconnaissant, ne rejoignit les pompéiens ni en
Afrique ni en Espagne ; et quand l'ancien consul Marcellus,
rappelé par le dictateur, tomba dans Athènes,
sous les coups d'un assassin, il composa un écrit pour
disculper César, qu'on accusait de ce meurtre. Aussi
Cassius, disait-on, ne hait que le tyran ; Brutus l'aime,
mais il déteste la tyrannie. Ce n'était point
tout à fait vrai, puisqu'on le voit solliciter sans
scrupule des charges de César, qui lui donna la
préture urbaine et le grand gouvernement de
Macédoine. Mais on fit le siège de cette
âme faible sous les dehors de la rigidité.
Cassius lui répétait que Rome serait
bientôt remplacée, comme capitale de l'empire,
par Ilion et Alexandrie, où leur maître irait
tenir sa cour royale. Atticus lui avait fabriqué une
généalogie qui, malgré l'histoire
fameuse de l'exécution des fils du premier Brutus, le
faisait descendre du vengeur des privilèges
aristocratiques. Pour le pousser, pour l'entraîner
à la conjuration, on lui montrait les grands, le
sénat et le peuple n'ayant plus qu'en lui
d'espérance ; on l'éblouit, on l'enivra de la
farouche doctrine du tyrannicide. Aux pieds de la statue de
l'ancien Brutus et sur le tribunal ou lui-même
siégeait comme préteur, il trouvait
écrit : O Brutus, plût au ciel que tu
vécusses encore ! - Ah ! si ton âme respirait
dans l'un de tes descendants ! Et : Dors-tu, Brutus ?
- Non, tu n'es pas Brutus !
Ce ne fut point sans de longs combats que l'ami de César succomba aux tentations. Pendant ses nuits sans sommeil, il se rappelait ce qu'il avait entendu chanter à Athènes au milieu des solennités religieuses... Sous le rameau de myrte, je porterai l'épée, comme Harmodios et Aristogiton, lorsqu'aux fêtes d'Athéné ils tuèrent le tyran. Il se répétait à lui-même : Nos ancêtres aussi ne croyaient pas qu'on pût supporter un maître. Dans une lettre très noble et très fière écrite plus tard, on lit ces dures paroles : Si mon père sortait du tombeau pour prendre une autorité supérieure aux lois et au sénat, je ne le souffrirais pas. Il succomba à ces sophismes d'école, où la politique n'avait rien à voir, et pour conserver au sénat un pouvoir qu'il confondait avec la liberté, il se décida au meurtre de l'homme qui lui avait tenu lieu de père. Ainsi que tous les fanatiques obsédés par une seule idée, il se crut l'instrument d'une vengeance nécessaire, et il célébrait comme le jour de sa délivrance celui où sa résolution fut arrêtée. |
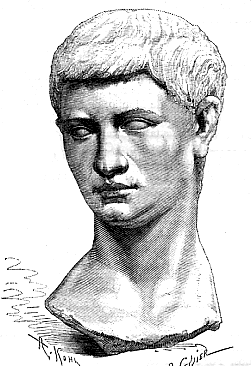
Brutus - Musée de Naples |
Son nom en gagna d'autres : Ligarius, qui oublia la
clémence de César ; Pontius Aquila, ancien
tribun, qui récemment avait pris sa charge au
sérieux, ce dont s'étaient fort amusés
le dictateur et ses amis ; Sextius Maso, Rubrius Ruga,
Caecilius Bucilianus et son frère ; Decimus Brutus, un
des meilleurs lieutenants de César, qui l'avait
richement récompensé, et L. Tullius Cimber, que
César avait aussi comblé de faveurs ; les deux
Casca ; Trebonius, général malheureux en
Espagne et qui ne trouvait pas suffisante, pour ses
mérites, la promesse d'un consulat prochain ;
Sulpicius Galba, irrité de s'être vu refuser
cette charge ; Minucius Basilus, un des officiers favoris du
dictateur, qui n'avait pas encore obtenu une province ;
Cassius de Parme, Antistius Labéon, Petronius,
Turullius, en tout une soixantaine : c'était bien plus
qu'il n'en fallait pour assassiner un homme qui ne se gardait
pas. Favonius, l'émule de Caton, n'avait pas perdu
l'expérience des quatre dernières années
: sondé par Brutus, il répondit que la plus
injuste monarchie était préférable
à la guerre civile. Cicéron, quoique lié
avec les principaux conjurés, ignora tout ; cependant
il méritait bien d'être du complot, puisque,
même avant Pharsale, il estimait la mort de
César nécessaire. Mais on douta de son courage,
et l'on eut raison. Le brillant avocat, demeuré,
malgré les caresses de César, l'ennemi d'un
régime où la parole n'était plus tout,
aurait hésité au moment de l'action et
gêné des hommes dont l'ambition ou le fanatisme
ne connaissait pas les scrupules.
Les avis ne manquèrent pas à César. Il
en vint du ciel, qu'après l'événement on
se racontait : des feux aperçus au milieu des airs,
des bruits nocturnes, l'apparition, au Forum, d'oiseaux
funèbres, les chevaux qu'il avait lâchés
au passage du Rubicon refusant de manger et versant des
pleurs, un devin qui l'avertit de se garder du jour des ides,
etc. Il eut des révélations plus
sérieuses : on lui parla d'un complot où Brutus
était entré : Brutus, dit-il en se
touchant, attendra bien la fin de ce corps
misérable. Cependant un jour qu'on dirigeait ses
soupçons sur Dolabella et Antoine : Ce ne sont pas
ces hommes si bons convives que je redoute, mais les gens au
visage blême et maigre. Il voulait désigner
Brutus et Cassius. Antoine était un fidèle
lieutenant, et César traitait Dolabella avec une
faveur que n'expliquaient ni son âge ni ses services.
C'était un jeune noble de turbulente nature, perdu de
dettes, rêvant de proscriptions pour les payer et
mécontent du dictateur, qui n'en faisait point. Il
était justement suspect, car on le verra, au lendemain
des ides de mars, tendre la main aux meurtriers.
César, sans le craindre, se gardait de lui. Lorsque,
hors de Rome, il passait devant la maison de Dolabella, les
soldats de sa cohorte prétorienne, au lieu de le
suivre, entouraient le cheval qu'il montait.
César s'impatientait de ces sourdes menaces et
refusait d'y croire, au moins d'y penser. Rome,
disait-il, est plus intéressée que moi
à ma vie ; et il avait renvoyé sa garde
espagnole. La veille des ides, soupant chez Lépide
avec un des conjurés, Decimus Brutus, la conversation
était tombée sur la mort : La meilleure,
avait-il dit, est la moins prévue ; mieux vaut
mourir une fois que de craindre toujours.
Les conjurés étaient inquiets, incertains.
Cassius voulait tuer Antoine et Lépide avec leur chef.
Brutus demanda qu'on ne frappât qu'un coup ; dans son
illusion, il croyait que, le tyran mort, la liberté
renaîtrait d'elle-même, et il ne voulait pas
ensanglanter son triomphe. En public, son maintien
était calme, son coeur décidé ; mais,
dans la solitude, la nuit surtout, son trouble et son
agitation révélaient les combats que se livrait
encore cette âme malade, contre son faux
héroïsme. Sa femme, Porcia, comprit qu'il
méditait quelque grand dessein ; pour éprouver
ses forces et son courage, avant de lui demander ce secret,
elle se fit, dit-on, à la cuisse une profonde
blessure.
Le jour des ides (15 mars 44), les conjurés se
rendirent de bonne heure au sénat ; plusieurs d'entre
eux, obligés comme préteurs de rendre la
justice, montèrent sur leur tribunal en attendant
César ; il n'arrivait pas : Calpurnie, troublée
par un songe affreux, avait voulu qu'il consultât les
victimes, et les devins lui avaient défendu de sortir.
Il se décida à renvoyer la séance
à un autre jour ; mais en ce moment Decimus Brutus
entra : il lui fit honte de céder aux vagues terreurs
d'une femme, et, lui prenant la main, il l'entraîna.
César avait à peine passé le seuil,
qu'un esclave étranger, qui n'avait pu lui parler
à cause de la foule, vint se remettre aux mains de
Calpurnie, en la priant de le garder jusqu'au retour de
César. Artémidore de Cnide, qui enseignait
à Rome les lettres grecques, lui remit tout le plan de
la conjuration. Lisez, lui dit-il, cet
écrit, seul et promptement. Il n'en put trouver le
temps. Les conjurés eurent d'autres sujets
d'inquiétude. Un homme dit à Casca : Vous
m'avez fait mystère de votre secret, mais Brutus m'a
conté l'affaire. Casca, fort étonné
et inquiet, allait tout révéler, quand l'autre
ajouta en riant : Et comment seriez-vous devenu en si peu
de temps assez riche pour briguer l'édilité
? Un sénateur, Popilius Lenas, ayant salué
Brutus et Cassius d'un air plus empressé qu'il ne
faisait ordinairement, leur dit à l'oreille : Je
prie les dieux qu'ils donnent une issue favorable au dessein
que vous méditez ; mais je vous conseille de ne pas
perdre un moment, car ce n'est plus un secret. Il les
quitta, leur laissant dans l'esprit de grands soupçons
que la conjuration ne fût découverte.
Cependant Porcia n'avait pu supporter l'angoisse de l'attente
; elle s'était évanouie, on la crut morte, et
un esclave courut l'annoncer à Brutus.
Maîtrisant sa douleur, il entra au sénat,
où César enfin arrivait. Aux portes de la
curie, ce même Popilius Lenas, qui savait tout, eut
avec César un long entretien auquel le dictateur
paraissait donner la plus grande attention. Les
conjurés, ne pouvant entendre ses paroles, craignaient
une dénonciation ; ils se regardaient les uns les
autres, s'avertissaient, par l'air de leur visage, de ne pas
attendre qu'on vînt les saisir et de prévenir
les licteurs par une mort volontaire. Déjà
Cassius et quelques autres mettaient la main sous leur robe
pour en tirer un poignard, lorsque Brutus reconnut aux gestes
de Lenas qu'il s'agissait, entre César et lui, d'une
prière très vive. Il ne dit rien aux
conjurés, parce qu'il y avait au milieu d'eux beaucoup
de sénateurs qui n'étaient pas du secret ;
mais, par la gaieté qu'il montra, il rassura Cassius,
et bientôt après, Lenas, ayant baisé la
main de César, se retira.
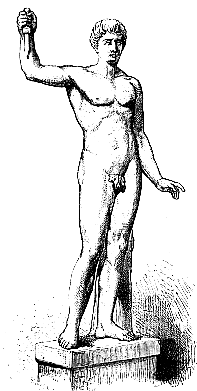
Brutus tenant le poignard |
Quand le sénat fut entré dans la salle, les conjurés environnèrent le siège de César, sous prétexte de l'attendre pour lui parler de quelque affaire ; et Cassius portant, dit-on, ses regards sur la statue de Pompée, l'invoqua, comme si elle eût été capable de l'entendre. Trebonius arrêta Antoine vers la porte et commença une conversation pour le retenir hors de la salle. Quand César entra, tous les sénateurs se levèrent, et, dès qu'il fut assis, les conjurés, se pressant autour de lui, firent avancer Tullius Cimber, récemment nommé gouverneur de Bithynie, qui lui demanda le rappel de son frère. Ils joignirent leurs prières aux siennes, prenant la main de César, lui baisant la poitrine et la tête. Il rejeta d'abord des prières si pressantes ; comme ils insistaient, il se leva pour les repousser de force. Alors Tullius lui arracha le haut de sa toge, et Casca, qui était derrière lui, le frappa d'un premier coup ; la blessure n'était pas profonde. César, saisissant la poignée de l'arme, s'écria en latin : Scélérat de Casca, que fais-tu ? Casca appela son frère à son secours en langue grecque. Atteint de plusieurs coups à la fois, César porta ses regards autour de lui pour chercher un défenseur ; quand il vit Brutus lever lui aussi le poignard, il quitta la main de Casca, qu'il tenait encore, et se couvrant la tête de sa toge, il livra son corps au fer des conjurés. Comme ils le frappaient tous à la fois, sans précaution, et qu'ils étaient serrés autour de lui, plusieurs furent blessés. Brutus, qui voulut avoir part au meurtre, reçut un coup à la main ; tous les autres furent couverts de sang. Le héros tomba aux pieds de la statue de Pompée. |