LXXXI - Antonin et Marc-Aurèle (138-180) |
III - STOICIENS ET CHRETIENS
Une autre faute pèse sur sa mémoire, la
persécution des chrétiens. Alors eut lieu le
premier grand choc du christianisme et de l'empire. Nous ne
pouvons omettre cette page sanglante de son règne, car
il s'y trouve un problème historique qui s'est
présenté souvent, qui reviendra toujours, et
qui fait, bien plus que les batailles, la grandeur dramatique
de l'histoire : pourquoi le passé qui s'en va ne
veut-il jamais comprendre l'avenir qui approche, et qui
demain sera le présent ?
La guerre qui avait brisé l'étroite enceinte de
la cité romaine avait aussi brisé l'enveloppe
étroite des systèmes ; les idées
s'étaient agrandies comme l'Etat. La
métaphysique avait peu gagné.
Détournés par les tendances pratiques de leur
génie des arguties où s'égarait l'esprit
subtil des Grecs, race disputeuse à qui suffisait
maintenant le cliquetis des mots, les Romains avaient
laissé de côté les discussions
théoriques pour aller droit aux conséquences
individuelles et sociales. Leurs philosophes n'avaient
été que des moralistes ; et ils l'avaient
été avec un caractère particulier. Une
paix deux fois séculaire, telle que le monde n'en
avait jamais connu, avait détendu les ressorts
violents de la nature humaine, adouci les passions farouches
que surexcitait la perpétuité des guerres, et
ouvert la source, jusqu'alors fermée, des sentiments
affectueux de chacun pour tous. La morale de Zénon et
de Cléanthe, qui se proposait moins de régler
la nature humaine que de la dompter par l'orgueil de
l'âme et par l'insensibilité du corps, perdit
peu à peu sa rudesse. L'esprit de charité
l'assouplit ; elle s'échauffa d'une tendresse
expansive, et sa fierté dédaigneuse se changea
en sympathique douceur. L'idée de l'humanité
entrevue dans la Grèce se précisa, et ce fut un
empereur qui écrivit : «L'Athénien disait
: O cité bien-aimée de Cécrops !
Et toi, ne peux-tu dire du monde : O cité
bien-aimée de Jupiter !» La pensée de
Marc-Aurèle va même plus loin que
l'humanité, elle embrasse la nature entière et
Dieu. Le monde est pour lui un cosmos divin : «O monde,
tout ce qui te convient m'accommode ! O nature, tout ce que
tes saisons m'apportent est un fruit toujours mûr
!» etc. Une nouvelle conception morale s'ajoutait donc
au trésor des idées généreuses
dont l'homme était en possession. L'ancien
stoïcisme n'avait que les deux principes
négatifs, sustine et abstine, supporte et
abstiens-toi ; le nouveau en avait trouvé un
troisième, le principe d'action nécessaire pour
féconder les deux autres : adjuva, aime les
hommes et assiste-les. Par ce mot, les stoïciens
rentraient dans la société d'où leur
orgueilleuse vertu les avait fait sortir.
Mais si l'humanité devenait une grande famille, il
fallait, dans l'ordre naturel, regarder les hommes comme des
frères et des égaux qui, ayant le même
sang, avaient droit aux mêmes égards. Dès
le temps de Néron, Sénèque
écrivait : Tous les hommes sont nobles, même
l'esclave ; tous sont frères, car ils sont tous fils
de Dieu.
En même temps désabusés de leurs dieux de
bois et de pierre, représentants inertes des forces
aveugles de la nature, les sages du paganisme, stoïciens
adoucis ou sectateurs du platonisme renouvelé,
s'efforçaient de pénétrer les secrets du
monde invisible. D'aucuns s'arrêtaient à la
conception de l'âme universelle de la nature, cause
première par laquelle tout vivait ; plusieurs
cherchaient, par delà le monde physique, cette cause
universelle qu'il ne renferme pas ; mais les uns et les
autres trouvaient un reflet de la pensée divine dans
la conscience individuelle par laquelle tout devait se
régler.
Ainsi, d'Aristote à Marc-Aurèle, la philosophie
n'avait cessé de développer les idées
d'humanité, de bienveillance mutuelle,
d'égalité morale ; elle finissait par arriver
à la Providence divine, qui était, pour le
philosophe impérial, ce qu'elle doit être pour
tous, la concordance nécessaire des causes et des
effets : Va droit, dit-il, selon la loi et suis
Dieu, qui est le guide et le terme de ta route.
Cléanthe avait déjà chanté, dans
un hymne magnifique, la loi commune de tous les êtres.
La philosophie, qui avait d'abord été un cri de
révolte, était donc devenue le sentiment du
devoir, car ce qui en faisait alors l'idée dominante,
c'était la soumission à la loi que chacun peut
découvrir par l'étude
persévérante de soi-même.
Si les apologistes du second siècle et tant de
docteurs trouvaient des chrétiens avant le Christ, nul
ne le fut, dans son coeur, autant que Marc-Aurèle,
puisque jamais homme n'a porté plus loin le
désir du perfectionnement intérieur et l'amour
de l'humanité. Aussi est-il resté la plus haute
expression de ce stoïcisme épuré qui
confinait au christianisme sans y entrer et sans lui rien
prendre. Après sa mort, on découvrit dans une
cassette dix fascicules de tablettes, écrites pour lui
seul, sans plan, sans ordre, selon la pensée du jour ;
que nul oeil n'avait vues, que nul peut-être ne devait
voir ; et ce dialogue avec son âme, ces
méditations solitaires, ont fait un livre de morale
sublime. Pour lui, l'être vertueux est un prêtre
du Dieu intérieur, c'est-à-dire de la
conscience. «Que le Dieu qui est en toi, dit-il en
s'adressant à lui-même, gouverne un homme
vraiment homme, un citoyen, un Romain, un empereur».
Mais ce Romain, cet empereur, il le veut doux, compatissant,
ami des hommes. «Pense que les hommes sont tes
frères, et tu les aimeras. - Peux-tu dire : Jamais
je n'ai fait tort à personne, ni en actions ni en
paroles ? Si tu le peux, tu as rempli ta tâche. -
Dans un instant tu ne seras que cendre et poussière ;
en attendant que ce moment arrive, que te faut-il ? Honorer
les dieux et faire du bien aux hommes. Mais en quoi consiste
le bien ? A agir selon la droite raison, orthos logos,
qui est une émanation de la raison universelle, et
conformément à la volonté divine, qui
est la souveraine justice. - Ainsi l'humanité nous
commande d'aimer comme nos frères ceux mêmes qui
nous ont offensés ; et une seule vengeance est
permise, ne pas imiter ceux dont nous avons à nous
plaindre. - Ce n'est pas assez de faire le bien, il faut le
faire pour lui-même, sans aucune pensée de
retour. Tu te plains d'avoir obligé un ingrat et tu
aurais voulu être récompensé de ta peine,
comme si l'oeil demandait son salaire parce qu'il voit, ou
les pieds parce qu'ils marchent. Le cheval qui a couru, le
chien qui a chassé, l'abeille qui a fait son miel,
l'homme qui a fait du bien, ne le crient pas par le monde,
mais passent à un autre acte de même nature,
comme fait la vigne qui donne d'autres raisins lorsque
revient la saison nouvelle». S'abstenir même de
la pensée du mal, en façonnant son âme
à l'image de la divinité ; supporter avec
résignation les injures ; aimer des hommes ; sacrifier
jusqu'à ce qu'on a de plus cher à
l'accomplissement du devoir, voilà tout
Marc-Aurèle. Et il croyait que cette virile religion
du devoir pouvait suffire à l'humanité. Erreur
d'un noble esprit, dans laquelle il est beau d'être
tombé et qui, Dieu merci, dure encore pour quelques
âmes héroïques ! Mais quand
deviendra-t-elle la foi et la règle de la multitude
?
Cette philosophie simplifiait la vie, en ne parlant pas de la
mort ; ou du moins, en ne s'inquiétant pas de ce qui
peut se trouver par delà le tombeau, elle se
désintéressait des questions qui ont le plus
troublé l'âme humaine. D'abord elle avait
célébré la sortie raisonnable,
eulogos exagôgê, par laquelle l'homme rend
de lui-même à la nature les
éléments qu'elle lui avait un instant
prêtés ; et l'on a vu, de Tibère à
Vespasien, une véritable épidémie de
suicide. Marc-Aurèle, l'homme de la loi, condamne la
mort volontaire comme une défaillance : «Celui,
dit-il, qui arrache son âme de la société
des êtres raisonnables, transgresse la loi ; le
serviteur qui s'enfuit est un déserteur». Aussi
réprouve-t-il ce qu'il appelle
l'opiniâtreté des chrétiens cherchant la
mort avec un faste tragique. Mais il accepte l'arrêt de
la nature, sans emportement, fierté, ni dédain,
puisque la mort est une conséquence nécessaire
des lois du monde. «Plusieurs grains d'encens, dit-il,
sont destinés à brûler sur le même
autel ; que l'un tombe dans le feu plus tôt, l'autre
plus tard, où est la différence ?» Et
encore : «Il faut quitter la vie comme l'olive
mûre tombe en bénissant la terre, sa nourrice,
et en rendant grâce à l'arbre qui l'a
portée». Sa vertu n'était pas un
marché fait avec le ciel, il avait trouvé en
elle sa récompense et il n'attendait rien des dieux ;
le silence éternel des espaces infinis ne l'effrayait
pas.
Cependant cette pensée l'obsède plus qu'il ne
l'avoue. «Qu'importe, dit-il, l'être ou le
néant au sortir de ce monde ? Ou je ne serai plus rien
ou je serai mieux». Et il ne sera mieux qu'à la
condition d'avoir obéi à la raison, au devoir,
c'est-à-dire à la loi divine. Le philosophe
pratique échappait ainsi aux contradictions de son
système qui renferme la destinée de l'homme en
ce monde, et il sauvait la morale qui, après tout, est
la grande affaire, puisque la morale n'est que la loi de Dieu
découverte par la raison pure et fidèlement
observée.
Dans le livre des Pensées, la méthode,
c'est-à-dire l'étude persévérante
de soi-même, et l'exquise pureté des sentiments
sont de Marc-Aurèle, mais le fond des idées
appartient à son temps. Il suffirait, pour s'en
convaincre, de lire les premiers chapitres où il rend
à chacun de ses maîtres, de ses proches et de
ses amis ce qu'il en a reçu. Par la doctrine du
logos qui réunit l'homme à Dieu et les
hommes entre eux, les nouveaux stoïciens avaient
dégagé ce principe, fondement de la
société humaine et de la cité divine,
qu'il faut honorer le génie divin qui est en nous, par
la pureté morale, et celui qui est dans nos semblables
par la charité. Or l'histoire nous a montré ces
idées sortant de l'école pour
pénétrer dans la loi civile, qu'elles changent,
et jusque dans l'administration, qu'elles modifient. Des
jurisconsultes, tels que le monde n'en a pas revu, se
succédant durant deux siècles sans
interruption, avaient fait du vieux droit quiritaire, d'abord
adouci par le droit des gens, puis par le droit naturel,
cette législation qu'on a appelée la raison
écrite ou, comme dit Ulpien, la très sainte
sagesse civile. Celsus, un ami d'Hadrien,
définissait le droit la science du bien et du
juste ; et Justinien faisait placer en tête de ses
Pandectes ces trois sentences d'Ulpien : Les
préceptes du droit sont : vivre honnêtement, ne
léser personne, accorder à chacun ce qui lui
est dû. Le droit devenait une religion, celle de la
justice, et les prudents s'en disaient avec fierté les
pontifes. L'esprit d'équité, que les
jurisconsultes faisaient entrer dans la loi, entrait aussi
dans le gouvernement : Rome impériale communiqua ses
droits civils et politiques à ceux que Rome
républicaine avait appelés l'étranger,
l'ennemi, et on a vu les Antonins adoucir la condition de la
femme, du fils, de l'esclave ; donner l'assistance à
l'enfant pauvre, un médecin au malade, des
funérailles au malheureux qui n'avait pu se payer un
bûcher ou un tombeau.
Tandis que Marc-Aurèle, dans ses veillées
anxieuses au pays des Quades, écrivait ce livre des
Pensées dont un cardinal a dit : «Mon
âme devient plus rouge que ma pourpre au spectacle des
vertus de ce gentil», au fond des grandes cités,
des hommes, souvent en haillons, se réunissaient dans
l'ombre pour chercher aussi le monde invisible. Or voici les
paroles qu'ils entendaient : «Si vous aimez ceux qui
vous aiment, que faites-vous de nouveau ? Les gens de
mauvaise vie le font aussi. Mais moi je vous dis : Priez pour
vos ennemis, aimez ceux qui vous haïssent et
bénissez ceux qui vous maudissent. - Vous savez qu'il
a été dit : Tu ne tueras point ; mais moi je
vous dis que celui qui se mettra en colère contre son
frère méritera d'être condamné par
le conseil. Si donc, quand vous apportez votre offrande
à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a
quelque chose contre vous, laissez lit votre don et courez
vous réconcilier avec lui ; vous viendrez ensuite,
présenter votre offrande. - Vous savez qu'il a
été dit : Oeil pour oeil, dent pour dent
; et moi je vous dis : Si quelqu'un vous frappe sur la
joue droite, présentez-lui la joue gauche. Si
quelqu'un veut plaider contre vous pour avoir votre robe,
abandonnez-lui encore votre manteau.
Une autre fois, Jésus leur disait : Quand le Fils de
l'homme viendra sur les nues, accompagné de tous ses
anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire,
et toutes les nations étant assemblées devant
lui, il les séparera les unes d'avec les autres, comme
un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il
placera les brebis à sa droite et les boucs à
sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront
à sa droite : Venez, vous qui avez été
bénis par mon Père ; possédez le royaume
du ciel : car j'ai eu faim, et vous m'avez donné
à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné
à boire ; j'étais nu, et vous m'avez vêtu
; j'étais malade, et vous m'avez soigné ;
j'étais en prison, et vous m'avez visité. - Les
justes diront : Quand est-ce, Seigneur, que vous avez eu faim
et que nous vous avons donné à manger, ou soif
et que nous vous avons donné à boire ? Et le
roi leur répondra : autant de fois vous avez fait cela
à l'égard d'un des plus petits de mes
frères, c'est à moi-même que vous l'avez
fait».
Ainsi le ciel depuis si longtemps fermé s'ouvrait ;
l'âme, comme dit Platon, retrouvait des ailes. Les plus
sages parmi les païens bornaient fièrement leurs
espérances à cette vie, l'Evangile
étendant les siennes à
l'éternité. Notre séjour ici-bas, au
lieu d'être la fin, n'était qu'un temps
d'épreuves, un voyage dans un lieu d'exil ; la
richesse et les honneurs devenaient un danger, la
pauvreté et la souffrance une promesse, la mort une
délivrance. Jusqu'alors la religion avait
été un culte de terreur ou de plaisir : elle se
présentait comme le culte de l'amour. Elle avait
parlé aux sens et à l'imagination, elle parla
au coeur. Quand l'apôtre Jean, n'ayant qu'un souffle de
vie, se faisait porter au milieu des fidèles, il leur
disait ces seuls mots : Aimez-vous les uns les autres,
c'est toute la loi. Comment s'étonner que les
pauvres, les infirmes, les esclaves, tous les
réprouvés de la société
païenne, tous ceux qui, souffrant du corps ou de
l'âme, avaient besoin d'amour et d'espérance,
que les femmes surtout, soient accourus à la Bonne
nouvelle, et que tant de communautés
chrétiennes se soient rapidement formées
?
Ainsi, le dogme mis à part, l'humanité
murmurait alors les mêmes paroles sous les lambris
dorés et dans la hutte des misérables, par la
bouche du prince et par celle de l'esclave. Ceux donc qui
pensaient comme Marc-Aurèle ou qui méditaient
le Manuel d'Epictète, dont un saint fit plus
tard la règle de ses moines, étaient faits pour
s'entendre avec ceux qui lisaient le sermon sur la montagne
ou les paraboles de Jésus. Et pourtant entre eux se
trouva un abîme, ou plutôt une masse encore
impénétrable de passions,
d'intérêts et de superstitions, que
protégeaient l'ancien ordre social et ses lois
meurtrières.

Jupiter Ammon
|
Le vieux culte, que rien ne soutenait, croulait de toutes parts. Les oracles s'étaient tus, accusés par les païens eux-mêmes d'imposture. Les temples restaient déserts, et Lucien, qui écrivait au temps de Marc-Aurèle, poursuivait impunément les dieux du fouet de son impitoyable satire. Les anciens maîtres de l'Olympe ne lui inspiraient pas plus de respect qu'à Sénèque, et les nouveaux venus l'irritaient. «D'où sont tombés au milieu de nous, fait-il dire à Momus, cet Atys, ce Corybas, ce Sabazios ? Quel est ce Mède Mithra, coiffé de la tiare ? Il ne comprend pas le grec et ne sait ce qu'on lui veut quand on lui porte une santé. Les Scythes et les Gètes, voyant combien il est facile de faire des immortels, se sont cru le droit d'inscrire sur nos registres leur Zamolxis, un esclave qui se trouve ici, je ne sais pourquoi. Encore si nous n'avions pas l'Anubis à tête de chien et le taureau de Memphis ! Mais ils ont des prêtres et rendent des oracles. Et toi, grand Jupiter, comment trouves-tu ces cornes de bélier qu'on t'a plantées sur le front ?» |
Voilà les sentiments des lettrés, et ce
mépris pour le polythéisme traditionnel les
conduisait, comme Marc-Aurèle, Apulée et tant
d'autres, à la conception d'un Dieu unique. Mais, dans
la foule ignorante, on comblait le vide que laissait au fond
des âmes la ruine du culte officiel par des
dévotions étranges ; l'Orient débordait
sur l'Occident avec ses mille superstitions. Après une
longue éclipse, l'esprit grec s'était
réveillé, non plus limpide comme aux beaux
jours de la civilisation hellénique, mais
mêlé d'éléments impurs, confus,
inquiet, courant après l'impossible, jusqu'aux folies
des mystiques. Devant lui reculait le simple génie de
Rome et des nations transalpines. Les prêtres de la
Perse, de l'Egypte, de la Syrie, les astrologues, les
nécromanciens, les sibylles, les prophètes, ces
chercheurs de l'avenir à qui l'avenir échappe
toujours, mais qui, à certaines époques, se
saisissent du présent, inondaient les cités et
attiraient la foule. Apulée, un contemporain de
Marc-Aurèle, nous montre, par la terreur qu'inspirait
la magie, l'importance qu'avaient alors les magiciens : ils
prétendaient posséder quatre-vingts moyens
assurés de contraindre le Destin à leur
répondre. Ainsi en arrive-t-il chaque fois qu'une
forte croyance s'alanguit ou chancelle : à la fin du
moyen âge, les sorciers pullulèrent ; à
la fin des temps modernes, les illuminés.
Pour ces exploiteurs, habiles ou convaincus, de la
crédulité populaire, pour les philosophes qui
voulaient, comme avaient dit Epicure et Lucrèce,
délivrer le monde des chaînes de la
superstition, les chrétiens étaient des ennemis
naturels. D'autres leur prêtaient tous les crimes : ils
mangeaient des enfants, accusation que les chrétiens
répéteront contre les juifs, au moyen âge
; ils célébraient tour à tour l'union
incestueuse d'Oedipe et le festin abominable de Thyeste. Ou
bien l'on transformait leurs espérances du ciel en
appétits tout terrestres, et l'on voyait dans leurs
doctrines un péril social qui certainement s'y
trouvait, puisque l'Eglise ne pouvait triompher que par la
ruine de l'ordre établi. Et nous ne parlons pas des
hérésies qui voilaient aux yeux des païens
la figure du Christ sous des additions étranges et
parfois monstrueuses. Aussi, pour ceux qui, regardant de loin
et mal, confondaient tout, le christianisme paraissait une
révolte non seulement contre l'empire, mais contre
toutes les lois humaines.
Lisez ce que raconte l'auteur d'un dialogue mis dans les
oeuvres de Lucien. Ne dirait-on pas un conservateur
effaré tombant au milieu d'un club démagogique
?
«Je m'en allais par la grande rue, quand
j'aperçus une multitude de gens qui se parlaient tout
bas. Je m'approche et je vois un petit vieillard tout
cassé, qui, après avoir bien toussé et
craché, se mit à dire d'une voix grêle :
«Oui, il abolira les arrérages des tributs ; il
payera les dettes publiques ou privées et recevra tout
le monde sans s'inquiéter de la profession», et
mille sottises pareilles que la foule écoutait
avidement. Survient un autre frère, sans chapeau ni
souliers, et couvert d'un manteau en loques : «J'ai vu,
dit-il, un homme mal vêtu, les cheveux rasés,
qui arrivait des montagnes. Il m'a montré le nom du
libérateur écrit en signes : il couvrira d'or
la grande rue. - Ah ! m'écriai-je enfin, vous me
faites l'effet d'avoir beaucoup dormi et longtemps
rêvé ; vos dettes s'augmenteront au lieu de
diminuer, et tel qui compte sur beaucoup d'or perdra
jusqu'à sa dernière obole». Cependant un
des assistants me persuade de me trouver au rendez-vous de
ces fourbes. Je monte au haut d'un escalier tortueux et
j'entre, non dans la salle de Ménélas, toute
brillante d'or, d'ivoire et de la beauté
d'Hélène, mais dans un méchant galetas,
on je vois des gens pâles, défaits,
courbés contre terre. Dés qu'ils
m'aperçoivent, ils me demandent tout joyeux quelles
mauvaises nouvelles je leur apporte ! «Mais tout va
bien dans la ville, leur répondis-je, et l'on s'y
réjouit fort». Eux, fronçant le sourcil
et secouant la tête : «Non pas, disent-ils, la
ville est grosse de malheurs». Alors, comme des gens
sûrs de leur fait, ils commencent à
débiter mille folies : que le monde va changer de face
; que la ville sera en proie aux dissensions ; que nos
armées seront vaincues. Ne pouvant plus me contenir,
je m'écrie : «Misérables ! Cessez vos
indignes propos, et que les malheurs où vous voulez
voir votre patrie plongée retombent sur vos
têtes !»
Et Critias s'en va, maugréant contre ces hommes qui
marchent dans les airs et qui lui semblent haïr le beau,
se réjouir du mal, parce qu'il n'a rien compris
à leurs espérances. Eux et lui parlent, avec le
même idiome, deux langues étrangères, et
ils habitent dans la même cité deux patries
différentes. Ainsi en est-il souvent des idées
qui germent dans l'ombre et qui, longtemps méconnues,
sont bafouées ou proscrites avant de s'imposer.
Marc-Aurèle avait-il lu les Apologies
présentées à ses deux
prédécesseurs et à lui-même ? On
ne saurait le dire. S'il les connaissait, le Logos de
saint Justin avait dû lui plaire. Mais, d'accord avec
les chrétiens par le sentiment, il ne l'était
plus par la doctrine théologique, qui, si souvent, a
empêché des âmes soeurs de s'entendre.
Avec ses idées stoïciennes sur l'âme du
monde, dont les différents dieux étaient la
manifestation extérieure, il ne pouvait comprendre le
dogme chrétien de la Trinité, ni ce Dieu fait
homme au sein d'une vierge. Et comme il ne comptait, pour sa
récompense, que sur la satisfaction trouvée
dans l'accomplissement du devoir, comme il ne demandait rien
aux espérances d'une vie future, il estimait
misérable qu'on propageât parmi les simples
cette croyance à la résurrection glorieuse de
la chair et de l'esprit, que les sages n'avaient point
découverte au fond de leur raison. Ces deux doctrines,
dont l'une sacrifiait le ciel à la terre, l'autre la
terre au ciel, étaient nécessairement ennemies.
Dans l'annonce du règne de Dieu, attendu par les
fidèles, Marc-Aurèle voyait, en outre, une
menace pour l'empire, et dans la prophétie de la
sibylle sur la prochaine destruction de Rome, une
impiété sacrilège.
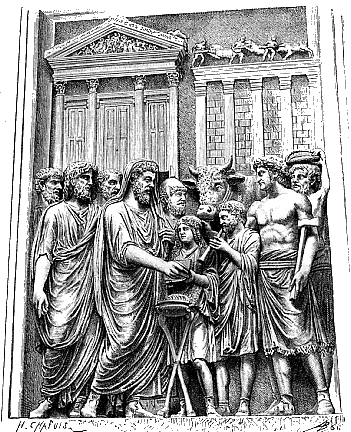
Marc Aurèle sacrifiant devant le temple de Jupiter |
Enfin, s'il rejetait les scandaleuses histoires de
l'Olympe, il observait religieusement les rites en l'honneur
de ces dieux que son esprit avait épurés et
doctrinalement rattachés à la cause
première. Il n'était donc pas, comme Hadrien,
un sceptique, par conséquent un tolérant ; la
philosophie avait fait de lui un païen d'une
espèce particulière, un païen qui restait
convaincu et très dévot ; de plus, il
était prince, et le fond de sa morale étant la
soumission absolue de l'individu aux lois de la raison, le
fond de sa politique fut la soumission absolue du citoyen aux
lois de l'Etat. Aussi, quand, aux premiers jours de son
règne, la populace, affolée de terreur par la
famine et les inondations, s'ameuta contre les fidèles
et demanda leur supplice pour apaiser ses dieux, il laissa le
préfet de Rome, Junius Rusticus, son ancien
maître, appliquer les lois. Parmi les condamnés
se trouva saint Justin, qui semble être allé
au-devant du supplice par la généreuse
véhémence de sa seconde Apologie. Il n'y
eut cependant pas de rescrit du prince, car Tertullien, qui
vivait du temps de Marc-Aurèle, assure qu'il n'en
promulgua point ; mais des victimes furent frappées
par les édits particuliers de quelques gouverneurs, ce
qui, au témoignage de saint Méliton, ne
s'était jamais vu : ainsi périrent deux
évêques de l'Asie proconsulaire, à Smyrne
et dans Laodicée. Vers la fin de ce règne, en
177, il y eut, à Lyon, une grande exécution
causée par une émeute populaire. Eusèbe
nous a conservé une lettre dans laquelle les
chrétiens de cette ville racontent à leurs
frères d'Asie les douleurs de la naissante Eglise.
C'est donc un document contemporain où l'on voit en
action les violences du peuple, la crédulité du
juge et la foi ardente que donnait l'espérance de
l'immortalité.
«D'abord on nous chassa des bains, des places publiques
et de tous les lieux ouverts aux citoyens ; puis nous
eûmes à souffrir les outrages, les coups, les
violences d'une multitude en fureur». Voilà le
premier acte : la foule s'irrite contre des hommes qui, par
le fait seul d'être chrétiens, insultent
à tout ce qu'elle croit et à tout ce qu'elle
aime, à sa religion et à ses plaisirs. La
persécution commence par une émeute.
Le second acte est marqué par l'intervention de
l'autorité. Chargé de maintenir la paix dans la
ville, le magistrat rend les chrétiens responsables du
désordre dont ils ont été l'occasion. Un
tribun et ses soldats les mènent au forum ; sur leur
aveu qu'ils sont chrétiens, les duumvirs leur
appliquent la loi de Trajan : ils sont saisis et
enfermés dans une prison, jusqu'au retour du
gouverneur. Celui-ci, revenu, les interroge du haut de son
tribunal, près duquel est accourue une foule que les
soldats contiennent avec peine. Cependant la procédure
est lente et les formes sont observées. L'aveu public
de christianiser suffisait pour la condamnation, mais le juge
a entendu parler d'autres crimes, il veut les connaître
et ordonne une enquête.
Dans ce drame terrible et toujours le même des
émeutes produites par la surexcitation populaire,
l'excès de la crédulité égale
l'audace du mensonge inconscient ; dans tous les temps et en
tout pays, la passion, la peur, fournissent aux imaginations
troublées des accusations qu'elles acceptent avec
avidité. «On fit venir les serviteurs
païens des athlètes du Christ, à qui la
crainte des tortures et les sollicitations des soldats firent
avouer que nous commettions toutes les abominations. Lorsque
ces calomnies furent répandues dans le public, on
conçut une telle colère contre nous, que nos
proches mêmes partagèrent la fureur du
gouverneur, des soldats et du peuple».
Cependant un citoyen romain, riche et influent dans la ville,
Vettius Epagathus, sortit de la foule et dit au gouverneur :
«Je demande à défendre ces hommes et je
m'engage à prouver qu'ils n'ont commis aucun des
crimes qu'on leur reproche. - Tu es donc chrétien
toi-même, que tu veuilles prendre en main leur cause ?
- Je le suis». Aussitôt on le saisit et on le
plaça parmi les accusés sous l'inculpation
d'être l'avocat des chrétiens.
Plus de dix d'entre eux, vaincus par les menaces,
renièrent leur foi et promirent de sacrifier aux dieux
; mais les autres confondirent les bourreaux par leur
sérénité. Une jeune esclave, Blandine,
faible et maladive, trouva des forces dans le supplice. Du
matin au soir, on la tortura ; son corps ne formait qu'une
plaie, ses os étaient comme brisés, ses
articulations disjointes ; mais un seul cri
s'échappait de sa poitrine : Je suis
chrétienne ; on ne fait point de mal parmi nous !
L'exaltation de la foi rendait la chair insensible.
Les tourments étant inutiles, on chargea les victimes
de chaînes, qui leur servaient d'ornement, comme les
franges d'or à la robe d'une jeune mariée, et
on les jeta dans un cachot infect où beaucoup
périrent. Pothin avait alors quatre-vingt-dix ans.
«Son âme, dit Eusèbe, n'habitait plus son
corps que pour rendre un dernier témoignage au
triomphe du Christ. Quel est le Dieu des chrétiens ?
lui demanda le juge. - Tu le connaîtras quand tu en
seras digne», répondit-il. On le mena à
la prison au milieu des insultes de la foule ; il y mourut le
troisième jour.
Quatre des captifs furent d'abord condamnés : Attale,
comme citoyen, à avoir la tête tranchée ;
Sanctus et Maturus, comme provinciaux, Blandine, comme
esclave, à être jetés aux bêtes. La
lettre des fidèles de Lyon exprime avec une
grâce naïve ce mélange de toutes les
conditions. Les martyrs offraient à Dieu une couronne
nuancée de diverses couleurs, où toutes sortes
de fleurs brillaient assorties. On avait
décrété tout exprès un jour de
fête pour leur exécution. La veille, les
condamnés firent en public leur dernier souper, et le
lendemain ceux qui étaient destinés aux
bêtes furent amenés dans l'arène. Attale,
qui ne pouvait être exécuté sans un ordre
de l'empereur, avait été retenu dans la prison.
Lorsque la foule vit qu'il manquait à ses plaisirs,
elle le demanda à grands cris. On l'amena, et il fit
le tour de l'amphithéâtre avec cet
écriteau sur la poitrine : Voici Attale le
chrétien. La foule rugissait de
férocité ; elle se dédommagea sur les
autres martyrs. Des bêtes les eussent tués d'un
coup de dent. On ne fit pas venir les bêtes, mais ce
fut à qui imaginerait une torture nouvelle, un
supplice oublié. Des cris partis de tous les bancs de
l'amphithéâtre excitaient les bourreaux.
Maintenant les coins, les tenailles, les lames de cuivre
ardentes ; déchire, mais ne tue pas ! Quand il n'y
eut plus sur ces pauvres corps une place où la torture
n'eût passé, on les mit sur une chaise de fer
rougie au feu, puis un coup d'épée leur
ôta le dernier reste de vie. Blandine avait tout vu,
attachée nue à un poteau au milieu de
l'amphithéâtre ; on lâcha les bêtes
contre elle, mais elles ne la touchèrent pas, et le
peuple, lassé, remit sa mort à une autre
fête. Ce jour-là il n'y eut pas de gladiateurs,
les combattants du Christ avaient assouvi les joies
féroces de la multitude.
La persécution porta aussitôt ses fruits ; les
autres captifs se sentirent affermis, et les apostats
revinrent, à leur foi, appelant les supplices pour
prouver la sincérité de leur retour :
«Les membres vivants de l'Eglise avaient
ressuscité les membres morts».
Marc-Aurèle, consulté au sujet des
accusés qui étaient citoyens, avait
répondu qu'il fallait suivre la loi : décapiter
ceux qui persisteraient, renvoyer ceux qui nieraient. Lyon
allait célébrer, le 1er août, la
fête de toute la Gaule ; on reprit le procès et
on le fit marcher rapidement ; il fallait être
prêt pour les jeux.
C'est l'honneur de la nature humaine que l'injustice la
révolte, l'exalte et fasse naître cette
contagion du dévouement qui a donné des martyrs
à toutes les grandes causes, parfois à de
mauvaises. Pendant les nouveaux interrogatoires, un homme qui
se trouvait parmi les spectateurs fut touché du
courage des victimes et leur montra une pitié dont la
foule s'irrita. On le dénonce aussitôt au
gouverneur. «Qui es-tu ? lui demande celui-ci. -
Chrétien», répond-il, et il va s'asseoir
au milieu des martyrs. Le jour des fêtes arriva.
Dix-huit confesseurs avaient déjà
succombé à leurs souffrances dans la prison ;
deux avaient péri dans l'amphithéâtre ;
vingt-huit restaient réservés à la mort,
les uns par le fer comme étant citoyens, les autres
par les bêtes.
Deux Grecs, venus de bien loin pour trouver la commune
patrie, inaugurèrent les jeux : Attale de Pergame et
Alexandre de Phrygie. Ils passèrent par toutes les
tortures accoutumées : Attale, sur la chaise ardente,
montrant la fumée de sa chair brûlée, qui
se répandait sur l'amphithéâtre, dit
seulement : «En vérité, c'est manger des
hommes que de faire ce que vous faites ; mais nous, nous n'en
mangeons pas». Manger des enfants ! Voilà
l'accusation qui avait provoqué l'émeute, par
suite le procès et les supplices.
Blandine et Ponticus avaient assisté dans une loge au
sinistre spectacle. On les réservait pour le dernier
jour des fêtes. Quand on les amena, la foule eut un
moment de pitié. Ils étaient si jeunes !
Ponticus avait à peine quinze ans. Jurez par les
dieux, leur crièrent mille voix. Blandine
raffermit le courage de son compagnon, et il souffrit tous
les tourments jusqu'à ce qu'il rendît l'esprit.
Pour elle, elle allait à la mort comme si elle
fût allée à un festin de noces. On
épuisa tout contre elle. Après les coups de
fouet, les morsures des bêtes, la chaise ardente ; elle
fut enveloppée dans un filet, et on lança sur
elle un taureau furieux. «Ainsi, dit Eusèbe, la
bienheureuse Blandine partit la dernière, pareille
à une mère courageuse qui, après avoir
soutenu ses enfants pendant le combat, les envoie en avant
vers le roi, pour lui annoncer la victoire». Quel
renversement d'idées ! Quelle révolution dans
les relations sociales ! Lyon, chrétien, allait
vénérer et mettre à la place d'honneur
la pauvre esclave que la vieille société
méprisait et tenait sous ses pieds.
Les autres condamnés étaient tous Romains :
douze hommes et autant de femmes. Ce dernier chiffre montre
avec quel succès la foi nouvelle avait parlé au
coeur de celles que Dieu a faites pour aimer. On les avait
décapités près de l'autel d'Auguste.
Leurs corps furent donnés aux chiens ou
brûlés et les cendres jetées dans le
Rhône. On voulait qu'il ne restât pas d'eux un
débris, afin de ruiner, par ce complet
anéantissement du corps, l'espérance de la
résurrection de la chair. Voyons maintenant, disaient
les païens, s'ils ressusciteront.
Cette exécution retentissante excita le zèle
païen de quelques gouverneurs, celui surtout du
proconsul d'Afrique, qui envoya au supplice Namphamo et ses
compagnons, les premiers martyrs africains. On peut regarder
aussi les Scillitains mis à mort le 17 juillet 180
comme des victimes de la détestable politique
inaugurée par Marc-Aurèle.
Quand l'Eglise triomphante se fut attribué la
décision souveraine de ce qu'il faut croire et de ce
qu'il faut faire, elle envoya, à son tour, des
victimes au supplice. Trajan et Marc-Aurèle frappaient
des hommes qui refusaient d'obéir à certaines
lois de l'Etat ; les inquisiteurs brûlèrent des
gens qui ne pensaient pas comme eux sur les choses du ciel.
Les premiers croyaient défendre la
société ; les seconds croyaient défendre
la religion ; les uns et les autres se trompaient. D'un rude
soldat comme Trajan l'erreur n'étonne pas ; elle
surprend de la part de Marc-Aurèle, qui aurait
dû comprendre que son devoir de philosophe et d'homme
était de regarder au fond de ces doctrines pour les
juger, et son devoir de prince de peser ces accusations pour
les confondre. Mais il n'aimait ni les livres, ni les
sciences, ni l'histoire, qui lui aurait donné une
vertu qu'elle communique, la tolérance, et il ne se
plaisait qu'à la spéculation pure, qui, comme
un vin trop généreux, souvent enivre et
aveugle. Toute faute politique traîne après elle
son châtiment ; cette société qui riait
aux souffrances des chrétiens est encore sous la
malédiction de l'Eglise, qu'elle ne mérite pas
en tout ; et les exécutions ordonnées ou
permises par Marc-Aurèle ont laissé une tache
sur le nom le plus pur de l'antiquité.
Il faut dire aussi que, séduite par cette
pureté, l'histoire fait à cet empereur une
place trop grande. Dans ce règne de dix-neuf ans, on
ne trouve ni institutions nouvelles, ni bonne guerre, ni
bonne paix ; seulement un grand livre. C'est assez pour le
penseur, c'est trop peu pour le chef d'empire. Mettons-le
donc au nombre des hommes à qui nous devons le plus de
respect ; mais ne le mettons pas au rang des princes qui ont
le mieux mérité de leur pays. Platon disait, et
Marc-Aurèle répète avec lui : Heureux
les peuples, si les philosophes étaient rois ou si les
rois philosophaient ! A chacun son oeuvre : le philosophe
à l'école, et le prince aux affaires.
Je ne voudrais pas finir en paraissant jeter une ombre trop
forte sur cette belle figure. Il est deux sortes de
politiques : ceux qui se préoccupent surtout de
l'utile et ceux qui songent davantage à
l'honnête. Les uns mènent les hommes par leurs
intérêts ; les autres essayent de les prendre et
de les conduire par les sentiments élevés de
leur nature. Ces derniers échouent souvent, mais ils
s'honorent toujours. Marc-Aurèle était de ce
nombre. Aussi lorsque, sur la place du Capitole, on contemple
sa statue équestre, oeuvre magnifique et vivante d'un
artiste inconnu, on trouve juste que l'image du prince qui
fut, par sa haute moralité, l'expression la plus pure
de l'autorité impériale, soit restée
seule intacte et debout au-dessus des ruines de la
cité des Césars.
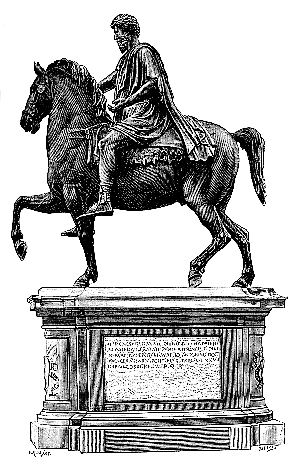
Statue équestre de Marc Aurèle - Place du Capitole |