[Métellus]
XLIII. Après le
traité d'Aulus et la honteuse retraite de notre
armée, Metellus et Silanus (35), consuls
désignés, tirèrent au sort les
provinces. La Numidie échut à Metellus (36), homme actif,
énergique, d'une réputation intacte,
également respecté de tous les partis, bien
qu'il fût opposé à celui du peuple.
Dès son entrée en fonctions, pensant qu'il ne
devait pas attendre le concours de son collègue
(37), il dirigea
exclusivement ses pensées vers la guerre dont il se
trouvait chargé. Comme il n'avait aucune confiance
dans l'ancienne armée, il enrôle des soldats,
tire des secours de tous côtés, rassemble des
armes, des traits, des chevaux, des équipages
militaires, des vivres en abondance, enfin pourvoit à
tout ce qui devait être utile dans une guerre où
l'on pouvait s'attendre à beaucoup de vicissitudes et
de privations. Tout concourut à l'accomplissement de
ses dispositions : le sénat par son autorité,
les alliés, les Latins et les rois, par leur
empressement à envoyer des secours spontanés,
enfin tous les citoyens par l'ardeur de leur zèle.
Tout étant prêt, arrangé selon ses
désirs, Metellus part pour la Numidie, laissant ses
concitoyens pleins d'une confiance fondée sur ses
grands talents et particulièrement sur son
incorruptible probité ; car, jusqu'à ce jour,
c'était la cupidité des magistrats romains qui
avait ébranlé notre puissance en Numidie et
accru celle des ennemis.
XLIV. Dès que
Metellus fut arrivé en Afrique, le proconsul Albinus
lui remit une armée sans vigueur, sans courage,
redoutant les fatigues comme les périls, plus prompte
à parler qu'à se battre, pillant les
alliés, pillée elle-même par l'ennemi,
indocile au commandement, livrée à la
dissolution. Le nouveau général conçoit
plus d'inquiétude en voyant la démoralisation
de ses troupes que de confiance et d'espoir dans leur nombre.
Aussi, quoique le retard des comices eût
abrégé le temps de la campagne, et que Metellus
sût que l'attente des événements
préoccupait tous les citoyens, il résolut
pourtant de ne point commencer la campagne qu'il n'eût
forcé les soldats à plier sous le joug de
l'ancienne discipline.
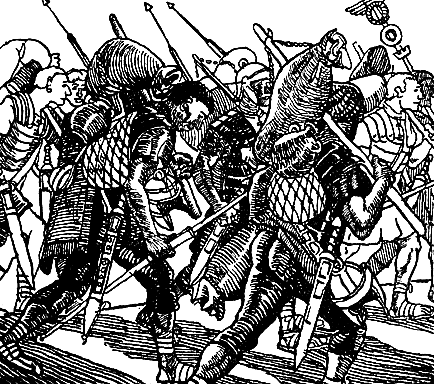 |
Consterné de
l'échec qu'avaient essuyé son frère et
l'armée, Albinus avait pris la résolution de ne
point sortir de la Province romaine ; aussi, durant tout le
temps que dura son commandement, tint-il constamment ses
troupes stationnées dans le même endroit,
jusqu'à ce que l'infection de l'air ou le manque de
fourrages le forçât d'aller camper ailleurs.
Mais la garde du camp ne se faisait point selon les
règles militaires : on ne se fortifiait plus ;
s'écartait qui voulait du drapeau ; les valets
d'armée, pêle-mêle avec les soldats,
erraient jour et nuit, et dans leurs courses
dévastaient les champs, attaquaient les maisons de
campagne, enlevaient à l'envi les esclaves et les
troupeaux, puis les échangeaient avec des marchands
contre des vins étrangers et d'autres denrées
semblables. Ils vendaient aussi le blé des
distributions publiques (38), et achetaient du
pain au jour le jour. Enfin, tout ce que la parole peut
exprimer, et l'imagination concevoir de honteux en fait de
mollesse et de dissolution, était encore au-dessous de
ce qui se voyait dans cette armée.
XLV. Au milieu de ces
difficultés, Metellus, à mon avis, se montra
non moins grand, non moins habile que dans ses
opérations contre l'ennemi : tant il sut garder un
juste milieu entre une excessive rigueur et une
condescendance coupable.
Par un édit, il fit d'abord disparaître ce qui
entretenait la mollesse, prohiba dans le camp la vente du
pain ou de tout autre aliment cuit (39), défendit aux
valets de suivre l'armée, aux simples soldats d'avoir,
dans les campements ou dans les marches, des esclaves ou des
bêtes de somme. Quant aux autres désordres, il y
mit un frein par l'adresse. Chaque jour, prenant des routes
détournées, il levait son camp, qu'il faisait,
comme en présence de l'ennemi, entourer d'une
palissade et d'un fossé, multipliant les postes et les
visitant lui-même avec ses lieutenants. Dans les
marches, il se plaçait tantôt à la
tête, tantôt en arrière, quelquefois au
centre, afin que personne ne quittât son rang, qu'on se
tînt serré autour de ses drapeaux, et que le
soldat portât lui-même ses vivres et ses armes
(40). C'est ainsi
qu'en prévenant les fautes, plutôt qu'en les
punissant, le consul eut bientôt rétabli la
discipline de l'armée.
XLVI. Informé par ses
émissaires des mesures que prenait Metellus, dont
à Rome il avait pu par lui-même apprécier
l'incorruptible vertu, Jugurtha commence à se
défier de sa fortune, et cette fois, enfin, il
s'efforce d'obtenir la paix par une véritable
soumission. Il envoie au consul des ambassadeurs dans
l'appareil de suppliants (41), et qui ne demandent
que la vie sauve pour lui et pour ses enfants ; sur tout le
reste il se remet à la discrétion du peuple
romain. Metellus connaissait déjà, par
expérience, la perfidie des Numides, la
mobilité de leur caractère et leur amour pour
le changement. Il prend donc en particulier chacun des
ambassadeurs, les sonde adroitement, et, les trouvant dans
des dispositions favorables à ses vues, il leur
persuade, à force de promesses, de lui livrer Jugurtha
mort ou vif ; puis, en audience publique, il les charge de
transmettre une réponse conforme aux désirs
deleur roi (42).
Quelques jours après, à la tête d'une
armée bien disposée, remplie d'ardeur, il entre
en Numidie. Nul appareil de guerre ne s'offre à ses
regards ; aucun habitant n'avait quitté sa
chaumière ; les troupeaux et les laboureurs
étaient répandus dans les champs. A chaque
ville ou bourgade, les préfets du roi venaient
au-devant du consul lui offrir du blé, des transports
pour ses vivres, enfin une obéissance entière
à ses ordres. Toutefois Metellus n'en fit pas moins
marcher son armée avec autant de précaution et
dans le même ordre que si l'ennemi eût
été présent. Il envoyait au loin en
reconnaissance, convaincu que ces marques de soumission
n'étaient que simulées, et qu'on ne cherchait
que l'occasion de le surprendre. Lui-même, avec les
cohortes armées à la légère, les
frondeurs et les archers d'élite, il marchait aux
premiers rangs. Son lieutenant, C. Marius (43), à la
tête de la cavalerie, veillait à
l'arrière-garde. Sur chacun des flancs de
l'armée était échelonnée la
cavalerie auxiliaire, aux ordres des tribuns des
légions et des préfets des cohortes, et les
vélites (44), mêlés
à cette troupe, étaient prêts à
repousser sur tous les points les escadrons ennemis. Jugurtha
était si rusé, il avait une telle connaissance
du pays et de l'art militaire, que, de loin ou de
près, en paix ou en guerre ouverte, on ne savait quand
il était le plus à craindre.
XLVII. Non loin de la route
que suivait Metellus, était une ville numide
nommée Vacca, le marché le plus
fréquenté de tout le royaume. Là
s'étaient établis et venaient trafiquer an
grand nombre d'italiens. Le consul, à la fois pour
éprouver les dispositions de l'ennemi, et, si on le
laissait faire, pour s'assurer l'avantage d'une place d'armes
(45), y mit
garnison, et y fit transporter des grains, ainsi que d'autres
munitions de guerre. Il jugeait, avec raison, que l'affluence
des négociants et l'abondance des denrées dans
cette ville seraient d'un grand secours à son
armée pour le renouvellement et la conservation de ses
approvisionnements. Cependant Jugurtha envoie des
ambassadeurs qui redoublent d'instances et de supplications
afin d'obtenir la paix : hors sa vie et celle de ses enfants,
il abandonnait tout à Metellus. Le consul agit avec
ces envoyés comme avec leurs devanciers ; il les
séduit, les engage à trahir leur maître,
et les renvoie chez eux, sans accorder ni refuser au roi la
paix qu'il demandait ; puis, au milieu de ces retards, il
attend l'effet de leurs promesses.
XLVIII. Jugurtha, comparant
la conduite de Metellus avec ses discours, reconnut qu'on le
combattait avec ses propres armes ; car, en lui portant des
paroles de paix, on ne lui faisait pas moins la guerre la
plus terrible. Une place très importante venait de lui
être enlevée ; les ennemis prenaient
connaissance du pays et tentaient la fidélité
de ses peuples. Il cède donc à la
nécessité, et se décide à prendre
les armes. En épiant la direction que prend l'ennemi,
il conçoit l'espoir de vaincre par l'avantage des
lieux. Il rassemble donc le plus qu'il peut de troupes de
toutes armes, prend des sentiers détournés, et
devance l'armée de Metellus.
Dans la partie de la Numidie qu'Adherbal ayait eue en
partage, coule le fleuve Muthul, qui prend sa source au midi
: à vingt mille pas environ, se prolonge une
chaîne de montagnes parallèle à son
cours, déserte, stérile et sans culture : mais
du milieu s'élève une espèce de colline
(46), dont le
penchant, qui s'étend fort au loin, est couvert
d'oliviers, de myrtes, et d'autres arbres qui naissent dans
un terrain aride et sablonneux. Le manque d'eau rend la
plaine intermédiaire entièrement
stérile, sauf la partie voisine du fleuve, qui est
garnie d'arbres, et que fréquentent les laboureurs et
les troupeaux.
XLIX. Ce fut le long de
cette colline, qui, comme nous l'avons dit, s'avance dans une
direction oblique au prolongement de la montagne, que
Jugurtha s'arrêta, en serrant les lignes de son
armée. Il mit Bomilcar à la tête des
éléphants et d'une partie de son infanterie,
puis lui donna ses instructions sur ce qu'il devait faire :
lui-même se porta plus près de la montagne avec
toute sa cavalerie et l'élite de ses fantassins.
Parcourant ensuite tous les escadrons et toutes les
compagnies (47),
il leur demande, il les conjure, au nom de leur valeur et de
leur victoire récente, de défendre sa personne
et ses Etats contre la cupidité des Romains. Ils vont
avoir à combattre contre ceux qu'ils ont
déjà vaincus et fait passer sous le joug, en
changeant de chef, ces Romains n'ont pas changé
d'esprit. Pour lui, tout ce qui peut dépendre de la
prévoyance d'un général, il l'a su
ménager aux siens : la supériorité du
poste et la connaissance des lieux contre des ennemis qui les
ignorent, sans compter que les Numides ne leur sont
inférieurs ni par le nombre ni par
l'expérience. Qu'ils se tiennent donc prêts et
attentifs au premier signal, pour fondre sur les Romains : ce
jour doit couronner tous leurs travaux et toutes leurs
victoires, ou devenir pour eux le commencement des plus
affreux malheurs. Jugurtha s'adresse ensuite à chaque
homme ; reconnaît-il un soldat qu'il avait
récompensé pour quelque beau fait d'armes, soit
par de l'argent, soit par des grades, il lui rappelle cette
faveur, et le propose comme exemple aux autres ; enfin, selon
le caractère de chacun, il promet, menace, supplie,
emploie tous les moyens pour exciter le courage.
Cependant Metellus, ignorant les mouvements de l'ennemi,
descend la montagne à la tête de son
armée ; il regarde, et reste d'abord en doute sur ce
qu'il aperçoit d'extraordinaire ; car les Numides et
leurs chevaux étaient embusqués dans les
broussailles ; et, quoique les arbres ne fussent pas assez
élevés pour les couvrir entièrement, il
était difficile de les distinguer, tant à cause
de la nature du terrain que de la précaution qu'ils
prenaient de se cacher, ainsi que leurs enseignes.
Bientôt, ayant découvert l'embuscade, le consul
suspendit un instant sa marche et changea son ordre de
bataille. Sur son flanc droit, qui était le plus
près de l'ennemi, il disposa sa troupe en trois
lignes, distribua les frondeurs et les archers entre les
corps d'infanterie légionnaire, et rangea sur les
ailes toute la cavalerie. En peu de mots, car le temps
pressait, il exhorta ses soldats ; puis il les conduisit dans
la plaine, en conservant l'ordre d'après lequel la
tête de l'armée en était devenue le
flanc.
L. Quand il vit que les
Numides ne faisaient aucun mouvement et ne descendaient point
de la colline, craignant que, par la chaleur de la saison et
par le manque d'eau, la soif ne consumât son
armée, Metellus détache son lieutenant Rutilius
(48) avec les
cohortes armées à la légère et
une partie de la cavalerie, pour aller vers le fleuve
s'assurer d'avance d'un camp ; car il s'imaginait que les
ennemis, par de fréquentes attaques dirigées
sur ses flancs, retarderaient sa marche, et que, peu
confiants dans la supériorité de leurs armes,
ils tenteraient d'accabler les Romains par la fatigue et la
soif. Metellus, ainsi que le demandaient sa position et la
nature du terrain, s'avance au petit pas, comme il avait fait
en descendant de la montagne ; il place Marius
derrière la première ligne ; pour lui, il se
met à la tête de la cavalerie de l'aile gauche,
qui, dans la marche, était devenue la tête de la
colonne (49).
Dès que Jugurtha voit l'arrière-garde de
Metellus dépasser le front des Numides, il envoie
environ deux mille fantassins occuper la montagne d'où
les Romains venaient de descendre, afin que, s'ils
étaient battus, ils ne pussent s'y retirer ni s'y
retrancher. Alors il donne tout à coup le signal et
fond sur les ennemis. Une partie des Numides taille en
pièces les dernières lignes ; d'autres
attaquent à la fois l'aile droite et l'aile gauche ;
pleins d'acharnement, ils pressent, harcèlent, mettent
partout le désordre dans les rangs. Ceux mêmes
des Romains qui, montrant le plus de résolution,
avaient été au-devant des Numides,
déconcertés par leurs mouvements incertains,
sont blessés de loin, et ne peuvent ni joindre ni
frapper leurs adversaires. Instruits d'avance par Jugurtha,
les cavaliers numides, dès qu'un escadron romain se
détache pour les charger, se retirent, non pas en
masse, ni du même côté, mais en rompant
leurs rangs. Si les Romains persistent à les
poursuivre, les Numides, profitant de l'avantage du nombre
(50), viennent
prendre en queue ou en flanc leurs escadrons épars.
D'autres fois, la colline les favorise encore mieux que la
plaine ; car les chevaux numides, habitués à
cette manoeuvre, s'échappent facilement à
travers les broussailles, tandis que les
inégalités d'un terrain qu'ils ne connaissent
point arrêtent les nôtres à chaque
pas.
LI. Ce combat, marqué par tant de
vicissitudes, offrit dans son ensemble un spectacle de
confusion, d'horreur et de désolation.
Séparés de leurs compagnons, les uns
fuient, les autres poursuivent ; les drapeaux et les
rangs sont abandonnés ; là où le
péril l'a surpris, chacun se défend et
cherche à repousser l'attaque : dards,
épées, hommes, chevaux, ennemis, citoyens,
tout est confondu ; la prudence ni la voix des chefs ne
décident rien, le hasard conduit tout ; et
déjà le jour était très
avancé, que l'issue du combat demeurait
incertaine. |
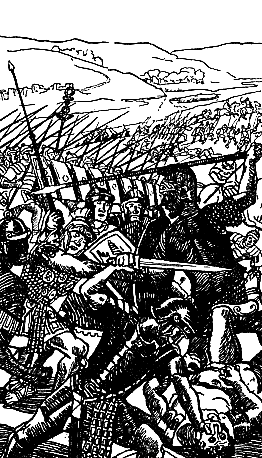 |
LII. Ainsi luttaient
ensemble ces deux grands capitaines, avec une égale
habileté, mais avec des moyens différents.
Metellus avait pour lui la valeur de ses soldats, contre lui
le désavantage du terrain : tout secondait Jugurtha,
tout, excepté son armée. Enfin, les Romains,
convaincus qu'il n'ont aucun moyen de retraite, ni la
possibilité de forcer l'ennemi à combattre,
pressés d'ailleurs par la nuit tombante (53), exécutent
l'ordre de leur général, et se font jour en
franchissant la colline. Chassés de ce poste, les
Numides se dispersent et fuient. Il n'en périt qu'un
petit nombre : leur vitesse, jointe au peu de connaissance
que nous avions du pays (54), les sauva presque
tous.
Cependant Bomilcar, chargé par Jugurtha, comme nous
l'avons dit, de la conduite des éléphants et
d'une partie de l'infanterie, avait, dès qu'il
s'était vu devancer par Rutilius, conduit au pas ses
soldats dans la plaine ; et, tandis que le lieutenant de
Metellus pressait sa marche pour arriver au fleuve vers
lequel il avait été détaché en
avant, Bomilcar prit son temps pour ranger son armée
dans l'ordre convenable, sans cesser d'être attentif
aux mouvements dès deux corps d'armée ennemis.
Dès qu'il sut que Rutilius, libre de toute
inquiétude, venait d'asseoir son camp, et qu'en
même temps il entendit redoubler les clameurs du
côté où combattait Jugurtha, Bomilcar
craignit que le lieutenant du consul, attiré par le
bruit, ne vint secourir les Romains dans leur position
critique ; alors, pour lui couper le chemin, il
déploya sur un front plus large ses troupes, que, dans
son peu de confiance en leur valeur, il avait tenues fort
serrées (55). Dans cet ordre, il
marche droit au camp de Rutilius.
LIII. Les Romains
aperçoivent tout à coup un grand nuage de
poussière, car les arbustes dont ce lieu était
couvert empêchaient la vue de s'étendre. Ils
pensèrent d'abord que le vent soulevait le sable de
cette plaine aride ; mais, comme le nuage s'élevait
toujours également et se rapprochait graduellement
suivant les mouvements de l'armée, leurs doutes
cessent : ils prennent leurs armes à la hâte,
et, dociles aux ordres de leurs chefs, se rangent devant le
camp. Dès que l'on est en présence, on
s'attaque de part et d'autre avec de grands cris. Les Numides
tinrent ferme, tant qu'ils crurent pouvoir compter sur lu
secours de leurs éléphants ; mais, dès
qu'ils virent ces animaux embarrassés dans les
branches des arbres, séparés les uns des autres
et enveloppés par l'ennemi, ils prirent la fuite, la
plupart en jetant leurs armes, et s'échappèrent
sains et saufs, à la faveur de la colline et de la
nuit qui commençait. Quatre éléphants
furent pris ; tous les autres, au nombre de quarante, furent
tués.
Malgré la fatigue de la marche, du campement, du
combat, et la joie de la victoire (56), les Romains, comme
Metellus se faisait attendre plus longtemps qu'on n'avait
pensé, s'avancent au-devant de lui, en bon ordre, avec
précaution : les ruses des Numides ne permettaient ni
relâche ni négligence. Lorsque, dans
l'obscurité de la nuit, les deux armées se
rapprochèrent, au bruit de leur marche, elles se
crurent réciproquement en présence de l'ennemi,
et devinrent l'une pour l'autre un sujet d'alarme et de
tumulte. Cette méprise aurait amené la plus
déplorable catastrophe, si, de part et d'autre, des
cavaliers détachés en éclaireurs
n'eussent reconnu la vérité. Aussitôt la
crainte fait place à l'allégresse ; les
soldats, dans leur ravissement, s'abordent l'un l'autre ; on
raconte, on écoute ce qui s'est passé ; chacun
porte aux nues ses actes de bravoure. Car ainsi vont les
choses humaines : la victoire permet même au
lâche de se vanter ; les revers rabaissent jusqu'aux
plus braves.
LIV. Metellus demeure
campé quatre jours dans ce lieu ; il donne tous ses
soins aux blessés, décerne les
récompenses militaires méritées dans les
deux combats, adresse publiquement à toutes ses
troupes des félicitations et des actions de
grâces, puis les exhorte à montrer le même
courage pour des travaux désormais plus faciles :
après avoir combattu pour la victoire, leurs efforts,
disait-il, n'auraient plus pour but que le butin. Cependant
il envoie des transfuges et d'autres émissaires
adroits, afin de découvrir chez quel peuple
s'était réfugié Jugurtha (57), ce qu'il projetait,
s'il n'avait qu'une poignée d'hommes ou bien une
armée, et quelle était sa contenance depuis sa
défaite.
Ce prince s'était retiré dans des lieux
couverts de bois et fortifiés par la nature.
Là, il rassemblait une armée plus nombreuse
à la vérité que la première, mais
composée d'hommes lâches, faibles, plus propres
à l'agriculture et à la garde des troupeaux
qu'à la guerre. Il en était réduit
à cette extrémité, parce que, chez les
Numides, personne, excepté les cavaliers de sa garde,
ne suit le roi après une déroute. Chacun se
retire où il juge à propos ; et cette
désertion n'est point regardée comme un
déshonneur : les moeurs de la nation
l'autorisent.
Convaincu que Jugurtha n'a
point laissé fléchir son courage indomptable,
et que pour les Romains va recommencer une guerre où
rien ne se fera que selon le bon plaisir de l'ennemi,
où ils ne combattront jamais qu'avec des chanees
inégales, où enfin la victoire leur sera plus
désastreuse que la défaite aux Numides,
Metellus se décide à éviter les
engagements et les batailles rangées, pour adopter un
nouveau plan d'opérations. Il se dirige dans les
cantons les plus riches de la Numidie, ravage les champs,
prend les châteaux et les places peu fortifiées
ou sans garnison, les livre aux flammes, passe au fil de
l'épée tout ce qui est en état de porter
les armes, et abandonne au soldat le reste de la population.
La terreur de ces exécutions fait qu'on livre aux
Romains une foule d'otages, qu'on leur apporte des
blés en abondance, et tout ce dont ils peuvent avoir
besoin. Partout où ils le jugent nécessaire,
ils laissent des garnisons.
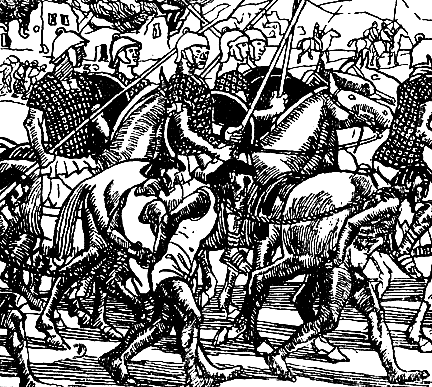 |
Cette manoeuvre inspire
au roi de bien plus vives alarmes que l'échec
récemment éprouvé par son armée.
Tout son espoir était d'éviter l'ennemi, et il
se voit forcé d'aller le chercher : faute d'avoir pu
se défendre dans ses positions, il est réduit
à combattre sur le terrain choisi par son adversaire.
Cependant il prit le parti qui, dans sa position critique,
lui parut encore le meilleur. Il laisse dans les
cantonnements le gros de son armée, et lui-même,
avec l'élite de sa cavalerie, s'attache à
suivre Metellus. La nuit, dérobant sa marche par des
routes détournées (58), il attaque à
l'improviste ceux des Romains qui errent dans la campagne :
la plupart étaient sans armes et furent tués ;
le reste fut pris ; pas un seul n'échappa sans
blessure, et, suivant l'ordre qu'ils en ayaient reçu,
les Numides, ayant qu'aucun secours arrivât du camp, se
retirèrent sur les hauteurs voisines.
LV. La joie la plus vive se
répandit dans Rome, à la nouvelle des exploits
de Metellus, quand on sut que ce général et ses
soldats s'étaient montrés dignes de leurs
ancêtres ; que, dans un poste désavantageux, il
avait su vaincre par son courage ; qu'il était
maître du territoire ennemi, et que ce Jugurtha, si
orgueilleux naguère, grâce à la
lâcheté d'Aulus, était maintenant
réduit à trouver sa sûreté dans la
fuite et dans ses déserts. Le sénat, pour ces
heureux succès, décrète de publiques
actions de grâces aux dieux immortels. Rome, auparavant
tremblante et inquiète de l'issue de la guerre,
respire l'allégresse ; la gloire de Metellus est
à son comble.
Mais il n'en montra que plus d'ardeur à s'assurer de
la victoire, à l'accélérer par tous les
moyens, sans cependant jamais donner prise à l'ennemi.
Il n'oubliait pas qu'à la suite de la gloire marche
toujours l'envie : aussi, plus sa renommée avait
d'éclat, plus il évitait de la compromettre.
Depuis que Jugurtha avait surpris l'armée romaine,
elle ne se débandait plus pour piller. Fallait-il
aller au fourrage ou à la provision, les cohortes
(59) et toute la
cavalerie servaient d'escorte. Il divisa son armée en
deux corps, commandés, l'un par lui-même,
l'autre par Marius, et les occupa moins à piller
qu'à incendier les campagnes. Les deux corps avaient
chacun leur camp, assez près l'un de l'autre. S'il
était besoin de se prêter main-forte, ils se
réunissaient ; mais, ce cas excepté, ils
agissaient séparément pour répandre plus
loin la terreur et la fuite.
Cependant Jugurtha les suivait le long des collines,
épiant le moment et le lieu propres à l'attaque
; là où il apprenait que les Romains devaient
porter leurs pas, il gâtait les fourrages et
empoisonnait les sources, si rares dans ce pays : il se
montrait tantôt à Metellus, tantôt
à Marius, tombait sur les derniers rangs, et regagnait
aussitôt les hauteurs ; puis il revenait menacer l'un,
harceler l'autre ; enfin, ne livrant jamais de bataille, ne
laissant jamais de repos, il réussissait à
empêcher l'ennemi d'accomplir ses desseins.
LVI. Le général romain, fatigué des ruses continuelles d'un ennemi qui ne lui permet pas de combattre, prend le parti d'assiéger Zama, ville considérable, et le boulevard de la partie du royaume où elle était située. Il prévoyait que, selon toute apparence, Jugurtha viendrait au secours de ses sujets assiégés, et qu'une bataille se livrerait. Le Numide, que des transfuges ont instruit de ce qui se prépare, devance Metellus par des marches forcées : il vient exhorter les habitants à défendre leurs murs, et leur donne pour auxiliaires les transfuges. C'étaient, de toutes les troupes royales, celles dont il était le plus sûr, vu leur impuissance de le trahir (60). Il promet en outre aux habitants d'arriver lui-même, quand il en sera temps, à la tête d'une armée. Ces dispositions faites, il se retire dans des lieux très couverts. Là, il apprend bientôt que Marius, avec quelques cohortes, a reçu l'ordre de se détourner de la route pour aller chercher du blé à Sicca : c'était la ville qui, la première, avait abandonné Jugurtha après sa défaite : il accourt de nuit sous ses murs, avec quelques cavaliers d'élite, et au moment où les Romains en sortaient, il les attaque aux portes. En même temps, élevant la voix, il exhorte les habitants à envelopper nos cohortes par derrière ; il ajoute que la fortune leur offre l'occasion d'un brillant exploit ; que, s'ils en profitent, désormais, lui sur son trône, eux dans l'indépendance, pourront vivre exempis de toute crainte. Si Marius ne se fût porté en avant, après avoir sans retard évacué la ville, tous ses habitants, ou au moins le plus grand nombre, auraient certainement abandonné son parti : tant les Numides sont mobiles dans leurs affections ! Les soldats de Jugurtha sont un instant soutenus par la présence de leur roi ; mais, dès qu'ils se sentent pressés plus vivement par les ennemis, ils prennent la fuite après une perte assez légère. |
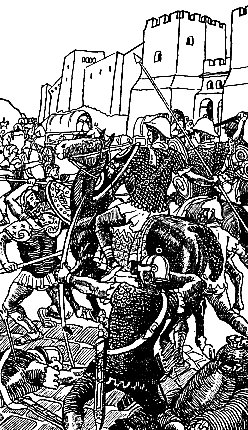 |
LVII. Marius arrive à Zama. Cette ville, située dans une plaine, était plus fortifiée par l'art que par la nature : abondamment pourvue d'armes et de soldats, elle ne manquait d'aucun des approvisionnements nécessaires. Metellus, après avoir fait toutes les dispositions convenables aux circonstancus et aux lieux, investit entièrement la place avec son armée ; il marque à chacun de ses lieutenants le poste qu'il doit attaquer, puis donne le signal : en même temps un grand cri s'élève sur toute la ligne. Les Numides n'en sont pas effrayés : fermes et menaçants, ils attendent sans trouble l'assaut. L'attaque commence : les Romains, suivant que chacun a plus ou moins de courage, ou lancent de loin des balles de plomb et des pierres, ou s'approchent (61) pour saper la muraille et pour l'escalader, et brûlent de combattre corps à corps. De leur côté, les assiégés roulent des pierres sur les plus avancés, puis font pleuvoir des pieux, des dards enflammés et des torches enduites de poix et de soufre (62). Quant à ceux qui sont restés à l'écart, leur lâcheté ne les soustrait point au danger ; la plupart sont blessés par les traits partis des machines ou de la main des Numides. Ainsi le péril, mais non l'honneur, est égal pour le brave comme pour le lâche.
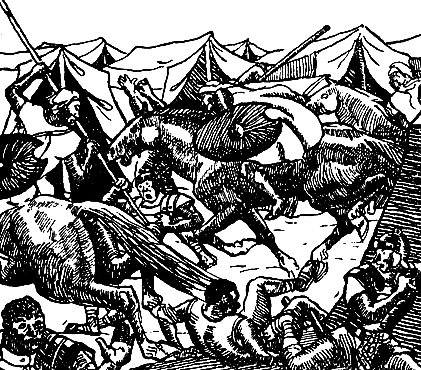 |
LVIII. Tandis que l'on
combat ainsi sous les murs de Zama, Jugurtha, à la
tête d'une troupe nombreuse, fond inopinément
sur le camp des ennemis (63) : ceux qui en
avaient la garde la faisaient négligemment, et ne
s'attendaient à rien moins qu'à une attaque. Il
force une des portes : nos soldats, frappés d'une
terreur soudaine, pourvoient à leur
sûreté, chacun selon son caractère ; les
uns fuient, les autres prennent leurs armes ; la plupart sont
tués ou blessés. De toute cette multitude,
quarante soldats seulement, fidèles à l'honneur
du nom romain, se forment en peloton, et s'emparent d'une
petite éminence, d'où les efforts les plus
soutenus ne peuvent les chasser. Les traits qu'on leur lance
de loin, cette poignée d'hommes les renvoie, sans que,
pour ainsi dire, un seul porte à faux sur la masse de
leurs assaillants. Si les Numides se rapprochent, alors cette
vaillante élite, déployant une vigueur
irrésistible, les taille en pièces, les
disperse, les met en fuite.
Metellus en était au plus fort de ses attaques,
lorsqu'il entendit derrière lui les cris des ennemis ;
il tourne bride, et voit les fuyards se diriger de son
côté, ce qui lui indique que ce sont les
Romains. Il détache aussitôt Marius vers le camp
avec toute la cavalerie et les cohortes des alliés ;
puis, les larmes aux yeux, il les conjure, au nom de leur
amitié et de la république, de ne pas souffrir
qu'un pareil affront soit fait à une armée
victorieuse, ni que l'ennemi se retire impunément.
Marius exécute promptement ces ordres. Jugurtha,
embarrassé dans les retranchements de notre camp,
voyant une partie de ses cavaliers s'élancer
par-dessus les palissades, les autres se presser dans des
passages étroits où ils se nuisent par leur
précipitation, se retire enfin dans des positions
fortes, avec une perte considérable. Metellus, sans
être venu à bout de son entreprise, est
forcé, par la nuit, de rentrer dans son camp avec son
armée.
LIX. Le lendemain, avant de
sortir pour attaquer la place, il ordonne à toute sa
cavalerie de former ses escadrons devant la partie du camp
par où Jugurtha était survenu la veille. La
garde des portes, et celle des postes les plus voisins de
l'ennemi, sont réparties entre les tribuns. Metellus
marche ensuite sur Zama, donne l'assaut ; et, comme le jour
précédent, Jugurtha sort de son embuscade, et
fond tout à coup sur les nôtres ; les plus
avancés laissent un moment la crainte et la confusion
pénétrer dans leurs rangs, mais leurs
compagnons d'armes reviennent les soutenir. Les Numides
n'auraient pu résister longtemps, si leurs fantassins,
mêlés aux cavaliers, n'eussent, dans le choc,
porté des coups terribles. Appuyée de cette
infanterie, la cavalerie numide, au lieu de charger et de se
replier ensuite, selon sa manoeuvre habituelle, poussait
à toute bride à travers nos rangs, les rompait,
les enfonçait, et livrait à ces agiles
fantassins des ennemis à moitié vaincus.
LX. Dans le même temps, on combattait avec
ardeur sous les murs de Zama. A tous les postes où
commande un lieutenant ou quelque tribun, l'effort est le
plus opiniâtre : personne ne met son espoir dans
autrui ; chacun ne compte que sur soi. Les
assiégés, avec la même ardeur,
combattent et font face à l'ennemi sur tous les
points : de part et d'autre on est plus occupé
à porter des coups qu'à s'en garantir. Les
clameurs mêlées d'exhortations, de cris de
joie, de gémissements, et le fracas des armes,
s'élèvent jusqu'au ciel ; les traits volent
de tous côtés. |
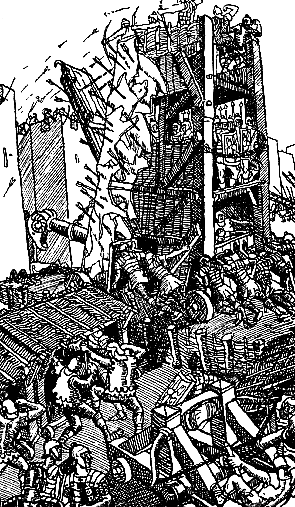 |
LXI. Metellus
reconnut bientôt l'inutilité de ses tentatives :
il ne pouvait prendre la ville, et Jugurtha n'engageait de
combat que par surprise ou avec l'avantage du poste :
d'ailleurs, la campagne touchait à sa fin. Le consul
lève donc le siège de Zama, met garnison dans
les villes qui s'étaient soumises volontairement et
que protégeaient suffisamment leur situation ou leurs
remparts, puis il conduit le reste de son armée dans
la Province romaine qui confine à la Numidie. A
l'exemple des autres généraux, il ne donna
point ce temps au repos et aux plaisirs. Comme les armes
avaient peu avancé la guerre, il résolut d'y
substituer la trahison, et de se servir des amis de Jugurtha
pour lui tendre des embûches. J'ai parlé de
Bomilcar, qui suivit ce prince à Rome, et qui,
après avoir donné des cautions, se
déroba secrètement à la condamnation
qu'il avait encourue pour le meurtre de Massiva (64). L'extrême
faveur dont il jouissait auprès de Jugurtha lui
donnait toute facilité pour le trahir. Metellus
cherche à séduire ce Numide par de grandes
promesses, et l'attire d'abord à une entrevue
mystérieuse. Là, il lui donne sa parole
«qu'en livrant Jugurtha mort ou vif il obtiendra du
sénat l'impunité et la restitution de tous ses
biens». Bomilcar se laisse aisément persuader.
Déloyal par caractère, il avait encore la
crainte que, si la paix se faisait avec les Romains, son
supplice ne fût une des conditions du
traité.
LXII. A la première
occasion favorable, voyant Jugurtha livré à
l'inquiétude, au sentiment de ses malheurs, il
l'aborde, lui conseille, et même le conjure, les larmes
aux yeux, de pourvoir enfin à sa sûreté,
à celle de ses enfants et de la nation numide qui a si
bien mérité de lui : dans tous les combats, ils
ont été vaincus ; leur territoire est
dévasté ; un grand nombre d'entre eux ont
péri ou sont prisonniers : les ressources du royaume
sont épuisées : assez et trop peut-être,
Jugurtha a mis à l'épreuve la valeur de ses
soldats et sa fortune ; il doit craindre que, pendant qu'il
temporise, les Numides ne pourvoient eux-mêmes à
leur salut.
Par ces discours et d'autres propos semblables, Bomilcar
décide enfin le monarque à la soumission : des
ambassadeurs sont envoyés au général
romain (65) pour
lui déclarer que Jugurtha est prêt à
souscrire à tout ce qui lui serait ordonné, et
à livrer sans nulle réserve sa personne et ses
Etats à la foi de Metellus. Le consul fait
aussitôt venir des divers cantonnements tous les
sénateurs (66) qui s'y trouvaient,
et s'en forme un conseil, auquel il adjoint d'autres
officiers qu'il estime aptes à y prendre place
(67) ; puis, en
vertu d'un décret de ce conseil, rendu selon les
formes anciennes, il enjoint à Jugurtha,
représenté par ses ambassadeurs, de donner deux
cent mille livres posant d'argent, tous ses
éléphants, plus une certaine quantité
d'armes et de chevaux. Ces conditions accomplies sans
délai, Metellus ordonne que tous les transfuges lui
soient rendus chargés de chaînes. La plupart
furent effectivement livrés (68) : quelques-uns,
dès les préliminaires du traité,
s'étaient sauvés en Mauritanie, auprès
du roi Bocchus.
Lorsque Jugurtha se voit ainsi dépouillé de
ses, armes, de ses plus braves soldats et de ses
trésors, et qu'il est appelé lui même
à Tisidium pour y recevoir de nouveaux ordres (69), il chancelle encore
une fois dans ses résolutions : sa mauvaise conscience
commence à craindre les châtiments dus à
ses crimes. Enfin, après bien des journées
passées dans l'hésitation, où
tantôt, abattu par ses malheurs, tout lui semble
préférable à la guerre, tantôt il
songe en lui-même combien la chute est lourde du
trône à l'esclavage, et que c'est en pure perte
qu'il aura sacrifié tous ses moyens de défense,
il se décide à recommencer la guerre plus que
jamais. A Rome, le sénat avait, dans la
répartition des provinces, prorogé la Numidie
à Metellus.
LXIII. Vers ce même
temps, il arriva que, Marius offrant un sacrifice aux dieux,
dans Utique, l'aruspice lui prédit (70) de grandes et
mémorables destinées, assurant que, fort du
secours des dieux, il accomplirait les desseins qu'il avait
dans l'âme ; qu'il pouvait, sans se lasser, mettre sa
fortune à l'épreuve ; que tout lui serait
prospère (71). Dès
longtemps, en effet, Marins nourrissait le plus violent
désir d'arriver au consulat. Pour y parvenir, il
réunissait tous les titres, excepté
l'illustration des ancêtres : talents, probité,
connaissance profonde de l'art militaire, courage indomptable
dans les combats, simplicité dans la paix (72) ; enfin, un
mépris des richesses et des voluptés
égal à sa passion pour la gloire. Né
à Arpinum, où il passa toute son enfance,
dès qu'il fut d'âge à supporter les
fatigues de la guerre, il s'adonna entièrement aux
exercices des camps, et point du tout à
l'éloquence des Grecs ni aux formes de
l'urbanité romaine. Au milieu de ces louables
occupations, son âme s'était fortifiée de
bonne heure loin de la corruption. Lorsqu'en premier lieu il
sollicita, auprès du peuple, le tribunat militaire,
bien que presque aucun citoyen ne le connût
personnellement, sa réputation lui valut les suffrages
spontanés de toutes les tribus. Dès ce moment,
il s'éleva successivement de magistrature en
magistrature, et, dans toutes ses fonctions, il se montra
toujours supérieur à son emploi. Cependant,
à cette époque, cet homme si distingué,
que son ambition perdit par la suite (73), n'osait encore
briguer le consulat ; car alors, si le peuple disposait des
autres magistratures, la noblesse se transmettait de main en
main cette dignité suprême, dont elle
était exclusivement en possession. Tout homme nouveau,
quels que fussent sa renommée et l'éclat de ses
actions, paraissait indigne de cet honneur (74) : il était
comme souillé par la tache de sa naissance.
LXIV. Toutefois, les paroles
de l'aruspice s'accordant avec les ambitieux désirs de
Marius, celui-ci demande à Metellus son congé
pour aller se mettre au nombre des candidats. Bien que ce
général réunît à un
degré supérieur mérite, renommée,
et mille autres qualités désirables dans un
homme vertueux, il n'était pas exempt de cette hauteur
dédaigneuse qui est le défaut
général de la noblesse. Frappé d'abord
de cette démarche sans exemple, il en témoigne
à son questeur toute sa surprise, et lui conseille, en
ami, de ne pas s'engager dans un projet si chimérique
; de ne pas élever ses pensées au-dessus de sa
condition ; il lui objecte que les mêmes
prétentions ne conviennent pas à tous ; qu'il
devait se trouver satisfait de sa position, et surtout se
bien garder de solliciter du peuple romain ce qui ne pouvait
que lui attirer un refus mérité. Voyant que ces
représentations et d'autres discours semblables
n'avaient point ébranlé Marius, Metellus
ajouta, «que, dès que les affaires publiques lui
en laisseraient le loisir, il lui accorderait sa
demande». Marius ne cessant de réitérer
les mêmes sollicitations, on prétend que le
proconsul lui dit : «Qui vous presse de partir ? il
sera assez temps pour vous de demander le consulat quand mon
fils se mettra sur les rangs». Or ce jeune homme, qui
servait alors sous les yeux de son père, était
à peine dans sa vingtième année (75).
Cette réponse enflamme encore plus Marius pour la
dignité qu'il convoite, en l'irritant
profondément contre son général.
Dès ce moment, il n'a pour guides de ses actions que
l'ambition et la colère, de tous les conseillers les
plus funestes : démarches, discours, tous les moyens
lui semblent bons (76) pour se concilier la
faveur populaire : aux soldats qu'il commande dans leurs
quartiers d'hiver, il accorde le relâchement de la
discipline ; devant les marchands romains, qui se trouvaient
en grand nombre à Utique, il ne cesse de parler de la
guerre d'un ton à la fois frondeur et fanfaron : Qu'on
lui donne seulement la moitié de l'armée, et en
peu de jours il amènera Jugurtha chargé de
chaînes ; le général traînait
exprès la guerre en longueur, parce que, bouffi de
vanité, orgueilleux comme un roi, il se complaisait
dans le commandement. Ces discours faisaient d'autant plus
d'impression sur ceux auxquels ils s'adressaient, que la
durée de la guerre compromettait leur fortune : les
gens pressés ne trouvent jamais qu'on aille assez vite
(77).
LXV. Il y avait alors dans
notre armée un Numide nommé Gauda, fils de
Manastabal et petit-fils de Masinissa, à qui Micipsa,
par testament, avait substitué ses Etats (78). Les
infirmités dont il était accablé avaient
un peu affaibli son esprit.
Metellus, à qui il avait demandé d'avoir, selon
la prérogative des rois, son siège
auprès de celui du consul, et pour sa garde un
escadron de cavalerie romaine, lui avait refusé l'un
et l'autre : le siège, parce que cet honneur
n'était déféré qu'à ceux
que le peuple romain avait reconnus rois ; la garde, parce
qu'il eût été honteux pour des cavaliers
romains (79) de
servir de satellites à un Numide.
Marius aborde le prince mécontent, et l'engage
à se servir de lui pour tirer vengeance des affronts
de leur général. Ses paroles flatteuses
exaltent cette tête faible : «Il est roi, homme
de mérite, petit-fils de Masinissa : Jugurtha une fois
pris ou tué, le royaume de Numidie lui reviendra
sur-le-champ ; ce qui ne tarderait pas à s'accomplir,
si, consul, Marius était chargé de cette
guerre». En conséquence, et Gauda, et les
chevaliers romains (80) tant militaires que
négociants, poussés, les uns par l'ambitieux
questeur, le plus grand nombre par l'espoir de la paix,
écrivent à leurs amis, à Rome, dans un
sens très défavorable à Metellus
(81), et
demandent Marius pour général. Ainsi, pour lui
faire obtenir le consulat, se forma la plus honorable
coalition de suffrages. D'ailleurs, à cette
époque, le peuple, voyant la noblesse humiliée
par la loi Mamilia (82), cherchait à
élever des hommes nouveaux. Tout conspirait ainsi en
faveur de Marius.
LXVI. Cependant Jugurtha, ne
songeant plus à se rendre, recommence la guerre, et
fait tous ses préparatifs avec autant de soin que de
promptitude : il rassemble son armée, puis, pour
ramener les villes qui l'avafient abandonné, emploie
la terreur ou les promesses ; il fortifie les places, fait
fabriquer ou achète des armes, des traits, et
réunit tous les moyens de défense que l'espoir
de la paix lui avait fait sacrifier ; il attire à lui
les esclaves romains, et veut séduire par son or
jusqu'aux soldats de nos garnisons ; partout il excite
à la révolte par la corruption ; tout est
remué par ses intrigues. Ses manoeuvres
réussissent auprès des habitants de Vacca,
où Metellus, lors des premières ouvertures
pacifiques de Jugurtha, avait fait mettre garnison.
Importunés par les supplications de leur roi, pour
lequel ils n'avaient jamais ea d'éloignement, les
principaux habitants forment entre eux un complot en sa
faveur ; car le peuple, qui, par habitude, et surtout chez
les Numides, est inconstant, séditieux, ami des
révolutions, ne soupirait qu'après un
changement, et détestait l'ordre et le repos (83). Toutes les
dispositions prises, les conjurés fixent
l'exécution du complot au troisième jour :
c'était une fête solennisée dans toute
l'Afrique, et qui semblait inviter à la joie et au
plaisir, mais nullement à la crainte. Au temps
marqué, les centurions, les tribuns militaires, puis
même le commandant de la place, T. Turpilius Silanus,
sont chacun invités chez quelqu'un des principaux
habitants, et tous, à l'exception de Turpilius,
massacrés au milieu du festin.
 |
Les conjurés
tombent ensuite sur nos soldats, qui, profitant de la
fête et de l'absence de leurs officiers, couraient la
ville sans armes. Les gens du peuple prennent part au
massacre ; les uns initiés au complot par la noblesse,
les autres attirés par le goût de pareilles
exécutions : dans leur ignorance de ce qui s'est fait,
de ce qui se prépare, le désordre, un
changement nouveau, est tout ce qui les flatte.
LXVII. Dans cette alarme
imprévue, les soldats romains,
déconcertés, ne sachant quel parti prendre,
courent précipitamment vers la citadelle où
étaient leurs enseignes et leurs boucliers ; mais un
détachement ennemi placé devant les portes, qui
étaient fermées, leur coupe ce moyen de
retraite, tandis que les femmes et les enfants lancent sur
eux à l'envi, du haut des toits, des pierres et tout
ce qui leur tombe sous la main. Ils ne peuvent éviter
ce double péril, et la force est impuissante contre le
sexe et l'âge le plus faibles. Braves ou lâches,
aguerris ou timides, tous succombent sans défense.
Dans cet horrible massacre, au milieu de l'acharnement des
Numides, au sein d'une ville fermée de toutes parts,
Turpilius seul, de tous les Italiens, échappa sans
blessure. Dut-il son salut à la pitié de son
hôte, à quelque convention tacite ou bien au
hasard ? Je l'ignore ; mais l'homme qui, dans un pareil
désastre, préféra une vie honteuse
à une renommée sans tache paraît criminel
et méprisable.
LXVIII. Quand Metellus
apprit ce qui s'était passé à Vacca,
dans sa douleur, il se déroba quelque temps aux
regards ; mais bientôt, la colère et le
ressentiment se mêlant à ses regrets, il fait
toutes ses dispositions pour en tirer une prompte vengeance.
Avec la légion de son quartier d'hiver et le plus
qu'il peut rassembler de cavaliers numides, il part sans ses
bagages, au coucher du soleil. Le lendemain, vers la
troisième heure (84), il arrive dans une
espèce de plaine environnée de tous
côtés par de petites éminences.
Là, voyant ses soldats harassés par la longueur
du chemin, et disposés à refuser tout service,
il leur apprend qu'ils ne sont plus qu'à mille pas de
Vacca, et qu'il est de leur honneur de supporter encore un
reste de fatigue pour aller venger leurs braves et malheureux
concitoyens ; puis il fait briller à leurs yeux
l'espoir d'un riche butin. Ce discours relève leur
courage : Metellus fait marcher sa cavalerie en
première ligne sur un plan étendu, et serrer le
plus possible les rangs à l'infanterie, avec ordre de
cacher les drapeaux.
LXIX. Les habitants de Vacca, à la première vue d'une armée qui marchait vers leur ville, crurent d'abord, ainsi qu'il était vrai, que c'étaient les Romains, et ils fermèrent leurs portes. Mais, comme cette armée ne dévastait point la campagne, et que ceux qui s'avançaient les premiers étaient des Numides, alors les Vaccéens se persuadent que c'était Jugurtha, et, transportés de joie, ils vont au devant de lui. Tout à coup les cavaliers et les fantassins, à un signal donné, s'élancent à la fois : les uns taillent en pièces la foule qui sortait de la ville, les autres courent aux portes, une partie s'empare des tours. Le ressentiment et l'espoir du butin triomphent de la lassitude. Ainsi les Vaccéens n'eurent que deux jours à se féliciter de leur perfidie. Tout, dans cette grande et opulente cité, fut mis à mort ou livré au pillage. Turpilius, le commandant de la ville, que nous avons vu ci-dessus échapper seul au massacre général, cité par Metellus pour rendre compte de sa conduite, se justifia mal, fut condamné, battu de verges, et décapité, car il n'était que citoyen latin (85). |
 |
LXX. Dans ce
même temps, Bomilcar dont les conseils avaient
poussé Jugurtha à une soumission, que la
crainte lui avait fait ensuite rétracter, devenu
suspect à ce prince, qu'il suspectait lui-même,
veut sortir de cette position : il cherche quelque ruse pour
perdre le roi ; nuit et jour cette idée obsède
son esprit. A force de tentatives, il parvient enfin à
s'adjoindre pour complice Nabdalsa, homme distingué
par sa naissance, ses grandes richesses, et fort aimé
de ses compatriotes. Celui-ci commandait ordinairement un
corps d'armée séparé du roi, et
suppléait le roi dans toutes les affaires auxquelles
ne pouvait suffire Jugurtha, fatigué ou occupé
de soins plus importants ; ce qui avait valu à
Nabdalsa de la gloire et des richesses.
Ces deux hommes, dans un conciliabule, prirent jour pour
l'exécution du complot : au reste, ils convinrent de
régler leur conduite d'après les circonstances.
Nabdalsa part pour l'armée, qui était en
observation près des quartiers d'hiver des Romains,
afin de les empêcher de dévaster
impunément la campagne ; mais, épouvanté
de l'énormité du crime, au jour marqué,
il ne vint point, et ses craintes arrêtèrent le
complot. Alors Bomilcar, à la fois impatient de
consommer son entreprise, et inquiet des alarmes de son
complice, qui pouvait renoncer à leur premier projet
pour prendre une résolution contraire, lui envoya, par
des émissaires fidèles, une lettre dans
laquelle il lui reprochait sa mollesse et son défaut
de résolution ; puis, attestant les dieux qui avaient
reçu ses serments, il l'engageait à ne pas
faire tourner à leur ruine les promesses de Metellus,
ajoutant que la dernière heure de Jugurtha avait
sonné ; que seulement il était encore incertain
s'il périrait victime de leur courage ou de celui de
Metellus ; qu'enfin il réfléchît
sérieusement à ce qu'il
préférait, des récompenses ou du
supplice.
LXXI. A l'arrivée de
cette lettre, Nabdalsa, fatigué de l'exercice qu'il
avait pris, s'était jeté sur son lit.
Après avoir lu ce que lui marquait Bomilcar,
l'inquiétude, puis bientôt, comme c'est
l'ordinaire dans l'accablement d'esprit, le sommeil s'empara
de lui. Il avait pour secrétaire un Numide, qui,
possédant sa confiance et son affection, était
dans le secret de tous ses desseins, excepté du
dernier. Dès que cet homme apprit qu'il était
arrivé des lettres, pensant que, selon l'habitude, on
pouvait avoir besoin de son ministère et de ses avis,
il entra dans la tente de son maître. Nabdalsa dormait
: la lettre était négligemment posée sur
le chevet au-dessus de sa tête. Le secrétaire la
prend et la lit tout entière. Aussitôt, muni de
cet indice du complot, il court vers le roi. Nabdalsa,
réveillé peu d'instants après, ne trouve
plus la lettre : il apprend ce qui vient de se passer, et se
met d'abord à la poursuite du dénonciateur ;
mais, n'ayant pu l'atteindre, il se rend près de
Jugurtha pour l'apaiser. Il lui dit qu'un serviteur perfide
n'avait fait que le prévenir dans la démarche
que lui-même se disposait à faire ; puis, les
larmes aux yeux, il conjure le roi, au nom de l'amitié
et de sa fidélité passée, de ne pas le
soupçonner d'un pareil crime.
LXXII. Le roi, dissimulant
ses véritables sentiments, lui répondit avec
douceur. Après avoir fait périr Bomilcar et
beaucoup d'autres reconnus ses complices, il fit violence
à son courroux contre Nabdalsa, de peur d'exciter une
sédition. Mais, depuis ce temps, il n'y eut plus de
repos pour Jugurtha, ni le jour ni la nuit : en tel lieu,
avec telle personne et à telle heure que ce fût,
il ne se croyait plus en sûreté, craignant ses
sujets à l'égal de ses ennemis, épiant
tout ce qui l'environnait, s'épouvantant au moindre
bruit, couchant la nuit tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre, au mépris des
bienséances du trône. Quelquefois il
s'éveillait en sursaut, saisissait ses armes, et
poussait des cris : les terreurs dont il était
obsédé allaient jusqu'à la
démence (86).
LXXIII. A peine instruit,
par des transfuges, de la triste fin de Bomilcar et de la
découverte de la conspiration, Metellus se hâte
de faire ses préparatifs comme pour une guerre toute
nouvelle. Marius ne cessait de l'importuner pour son
congé : Metellus, ne pouvant attendre de grands
services d'un questeur qu'il n'aimait pas, et qu'il avait
offensé, le laisse enfin partir (87). A Rome, le peuple,
ayant eu connaissance des lettres concernant Metellus et
Marius, avait reçu volontiers l'opinion qu'elles
exprimaient sur l'un et sur l'autre. La noblesse du proconsul
n'était plus, pour lui un titre d'honneur, comme
naguère, mais de réprobation ; et la basse
naissance du questeur était un titre de plus à
la faveur populaire. Du reste, à l'égard de
l'un et de l'autre, l'esprit de parti influa beaucoup plus
que la considération des bonnes ou des mauvaises
qualités. Cependant des magistrats factieux ne cessent
d'agiter la multitude. Dans tous les groupes, ils accusent
Metellus de haute trahison, et préconisent outre
mesure le mérite de Marius. Enfin, ils
échauffent tellement l'esprit de la populace, que les
artisans, les laboureurs, et tous les citoyens qui n'avaient
d'autre existence, d'autre crédit, que le travail de
leurs mains, quittent leur ouvrage pour faire cortège
à Marius, se privant ainsi du nécessaire afin
de hâter son élévation. Ainsi, pour
l'abaissement de la noblesse, après une longue suite
d'années (88), on vit le consulat
déféré à un homme nouveau.
Bientôt après, le peuple, consulté par
Manilius Mancinus, l'un de ses tribuns, sur le choix du
général qui serait chargé de la guerre
de Jugurtha, proclame Marius avec acclamation. Le
sénat avait quelque temps auparavant
désigné Metellus ; mais son décret fut
comme non avenu.
LXXIV. Cependant,
privé de ses amis, dont il avait fait périr la
plupart, ou qui, par crainte, s'étaient
réfugiés chez les Romains ou chez le roi
Bocchus, Jugurtha, ne pouvant faire la guerre sans
lieutenants, et redoutant de se fier à de nouveaux
confidents, après tant de perfidie de la part des
anciens, était en proie à l'incertitude,
à l'irrésolution. Mécontent de sa
fortune, de ses projets, et de tout le monde, il changeait
tous les jours de routes el d'officiers, tantôt
marchant contre l'ennemi, tantôt s'enfonçant
dans les déserts ; mettant aujourd'hui son espoir dans
la fuite, le lendemain dans ses armes ; ne sachant s'il
devait plus se défier de la valeur de ses sujets que
de leur fidélité ; enfin, partout où il
dirigeait ses pensées, il ne voyait que malheurs et
revers. Au milieu de ces tergiversations, Metellus se montre
tout à coup avec son armée. Jugurtha dispose,
range ses troupes à la hâte, et l'action est
engagée. Là où le roi combattit en
personne, les Numides firent quelque résistance ;
partout ailleurs, ils furent, dès le premier choc,
enfoncés, mis en fuite. Les Romains prirent une assez
grande quantité d'armes et de drapeaux, mais firent
peu de prisonniers ; car presque toujours, dans les combats,
les Numides doivent leur salut moins à leurs armes
qu'à la vitesse de leurs pieds.
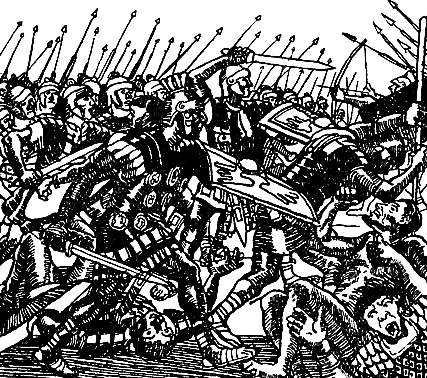 |
LXXV. Cette déroute ne fit qu'accroître le découragement et les défiances de Jugurtha. Suivi des transfuges et d'une partie de sa cavalerie, il gagne les déserts, puis Thala, ville grande et riche, où étaient ses trésors, et l'attirail pompeux qui entourait l'enfance de ses fils. Dès que Metellus est instruit de ces détails, quoiqu'il n'ignorât pas qu'entre la ville de Thala et le fleuve le plus voisin, s'étendait, sur un espace de cinquante milles, une plaine immense et aride, toutefois, dans l'espérance de terminer la guerre par la conquête de cette place, il résolut ne surmonter toutes les difficultés de la route, et de vaincre la nature elle-même. Par ses ordres, les bêtes de somme, débarrassées de tous les bagages, sont chargées de blé pour dix jours, ainsi que d'outres et d'autres vaisseaux propres à contenir de l'eau. On met ensuite en réquisition tout ce qu'on trouve d'animaux domestiques, pour porter des vases de toute espèce, surtout des vases de bois, trouvés dans les cabanes des Numides. Aux habitants des cantons voisins, qui, depuis la fuite de Jugurtha, s'étaient donnés à lui, Metellus enjoint de charrier de l'eau en abondance, puis il indique à chacun le jour et le lieu où il doit se trouver. Le proconsul lui-même fait charger ses bêtes de somme de l'eau du fleuve que nous avons dit être le plus proche de la ville. Toutes ces précautions prises, il marche vers Thala. Arrivé dans l'endroit qu'il avait assigné aux Numides, son camp à peine assis et fortifié, il tomba tout à coup une telle quantité de pluie, que l'armée eut de l'eau bien au delà de ses besoins. En outre, la provision qui fut apportée surpassa les espérances. Les Numides, comme il arrive aux peuples tout nouvellement soumis, avaient fait plus qu'il ne leur était demandé. Mais nos soldats, par un sentiment dr religion, employèrent de préférence l'eau de pluie. Cet incident accrut merveilleusement leur courage ; car ils y virent la preuve que les dieux immortels daignaient prendre soin d'eux. Le lendemain, contre l'attente de Jugurtha, les Romains arrivent à Thala. Les habitants, qui croyaient leur ville bien défendue par l'extrême difficulté de ses approches, furent confondus d'une entreprise si grande et si extraordinaire ; cependant ils se disposèrent activement au combat : autant en firent les Romains.
LXXVI. Convaincu que tout est possible à
Metellus (89), puisque les
armes, les traits, les positions, le temps, enfin la
nature elle-même, qui commande à toutes
choses, rien n'avait résisté à son
habileté, Jugurtha se sauve nuitamment de la
ville, avec ses enfants et une grande partie de ses
trésors. Depuis ce moment, il ne s'arrêta
jamais plus d'un jour ou d'une nuit dans le même
lieu, sous prétexte que ses affaires lui
commandaient cette précipitation, mais en effet
par la crainte de nouvelles trahisons, n'espérant
les éviter qu'au moyen de ces continuels
changements de séjour ; car de pareils complots
demandent du loisir et une occasion favorable. |
 |
LXXVII. Au moment de
la prise de Thala, des députés de la ville de
Leptis vinrent prier Metellus de leur envoyer une garnison et
un gouverneur. Un certain Hamilcar, disaient-ils, homme
noble, factieux, cherchait à bouleverser l'Etat.
Contre lui, l'autorité des magistrats et des lois
était sans force. Sans un prompt secours, les plus
grands dangers menaçaient l'existence d'une ville
alliée de Rome. Les habitants de Leptis avaient en
effet, dès le commencement de la guerre de Jugurtha,
député vers le consul Bestia, et ensuite
à Rome, pour demander notre alliance et notre
amitié. Depuis qu'ils les avaient obtenues, ils
s'étaient montrés d'utiles et fidèles
alliés, tous les ordres de Bestia, d'Albinus et de
Metellus, ils les avaient exécutés avec
zèle. Aussi ce dernier leur accorda facilement leur
demande ; il leur donna pour garnison quatre cohortes de
Liguriens, et C. Annius pour gouverneur.
LXXVIII. Leptis fut
bâtie par des Sidoniens, qui fuyant leur patrie en
proie aux discordes civiles, débarquèrent sur
ce rivage. Elle est située entre les deux Syrtes, qui
tirent leur nom de la disposition même des lieux
(92) ; car ce
sont deux golfes presque à l'extrémité
de l'Afrique, de grandeur inégale, mais de même
nature. Près du rivage, leurs eaux sont très
profondes ; partout ailleurs la mer y est, au gré du
hasard ou de la tempête, tantôt fort haute,
tantôt n'offrant que des bas-fonds ; car, dès
que la vague s'enfle et que les vents se
déchaînent, les flots entraînent du limon,
du sable et d'énormes rochers : ainsi l'aspect des
lieux change avec les vents.
La langue des Leptitains s'est altérée par leur
mélange avec le sang numide : à cela
près, ils ont conservé les lois et la plupart
des usages sidoniens, d'autant plus facilement qu'ils
vivaient fort éloignés de la résidence
du roi. Entre Leptis et la partie la plus peuplée de
la Numidie s'étendent au loin de vastes
déserts.
LXXIX. Puisque les affaires
de Leptis nous ont conduit dans ces contrées, il ne
sera pas hors de propos de raconter un trait
héroïque et admirable de deux Carthaginois : le
lieu même nous y fait penser.
Dans le temps que les Carthaginois donnaient la loi à
presque toute l'Afrique, les Cyrénéens
n'étaient guère moins riches et moins
puissants. Entre les deux Etats était une plaine
sablonneuse, toute unie, sans fleuve ni montagne qui
marquât leurs limites. De là une guerre longue
et sanglante entre les deux peuples, qui, de part et d'autre,
eurent des légions, ainsi que des flottes
détruites et dispersées, et virent leurs forces
sensiblement diminuées. Les vaincus et les vainqueurs,
également épuisés, craignant qu'un
troisième peuple ne vînt les attaquer,
convinrent, à la faveur d'une trêve, qu'à
un jour déterminé des envoyés
partiraient de chaque ville, et que le lieu où ils se
rencontreraient deviendrait la limite des deux territoires.
Deux frères nommés Philènes, que choisit
Carthage, firent la route avec une grande
célérité ; les Cyrénéens
arrivèrent plus tard. Fut-ce par leur faute ou par
quelque accident ? c'est ce que je ne saurais dire ; car,
dans ces déserts, les voyageurs peuvent se voir
arrêtés par les ouragans aussi bien qu'en pleine
mer ; et, lorsqu'en ces lieux tout unis, dépourvus de
végétation, un vent impétueux vient
à souffler, les tourbillons de sable qu'il
soulève remplissent la bouche et les yeux, et
empêchent de voir et de continuer son chemin (93). Les
Cyrénéens, se trouvant ainsi devancés,
craignent, à leur retour dans leur patrie,
d'être punis du dommage qu'ils lui avaient fait
encourir. Ils accusent les Carthaginois d'être partis
de chez eux avant le temps prescrit ; ils soutiennent que la
convention est nulle, et se montrent disposés à
tout plutôt que de céder la victoire. Les
Carthaginois consentent à de nouvelles conditions,
pourvu qu'elles soient égales. Les Grecs (94) leur laissent le
choix ou d'être enterrés vifs à l'endroit
qu'ils prétendaient fixer pour limites de leur pays,
ou de laisser avancer leurs adversaires jusqu'où ils
voudraient, sous la même condition. Les Philènes
acceptent la proposition ; ils font à leur patrie le
sacrifice de leurs personnes et de leur vie, et sont
enterrés vifs (95). Les Carthaginois
élevèrent sur le lieu même des autels aux
frères Philènes, et leur
décernèrent d'autres honneurs au sein de leur
ville. Maintenant je reviens à mon sujet.
Suite de la Guerre de Jugurtha
| (35) Silanus
- M. Junius Silanus fut vaincu dans les Gaules par
les Cimbres, l'année même de son
consulat. Il fut père de Silanus, consul
désigné, en l'année de la
conspiration de Catilina. |
|
| (36) Metellus.
- Q. Cécilius Metellus, surnommé dans
la suite le Numidique, «de l'illustre maison
Cécilia, est, dit le président de
Brosses, le seul homme de bien parmi les
personnages qui jouent un rôle
considérable dans cette histoire».
Velleius Paterculus et Cicéron le louent
comme orateur et pour ses vertus publiques ;
Valère-Maxime, Florus, Appien, Aurelius
Victor, en un mot tous les auteurs anciens sont
remplis de ses éloges. Plutarque avait
écrit sa vie, que nous n'avons plus. |
|
| (37) Pensant
qu'il ne devait pas attendre le concours de son
collègue, il dirigea exclusivement toutes
ses pensées vers la guerre. - Ces mots
alia omnia sibi cum collega ratus n'avaient
jusqu'ici été entendus que par un
seul traducteur, M. Lebrun. M. Burnouf en a
donné l'interprétation la plus
satisfaisante dans son commentaire latin ; et c'est
à lui que je dois d'avoir le premier rendu
aussi exactement en français ce membre de
phrase où brille l'inimitable concision de
Salluste. Traduits littéralement, ces mots
veulent dire pensant que toute autre chose
était à faire à lui, avec son
collègue, il dirigea ; mais cela ne
serait pas supportable en français. J'ai
dû y substituer ce gallicisme : pensant
qu'il ne devait pas attendre le concours de son
collègue, etc. Ici, ces mots alia
omnia, emportent absolument le même sens
que cette expression négative nequaquam
hoc ; témoin cette formule pour exprimer
que le sénat de Rome n'accueillait point une
proposition : senatus in alia omma
discessit. On la retrouve dans les lettres de
Cicéron, liv. I, épît. II :
De tribus legatis, frequentes ierunt in alia
omnia ; en français : «à
l'égard des trois commissaires, la
majorité se déclara pour tout autre
parti». Dans Pline le Jeune, liv. III,
épît. XLV, cette locution est
plusieurs fois citée dans le même sens
et comme formule judiciaire : Qui haec sentitis,
in hanc partem : qui alia omnia, in illam partem
ite, qua sentitis ? examina singula verba, expende,
qui haec censetis, hoc est, qui relegandos putatis,
n hanc partem, id est in eam in qua sedet qui
censuit relegandos. Qui alia omnia : animadverts,
ut non contenta lex dicere : alia addiderit omnia.
Num ergo dubium est, alia omnia sentire eos, qui
occidunt quam qui relegant ? En français
: «Vous qui êtes d'une telle opinion,
passez de ce côte : vous qui êtes de
toute autre, rangez-vous du côté de
celui dont vous suivez ravis ! Examinez, je vous
prie, et pesez chaque mot : vous qui êtes
d'un tel avis, c'est-à-dire vous qui pensez
qu'on doit reléguer les affranchis, passez
de ce côté-là,
c'est-à-dire du côté où
est assis l'auteur de cet avis... Vous qui
êtes de tout autre avis. Vous voyez que la
loi ne s'est pas contentée de dire d'un
autre, mais de tout autre. Or peut-on douter que
celui qui ne veut que reléguer est de tout
autre avis que celui qui veut qu'on fasse mourir
?» Revenons à la phrase de Salluste :
sibi cum collega (esse) est une locution
analogue à celle-ci : quid mihi tecum
? ainsi, comme l'a observé M. Burnouf,
il était bien inutile de charger le texte de
Salluste du mot communia, qu'on ne trouve
dans aucun manuscrit. |
|
| (38) Le
blé des distributions publiques. - On
distribuait au soldat romain non du pain chaque
jour, mais du blé pour un mois. De Brosses
évalue à soixante livres de
blé la ration de chaque soldat d'infanterie.
Le cavalier recevait sept médimnes d'orge
par mois et deux de froment. Le médimne fait
environ la moitié du setier de France. |
|
| (39) Ou
de tout autre aliment cuit. - «Q.
Metellus, dit Frontin (Stratag., liv. IV,
ch. 1), dans la guerre de Jugurtha rétablit
la discipline par une pareille
sévérité : il défendit
aux soldats d'user d'autres viandes que de celles
qu'ils avaient eux-mêmes fait rôtir ou
bouillir». |
|
| (40) Portât
lui-même ses vivres et ses armes. -
«Le soldat romain, dit Cicéron
(Tusc, liv. II, ch. XVI), marche
extraordinairement chargé. Il faut qu'il
porte tous ses ustensiles et ses vivres pour plus
de quinze jours, outre les pieux et les palissades
pour enclore le camp, en arrivant le soir. On ne
parle pas du bouclier, du casque, ni du reste de
l'armure, qui ne sont pas plus comptés dans
le poids que le soldat porte, que ses bras et ses
mains : car le proverbe militaire dit que les armes
sont les membres du soldat». Voyez encore
Valère-Maxime, liv. II, ch. VII, n°
2. |
|
| (41) Dans
l'appareil des suppliants. - Ces mots cum
supplicis signifient ou supplications orales,
ou cet appareil de suppliants qui consistait
à se présenter à l'ennemi avec
des branches d'olivier ou de verveine pour demander
la paix. |
|
| (42) Une
réponse conforme aux désirs de leur
roi. - «Metellus, faisant la guerre à
Jugurtha, dit Frontin, engagea les ambassadeurs que
lui envoya ce prince à trahir leur
maître. D'autres leur ayant
succédé, il en agit de même,
aussi bien qu'avec ceux qui vinrent vers lui en
troisième lieu ; mais, s'il ne put
réussir à ce que Jugurlha lui
fût livré vivant, il n'en retira pas
moins un avantage réel de toutes ces
trahisons : car, les lettres qu'il avait
écrites aux confidents du roi ayant
été interceptées, Jugurtha
sévit contre eux tous ; et, après
s'être privé de ses conseillers, de
ses amis, il ne put en trouver d'autres».
(Strat , liv. I, ch. VIII, n° 8.) Ce
n'était pas à de semblables ruses que
descendaient les Camille et les Fabricius ; et
cependant Metellus passait pour l'un des hommes les
plus vertueux de son temps ! Ce qui choque encore
davantage les idées que nous avons de la
morale et du droit des gens, c'est de voir Salluste
ne pas désapprouver une semblable perfidie,
et Frontin la confondre avec les stratagèmes
qu'autorise la guerre, et la citer pour
modèle. |
|
| (43) C.
Marius. Il naquit à Cirréaton,
petit village du territoire d'Arpinum. Il
était fils de Marius Gratidius, dont la
soeur avait épousé Tullius
Cicéron, aïeul du célèbre
orateur. La famille de Marius ayant
été de tout temps sous la
clientèle de la maison Cécilia, ses
parents l'envoyèrent à Rome, et le
mirent sous la protection de Metellus, dont il
devait payer les hontes par la plus horrible
ingratitude. Il fit ses premières armes
à Numance, sous Scipion Emilien, qui ne
tarda pas à deviner un grand capitaine dans
l'obscur centurion d'Arpinum. Quelques
années après, l'an 634 de Rome,
Marius obtint le tribunat par la protection de
Metellus ; et c'est dès lors qu'il
commença à se déclarer
l'ennemi de la noblesse. Ayant proposé sur
les élections une loi contraire à
l'autorité des patriciens, il alla
jusqu'à menacer de la prison le consul Cotta
et Metellus son bienfaiteur, s'ils continuaient
à s'y opposer. Au sortir du tribunat, il
brigua vainement l'édilité curule ;
puis, s'étant le même jour rabattu sur
l'édilité plébéienne,
il essuya un second refus ; mais, peu
découragé par ce double revers, il
demanda quelque temps après la
préture, et ne l'obtint qu'en achetant les
suffrages du peuple. Accusé pour ce
délit, il échappa, par le partage
égal des voix, à la condamnation
qu'il méritait. Marius tint une conduite
honorable dans sa préture et dans le
gouvernement de l'Espagne, d'où il revint
pauvre. De retour à Rome, malgré son
défaut d'éloquence et de fortune, il
acquit une grande considération par sa
fermeté, son énergie et la
simplicité de sa manière de vivre.
Ces qualités le firent admettre dans la
maison Julia, et il épousa la tante de Jules
César. Lors de la guerre de Numidie,
Metellus, qui aimait Marius et le connaissait pour
un très habile officier, le choisit pour son
lieutenant. |
|
| (44) Les
vélites. - C'étaient de jeunes
soldats agiles et vigoureux, dressés
à la manoeuvre de la cavalerie et de
l'infanterie. Tite-Live (liv. XXV1, ch. IV),
Valère-Maxime (liv. II, ch. III, n° 3)
et Frontin (liv. IV, ch. VIII, n° 29) nous
apprennent que cette milice fut inventée par
le centurion Q. Névius, au siège de
Capoue, pendant la seconde guerre punique (an de
Rome 542). Valère-Maxime ajoute que, de sou
temps, on honorait encore la mémoire de cet
habile officier. Appien d'Alexandrie (de Bellis
punic.) et Végèce (liv. III, ch.
XXIV) attestent qu'on employait les vélites
pour porter le désordre dans les corps
d'éléphants. Ce nom de vélites
venait de volitare, quasi volitantes,
a prétendu un des glossateurs du texte de
Végèce ; velites dicuntur expediti
milites, dit Festus, au texte duquel se trouve
cette glose non moins suspecte : quasi volites,
id est volantes. |
|
| (45) Pour
s'assurer l'avantage d'une place d'armes. - Il
y a dans notre texte et si paterentur
opportunitates loci, etc. Ce passage a
donné lieu à une grande
variété de versions : les uns, comme
d'Otteville, Lebrun et M. Burnouf, adoptent et
si paterentur opportunitates loci ; d'autres,
comme M. Mollevaut, ajoutent le mot
opperiundi à cette phrase, qu'ils
écrivent ainsi : et opperiundi si
paterentur opportunitates loci. J'ai suivi la
version adoptée par Beauzée et Dureau
Delamalle ; mais, quelle que soit celle que l'on
choisisse, il faut toujours beaucoup d'efforts pour
comprendre la pensée de Salluste, que
l'excessive concision du style dérobe
presque au lecteur. |
|
| (46) Du
milieu s'élève une espèce de
colline. - Le président de Brosses, qui,
du reste, donne des explications si satisfaisantes
sur la bataille de Muthul, me paraît avoir
mal compris ce passage : c'était du milieu
de la montagne, et non pas du milieu de la plaine
intermédiaire, que s'élevait cette
colline. Cela posé, il est assez facile de
comprendre le récit de la bataille que
raconte ici Salluste. Au reste, j'ai pour moi
l'autorité de d'Otteville, Beauzée,
M. Mollevaut, M. Burnouf. Lebrun et Dureau
Delamalle ont entendu comme de Brosses. |
|
| (47) Tous
les escadrons et toutes les compagnies. - Singulas
turmas atque manipulos. On a blâmé
Salluste d'avoir employé ces termes de la
tactique romaine pour désigner les divers
corps de l'armée numide : ce reproche me
paraît peu fondé. Depuis le
règne de Masinissa, les rois numides
s'étaient attachés à
établir dans leurs Etats des coutumes et des
dénominations romaines. C'est ainsi que,
dans des précédents chapitres,
Salluste nous a parlé du premier licteur de
Jugurtha, des préfets de ce prince. Ne se
rappelle-t-on pas qu'après la seconde guerre
punique le sénat envoya à Masinissa
les ornements des magistratures curules, et que ce
prince se fit gloire de s'en revêtir ? |
|
| (48) Rutilius.
- Publius Rutilius Rufus «était, dit
Velleius Paterculus, le plus honnête homme,
non seulement de son siècle, mais qui ait
jamais vécu». On le regardait comme le
plus versé de tous les Romains dans la
philosophie stoïque, qu'il avait
étudiée sous Panétius.
Cicéron rappelle avec éloge la
gravité digne avec laquelle Rutilius parlait
en public. Il servit avec distinction en
qualité de tribun militaire au siège
de Numance, sous les ordres de Scipion Emilien.
Plus tard il fut questeur de Mucius Scévola,
ce vertueux personnage qui, dans le gouvernement de
l'Asie, montra tant d'équité, de
douceur et de désintéressement. Il
fut ensuite tribun du peuple, puis préteur ;
enfin Metellus le choisit pour son lieutenant.
Quand on eut ôté à celui-ci le
commandement de la guerre de Numidie, Rutilius
revint à Rome, ne voulant pas servir sous
Marius. Consul l'an 648 de Rome, il forma les
troupes avec lesquelles Marius vainquit les
Cimbres. En 660, il prit avec chaleur la
défense de la province d'Asie contre les
vexations des publicains. Dès ce moment il
se vit en butte à la haine des chevaliers
romains, qui lui intentèrent une accusation
de péculat. Il se défendit avec
simplicité, sans descendre à
l'attitude de suppliant. Malgré son
innocence reconnue, il fut déclaré
convaincu, et se retira à Smyrne, où
il passa le reste de ses jours, entièrement
livré à l'étude. Lorsque
Mithridate fit massacrer tous les citoyens romains
qui se trouvaient en Asie, Rutilius eut le bonheur
d'échapper à la mort. Sylla,
vainqueur de Mithridate, lui proposa de revenir
à Rome avec lui ; Rutilius s'y refusa
«pour ne pas faire, dit Valère-Maxime,
quelque chose contre les lois». Durant son
exil, il écrivit en langue grecque
l'histoire romaine de son temps. Il composa ses
Mémoires, dont Tacite fait l'éloge
dans la Vie d'Agricola. |
|
| (49) La
tête de la colonne. - Ici, par le mot
principes, il ne faut pas entendre les
princes, c'est-à-dire le corps de troupes
qui portait ce nom, mais bien ceux qui marchaient
les premiers. |
|
| (50) Profilant
de l'avantage du nombre. - Cortius, et
après lui Desmares, le Masson, de Brosses,
d'Otteville Lebrun, Mollevaut et Burnouf appliquent
aux Numides ces mots numero priores.
Beauzée et Dureau Delamalle les font
rapporter aux Romains. La construction de la
phrase, et même l'intelligence du sens,
n'excluent ni l'une ni l'autre de ces deux
explications ; mais, dans le doute, je me suis
décidé pour celle qui compte en sa
faveur la majorité des suffrages. |
|
| (51) Quatre
cohortes légionnaires. - C'est mal
à propos que Salluste se sert du mot
cohortes ; car la division des
légions en cohortes est postérieure
à la bataille de Muthul, puisqu'elle fut
l'ouvrage de Marius pendant son second consulat,
deux ans après cette bataille, l'an de Rome
647. Au reste, ce genre d'inadvertance est
très commun chez les historiens anciens ;
Tite-Live l'a commise fort souvent à
l'occasion des cohortes. Ainsi, dans son liv. XXIV,
ch. XXXIV, en racontant le siège de
Syracuse, il fait mention des vélites, qui
ne furent institués que deux ans
après. |
|
| (52) Il
exhorte les siens. - Une des grandes
difficultés pour les traducteurs d'auteurs
latins, ce sont les discours indirects, qui se
rencontrent si souvent dans Tite-Live et dans
Tacite, comme dans Salluste. «Ces discours
indirects sont durs et fatigants en
français, observe d'Otteville, au lieu
qu'ils ont de la grâce en latin. Il est
à présumer que l'auteur qu'on
traduit, si c'est un homme de goût, les
aurait évités en écrivant dans
notre langue. Les historiens latins ont
travaillé et poli avec soin le discours
direct. Telles sont les harangues que Salluste met
dans la bouche de César, de Caton et de
Marius même, le moins éloquent des
Romains. Ils ont au contraire laissé brut et
sans ornements le discours indirect : l'un est
l'édifice entier, l'autre n'en est que la
charpente et les matériaux». De ces
réflexions faut-il conclure qu'un traducteur
peut se donner la licence de changer en discours
directs ceux que son auteur a laissés sous
l'autre forme ? D'Otteville répond avec
raison qu'on doit rarement prendre cette latitude.
«La majesté de l'histoire, ajoute ce
critique, n'aurait-elle pas lieu de rougir de la
ressemblance qu'un trop grand nombre de discours
directs lui donnerait avec nos romans modernes
?» |
|
| (53) Par
la nuit tombante. - Etjam die vesper
erat. Ici, die est pour diei,
comme dans ce vers de Virgile,
Géorg., liv. I, v. 208 : Libra die
somnique pares ubi fecerit horas. Servius en
prend occasion de remarquer que c'était
là l'ancienne forme du génitif, et
que Salluste avait dit encore acie pars pour
aciei ; mais le passage auquel fait allusion
Servius est perdu, tandis que, dans le chapitre
XCVII de la Guerre de Jugurtha, nous voyons
que notre historien dit encore vix decima parte
die reliqua pour diei. |
|
| (54) Au
peu de connaissance que nous avions du pays. -
Ici, ignara est pour ignota. Sallusto
a usé précédemment de la
même locution, en disant ignara lingua
{voyez ci-dessus, ch. XVIII) pour ignorata.
M. Burnouf signale un exemple semblable dans les
Annales de Tacite (liv. XV, ch. LXXVII) :
Cui enim ignaram fuisse saevitiam Neronis
? |
|
| (55) Il
avait tenues fort serrées. - Arte
statuerat. Ici, arte est pour
arcte adverbe, qui signifie
étroitement. |
|
| (56) Et
la joie de la victoire. - Fessi laetique
erant. J'ai adopté cette version, qui a
pour elle l'autorité des Mss. et celle
d'Havercamp, de Cortius et de M. Burnouf.
D'ailleurs, rien n'est plus contraire à la
brièveté de Salluste que cette
version adoptée par plusieurs
éditeurs : fessi lassique. |
|
| (57) Chez
quel peuple s'était réfugié
Jugurtha. - J'ai interprété tout
autrement cette phrase qu'on ne l'a fait
jusqu'à présent : Jugurtha ubi
gentium. Tous les autres traducteurs ont mis
en quel lieu était Jugurtha ; mais
cela ne rend pas la force du mot gentium. Si
ubi gentium avait été mis par
Salluste pour ubinam, il y aurait ici une
emphase bien gratuite. Metellus ne pouvait-il pas
supposer que Jugurtha s'était retiré
chez les Gétules ou chez les Maures, comme
il le fit plus tard ? |
|
| (58) La
nuit, dérobant sa marche par des routes
détournées - «On raconte,
dit Frontin (liv. II, ch. 1, n° 13), que
Jugurtha, se souvenant de l'épreuve qu'il
avait faite de la valeur romaine, avait coutume de
n'engager d'action qu'au déclin du jour,
afin que si ses troupes étaient mises en
fuite par l'ennemi, elles pussent couvrir leur
retraite à la faveur de la
nuit». |
|
| (59) Les
cohortes. - Il s'agit ici des cohortes des
alliés ; et, dans ce cas, cette expression
n'est point un anachronisme. |
|
| (60) Leur
impuissance de le trahir. - Par la crainte des
horribles supplices qui les attendaient s'ils
venaient à tomber en la puissance des
Romains. Valère-Maxime (liv. II, ch. VII) en
donne divers exemples : Q. Fabius Maximus leur fit
couper les mains (n° 11); Scipion, le premier
Africain, les fit mettre en croix (n° 12) ; le
second Africain les livra aux bêtes (n°
13); Paul-Emile les fit fouler aux pieds par les
éléphants (n° 14). |
|
| (61) Les
autres s'approchent. - Le texte de cette phrase
a été interpolé par des
éditeurs ou par des traducteurs qui ne
l'avaient pas comprise. Romani, pro ingenio
quisque, dit Salluste, pars eminus glande,
aut lapidibus pugnare, alii succedere, ac murum
modo suffodere, modo scalis adgredi : cupere
proelium in manibus facere. L'explication de
ces mots, pro ingenio, etc., «selon
que chacun a plus ou moins de courage», se
trouve dans l'opposition des uns, qui se contentent
de jeter de loin des projectiles, pars
eminus, etc.,«et des autres, qui
s'approchent de la muraille, brûlant de
combattre de près», alii
succedere, etc. ; mais des éditeurs,
faute de comprendre succedere, qui veut dire
s'approcher des murailles, succedere muris,
ont cru la phrase incomplète, et, avant ce
membre de phrase, ont ajouté evadere
alii. M. Burnouf, dans son édition, a,
d'après Cortius, fait justice de cette
interpolation. |
|
| (62) Des
torches enduites de poix et de soufre. - Il y a
dans le latin praeterea pice et sulfure taedam
mixtam. D'autres éditeurs, entre autres
M. Burnouf, adoptent une version différente
: Picem sulfure et taeda mixtam.
«Taeda, dit ce savant philologue, sing.
numero, hic sumetur non pro una aliqua face, sed
pro materia ipsa, qua faces seu taedae
fiunt». Le président de Brosses cite à ce sujet un fragment de Quadrigarius, ancien historien antérieur à Salluste, et qui avait écrit, dans ses Annales, l'histoire du siège de Zama. En rapportant de quelle manière Metellus faisait soutenir ceux qui montaient à l'assaut par les frondeurs et par les archers, Quadrigarius remarque qu'en pareil cas ces sortes de troupes ont beaucoup d'avantage sur celle du même genre, qui défendent la muraille. «Car, dit-il, ceux qui se servent de l'arc et de la fronde ne peuvent jamais tirer juste de haut en bas. Leurs traits n'incommodaient que fort peu les soldats de Metellus ; au lieu que les coups de ces sortes d'armes, étant beaucoup plus sûrs de bas en haut, défendaient aux assiégés l'approche de leurs créneaux». |
|
| (63) Sur
le camp des ennemis. - Castra hostium. On a
remarqué que cet endroit est du petit nombre
de ceux où Salluste appelle les Romains les
ennemis. |
|
| (64) Pour
le meurtre de Massiva. - Voyez ci-dessus, ch.
XXXV. Le lecteur a pu remarquer avec quel soin
Salluste affecte de rappeler en peu de mots des
circonstances qu'il a déjà
rapportées, ce qui donne à sa
narration quelque chose de l'exactitude du style
archaïque. Le traducteur français doit
respecter ce caractère particulier du style
de notre auteur, et ne pas se permettre de rejeter
ces répétitions, comme le P.
d'Otteville l'a fait en cet endroit. |
|
| (65) Des
ambassadeurs sont envoyés au
général romain. - Salluste ne dit
pas qu'ils furent gagnés par Metellus ; mais
Frontin, dans un passage déjà
cité, le dit positivement : Eodem
consilio usus est et adversus tertios.
«Il suivit la même conduite à
l'égard d'une troisième
ambassade». (Strat., liv. I, ch. VIII, n°
8) |
|
| (66) Tous
les sénateurs. - Les sénateurs
qui se trouvaient à l'armée
étaient les lieutenants du consul, les
questeurs, et même les tribuns des quatre
premières légions. Cicéron
(discours pour Cluentius, ch. LIV) parle des
tribuns de ces légions comme ayant voix au
sénat. |
|
| (67) Aptes
à y prendre place. - Idoneos ne
veut pas dire les plus habiles, les plus dignes,
comme l'ont entendu plusieurs traducteurs ; mais
ceux qui, par leur grade, étaient aptes
à être appelés à ce
conseil de guerre. Au surplus, on voit, dans les
Commentaires de César, que les
conseils de guerre se composaient de la plupart des
tribuns militaires et des centurions de
première classe : compluresque tribuni
militum et primorum ordinum centuriones. (De
Bell. gall., lib. V, cap. XXIX) |
|
| (68) La
plupart furent effectivement livrés. -
Trois mille transfuges furent livrés, dit
Paul Orose, outre trois cents otages et une grande
quantité de blé (liv. V, ch.
XIV). |
|
| (69) Pour
y recevoir de nouveaux ordres - Ad
imperandum, qui se trouve dans le texte, est
ici pour ut et imperaretur ; et prouve,
entre mille exemples, que les gérondifs
latins ont le sens actif ou passif. Ainsi, dans le
ch. V ci-dessus, nous avons vu quo ad
cognoscendum (pour ut cognoscantur)
omnia illustria magis magisque in aperto
sunt ; dans Justin (liv. XVII, ch. III),
Athenas erudiendi (pour ut erudiretur)
gratia missus ; dans Velleius (liv. II, ch.
XV), ut cives romanos ad censendum (pour
ut censerentur) ex provinciis in Italiam
revocaverint. M. Burnouf, dans son
Commentaire, cite encore plusieurs exemples
de cette singularité philologique. La loyauté réprouve assurément la conduite de Metellus à l'égard de Jugurtha ; mais elle avait pour elle l'approbation du sénat de Rome, dont la politique n'était jamais gênée par aucune considération d'honneur ou d'équité. C'est ce qui a fait dire à Montesquieu : «Quelquefois ils traitaient de la paix avec un prince sous des conditions raisonnables ; et, lorsqu'il les avait exécutées, ils en ajoutaient de telles, qu'il était forcé de recommencer la guerre. Ainsi, quand ils se furent fait livrer par Jugurtha ses éléphants, ses chevaux, ses trésors, ses transfuges, ils lui demandaient de livrer sa personne ; chose qui, étant pour un prince le dernier des malheurs, ne peut jamais être une condition de paix». |
|
| (70) L'aruspice
lui prédit. - Marius prétendait avoir
eu de tout temps des présages de sa grandeur
future. Plutarque, dans la vie de ce Romain,
rapporte tous les contes qu'il sut répandre
parmi le vulgaire ignorant, et qui semblaient
annoncer son élévation. Mais, comme
l'observe fort bien le président de Brosses,
parmi ces présages, on doit mettre au
premier rang le jugement que Scipion Emilien
porta sur Marius au siège de Numance,
où, selon Velleius, Jugurtha ac Marius sub
eodem Africano militantes in iisdem castris
didicere, quae postea in contrariis facerent.
Cet oracle d'un grand homme valait bien celui du
prêtre d'Utique, et l'on ne doit pas douter
qu'il n'ait, plus que tout autre motif,
enflammé l'ambition de Marius. Quoi qu'il en
soit, cet illustre Romain parut toute sa vie
ajouter une foi entière à ces
prédictions. Etait-il la première
dupe de ces prestiges ? c'est ce qu'on ne saurait
décider. L'ignorance et la
grossièreté de Marius
n'étaient pas affectées ; mais il
n'en est pas moins vrai que la rudesse de ses
manières cachait l'esprit le plus subtil et
le plus rusé. Nous ne déciderons pas,
comme de Brosses, que Marius avait lui-même
dicté la prédiction du prêtre
d'Utique. L'enthousiasme qu'inspiraient à
tant de Romains les vertus incultes du lieutenant
de Metellus, les espérances que le parti
populaire attachait à son
élévation, peuvent bien avoir fait
tout le prodige. |
|
| (71) Que
tout lui serait prospère. - Cuncta
prospera eventura. Ici, prospera est
pour l'adverbe prospere. Ainsi, dans la
Catilinaire (ch. XXVI) : Quae occulte
tentaverat aspera foedaque evenerant, pour
aspere foedeque. |
|
| (72) Simplicité
dans la paix. - Velleius Paterculus fait de
Marius un portrait à peu près
semblable : Natus agresti loco, hirtus atque
horridus, vitaque sanctus ; quantum bello optimus
tantum pace pessimus, immodicus gloriae,
insatiabilis, impotens, semperque inquietus
(lib. II, cap. X). Ailleurs ce même
historien, en rapportant la mort de Marius, ajoute
: Vir in bello hostibus, in otio civibus
infestissimus, quietisque impatientissimus.
(Ibid., cap. XVI). |
|
| (73) Que
son ambition perdit par la suite. -
Après Plutarque (in Mario) et Appien
(de Bell. civ., lib. I), on peut consulter
Valère-Maxime sur les étranges
vicissitudes qui marquèrent la vie de Marius
(liv. VI, ch. IX, n° 14). |
|
| (74) Indigne
de cet honneur. - Salluste présente
à peu près les mêmes
réflexions au sujet des difficultés
que Cicéron eut à vaincre pour
arriver au consulat (Bell. Catil., ch.
XXIII). En effet, le triomphe de Sylla sur la
faction populaire avait placé la
République presque dans la même
situation où elle se trouvait après
la mort des Gracques. Et il est assurément
bien digne de remarque que deux citoyens natifs
d'Arpinum, unis par les liens du sang (car
Cicéron était, par les femmes, neveu
de Marius), aient, à quarante ans
d'intervalle, éprouvé les mêmes
difficultés pour parvenir au consulat. |
|
| (75) A
peine dans sa vingtième année. -
Plutarque (Vie de Marius) rapporte ce
même propos de Metellus. Or l'âge
fixé par les lois pour le consulat
était de quarante-trois ans. Marius aurait
donc eu vingt-quatre ans à attendre avant de
se mettre sur les rangs. Le mot était
d'autant plus injurieux, que ce
plébéien ambitieux, né l'an de
Rome 698 (156 av. J.-C), était alors dans sa
quarante-huitième année. Le fils de
Metellus s'appelait Q. Cécilius Metellus ;
il fut surnommé Pius dans la suite,
à cause du zèle pieux avec lequel il
sollicita du peuple le rappel de son père,
qu'avait fait exiler l'ingrat Marius. Ici se trouve
quelque différence entre Salluste et le
témoignage de Frontin au sujet de la
première campagne du jeune Metellus. Par ces
mots : Contubernio patris ibidem militabat,
notre historien semble faire entendre qu'il vivait
pour ainsi dire sur le pied d'égalité
avec son père. Le consul Metellus, au
contraire, selon Frontin, bien qu'aucune loi ne lui
défendît d'admettre son fils sous la
même tente que lui, voulut cependant qu'il
vécût comme un simple soldat : Q.
Metellus consul, quamvis nulla lege impediretur
quin filium contubernalem perpeluum haberet, maluit
tamen in ordine merere. Il est probable que
c'est Frontin qui a le mérite de
l'exactitude pour cette petite circonstance, sur
laquelle Salluste, occupé de la suite des
faits, n'a sans doute pas arrêté son
attention. |
|
| (76) Tous
les moyens lui semblent bons. - Diodore
(fragments du liv. XXXIV) présente la
conduite de Marius sous des couleurs plus
honorables ; mais il est à croire que
Velleius Paterculus, Plutarque, et surtout
Salluste, ont été mieux
informés. |
|
| (77) Les
gens pressés ne trouvent jamais qu'on aille
assez vite. - D'autres traducteurs ont dit : Et
que la cupidité ne sait jamais attendre. Ce
sens est assurément très plausible ;
mais j'ai voulu conserver l'espèce de vague
qui se trouve dans la phrase de Salluste. |
|
| (78) Avait
substitué ses Etats. - D'après
cette disposition testamentaire de Micipsa, Gauda
serait devenu l'héritier du trône en
cas de décès d'Adherbal, d'Hiempsal
et de Jugurtha. |
|
| (79) Pour
des cavaliers romains. - Il y a dans le latin
equites ; quelques traducteurs ont rendu ce
mot par chevaliers romains, ce qui est
absurde. Duplices fuerunt equites, dit Rosin
(Antiquit. rom.), alii oppositi peditatui
in exercitu, quales fuerunt omnes qui equo privato
meruerunt, et illi nihil ad hunc ordinem (equitum
roman.) pertinuerunt. Salluste n'énonce
pas tous les motifs de ressentiment qu'avait Gauda
contre Metellus, qui lui avait refusé de lui
remettre entre les mains certains transfuges
numides. (Voyez les Fragments de Dion
Cassius.) |
|
| (80) Et
les chevaliers romains, tant militaires que
négociants. - Il est bien évident
ici que, par ces mots : et equites romanos,
milites et negotiatores, Salluste n'indique pas
trois sortes, mais un seul ordre de personnes, qui,
attachées à la classe des chevaliers
romains, servaient les unes dans l'armée,
les autres faisaient le commerce à Utique.
On sait, en effet, que les chevaliers romains
exerçaient à la fois le négoce
et la perception des impôts dans les
provinces. |
|
| (81) Très
défavorable à Metellus. - On lit
dans les fragments d'Appien sur la guerre de
Numidie, que Metellus n'était pas
aimé des troupes à cause de la
rigueur avec laquelle il faisait observer la
discipline. «Ainsi, ajoute Dion Cassius, les
calomnies que Marius débitait contre lui
étaient écoutées avec
avidité, aussi bien par les soldats que par
les commerçants d'Afrique, et par le menu
peuple de Rome». (Fragments recueillis par
Valois.) |
|
| (82) Par
la loi Mamilia. - Salluste désigne ainsi
la loi qu'avait fait rendre le tribun C. Mamilius
Limetanus, suivant la coutume des Romains de donner
aux lois le nom de ceux qui les avait
proposées. (Voyez le ch. XL). |
|
| (83) Détestait
l'ordre et le repos. - Quelque peu porté
que doive être un traducteur à ajouter
à Salluste, voici cependant un de ces
passages en style pour ainsi dire archaïque,
où, pour la liaison des idées, il
faut bien qu'il ait recours à la
paraphrase. |
|
| (84) Vers
la troisième heure. - Les Romains
comptaient douze heures de jour depuis le lever
jusqu'au coucher du soleil : ainsi la
troisième heure était alors ce qu'est
pour nous neuf heures du matin ; un peu plus
tôt en été, un peu plus tard en
hiver. |
|
| (85) Il
n'était que citoyen latin. - Les lois
pénales ne prononçaient pas la mort
contre les citoyens romains, dont le dernier
supplice était l'exil ; mais cette
disposition, établie successivement par les
lois Porcia et Sempronia, n'était pas
observée à l'armée pour un
citoyen qui avait commis quelque faute grave contre
son devoir. L'histoire en fournit plusieurs
exemples, et l'on ne voit pas pourquoi Salluste
fait ici cette distinction. Au reste, si l'on en
croit Plutarque (Vie de Marius), Turpilius
était innocent, et sa condamnation fut
l'ouvrage de Marius. Il avait échappé
au massacre de Vacca, «parce qu'il traitait,
dit Plutarque, doucement et gracieusement les
habitants d'icelle». Metellus avait
voté pour l'absoudre ; mais, son avis
n'ayant pas prévalu, il fut obligé de
prononcer l'arrêt de mort. L'innocence de
Turpilius fut depuis reconnue. On conçoit la
douleur de ses juges. Seul, le féroce Marius
s'en réjouit. Il se vanta «d'avoir
attaché au cou de Metellus une furie
vengeresse, du sang de son hôte qu'il avait
fait mourir à tort». Metellus, selon
Appien, fit mourir aussi tous les principaux
habitants de Vacca. |
|
| (86) Allaient
jusqu'à la démence. - Ce tableau
énergique des angoisses de Jugurtha rappelle
un passage de Télémaque (liv.
III), dans lequel Fénelon a, sous le nom de
Pygmalion, décrit les terreurs continuelles
dont Cromwell était obsédé.
«Tout l'agite, tout l'inquiète, le
ronge ; il a peur de son ombre ; il ne dort ni nuit
ni jour... On ne le voit presque jamais ; il est
seul, triste, abattu, au fond de son palais ; ses
amis mêmes n'osent l'aborder de peur de lui
devenir suspects. Une garde terrible tient toujours
des épées nues et des piques
levées autour de sa maison. Trente chambres
qui communiquent les unes aux autres, et dont
chacune a une porte de fer et six gros verrous,
sont le lieu où il se renferme : on ne sait
jamais dans laquelle de ces chambres il couche, et
ou assure qu'il ne couche jamais deux nuits de
suite dans la même, de peur d'y être
égorgé», etc. Après
Fénelon, M. Villemain, dans la Vie de
Cromwell, a retracé les mêmes
particularités, et tout le morceau
paraît le plus heureusement inspiré
par Salluste : «Menacé par de
continuels complots, effrayé de vivre au
milieu des haines innombrables qu'il avait
soulevées contre lui,
épouvanté du prix immense que l'on
pouvait attacher à sa mort, redoutant la
main d'un ami, le glaive d'un émissaire de
Charles ou d'un fanatique, il portait sous ses
vêtements une cuirasse, des pistolets, des
poignards, n'habitait jamais deux jours de suite la
même chambre, craignait ses propres gardes,
s'alarmait de la solitude, sortait rarement, par de
brusques apparitions, au milieu d'une escorte
nombreuse ; changeait et mêlait sa route, et,
dans la précipitation de ses voyages,
portait quelque chose d'inquiet,
d'irrégulier, d'inattendu, comme s'il avait
toujours eu à déconcerter un plan de
conspiration ou à détourner le bras
d'un assassin». Ces derniers traits
s'appliquent plus particulièrement, comme
imitation, à ce qu'ajoute Salluste, au
chapitre LXXIV, sur l'affreuse situation d'esprit
de Jugurtha. |
|
| (87) Et
qu'il avait offensé, le laisse enfin partir.
- Simul et invisum et offensum sibi. Des
éditions portent invitum au lieu
d'invisum ; mais ce mot fait
pléonasme après cette circonstance
notée par Salluste, fatigantem de
profectione, tandis que l'opposition est
parfaitement juste entre invisum et
offensum. - Le laisse enfin partir.
Plutarque rapporte que Metellus ne laissa partir
Marius que douze jours avant les comices. En deux
jours et une nuit celui-ci fit le long trajet qu'il
y avait du camp jusqu'à Utique ; puis
delà, après quatre jours de
navigation, il arriva en Italie, et se hâta
de se présenter devant l'assemblée du
peuple pour solliciter le consulat. |
|
| (88) Après
une longue suite d'années. - Post
multas tempestates. Quelques traducteurs ont
rendu ces mots par ceux-ci : Après
beaucoup de troubles ; contre-sens. On sait
d'ailleurs que cette élection de Marius se
fit sans aucune opposition. (Plutarque, Vie de
Marius) Salluste emploie les mêmes
expressions dans sa Catilinaire (ch. LVI) :
multis tempestatibus. |
|
| (89) Convaincu
que tout est possible à Metellus. - Ici
le mot infectum ne doit pas être pris
dans le sens du participe passif ; mais, dans une
acception plus générale,
Térence a dit (Eun., acte III, sc. V,
v. 20) : Amore cogente, nihil est infectum
cupientibus. Infectum est pris ici dans
le même sens que chez notre auteur,
c'est-à-dire dans la même acception
qu'invictus (qui non vinci potest),
incorruptus (qui non corrumpi,
etc.). |
|
| (90) Sur
lesquelles on hisse des tours. - Les tours dont
les assiégeants se servaient pour l'attaque
d'une ville étaient d'énormes
machines carrées, de dix à douze
pieds de large sur chaque face, et
proportionnées en élévation
à la hauteur du mur de la place, qu'elles
devaient toujours excéder. La charpente de
chaque tour était garnie de cuir cru pour
empêcher les assiégés d'y
mettre le feu. On posait les tours sur des roues,
et on les faisait avancer à force de bras
vers la muraille. Elles étaient
divisées en trois étages : dans le
bas était la machine du bélier pour
battre 1e pied des remparts ; au milieu une
espèce de pont-levis qu'on abattait sur la
crête du mur, et par lequel les soldats,
logés dans cette partie de la tour,
faisaient une invasion sur les remparts,
d'où ils chassaient les
assiégés. Le dessus était une
plate-forme entourée d'une balustrade.
Là se tenaient des archers et des soldats
armés de longues piques pour écarter
les défenseurs de la muraille.
(Végèce, liv.IV, ch. XVII). |
|
| (91) Le
bélier commença à battre les
murailles. - L'historien Josèphe (de
Bello judaico, lib. III, cap. XV) donne une
ample description de cette machine, dont
Végèce se contente d'énoncer
l'usage, parce que, sans doute, elle était
trop connue de son temps pour être
décrite (lib. IV, cap. XIII, XVII et XXIII).
On attribue généralement l'invention
du bélier à Epeus, l'un des chefs
grecs au siège de Troie (Pline, liv. VII,
ch. LVI) ; mais Vitruve (liv. X, ch. XIX)
prétend qu'il fut imaginé par les
Carthaginois au siège de Gades. Il fut, par
la suite des temps, perfectionné par
Cétras de Chalcédoine ; enfin, au
siège de Byzance, par Polyde le Thessalien,
qui servait sous les ordres de Philippe, roi de
Macédoine et père d'Alexandre. |
|
| (92) Les
deux Syrtes, qui tirent leur nom de la disposition
même des lieux. - Syrtes vient du mot
grec surein, qui veut dire attirer,
parce qu'il semble que les vaisseaux y soient
attirés par le tournoiement des flots.
Varron attribue ce mouvement continuel du fond de
la mer à des bouffées de vent
souterrain qui viennent de la côte, et qui
poussent tout à coup de côté et
d'autre les flots et les sables. Virgile a
dépeint ce phénomène dans sa
description de la tempête qui fit
périr une partie de la flotte troyenne sur
la côte d'Afrique : Tres Eurus ab alto, /
Inbrevia et Syrtes urget, miserabile visu ; /
Illiditque vadis, atque aggere cingit arenae.
(Eneide, I, v.110). On lit dans Lucain (Pharsale, liv. IX) une description des Syrtes assez conforme à celle de Salluste. Voici les traits principaux pris da la traduction de Brébeuf, avec quelques modifications : Des dieux irrésolus ces ouvrages douteux / Ne sont ni mer ni terre, et sont toutes les deux. / Pour repousser les eaux ou leur servir de couche, / Pour ne céder jamais à leur vague farouche, / Ou pour céder toujours à leurs flots courroucés, / Leur assiette est trop basse ou ne l'est pas assez / Par des bancs spacieux ici l'onde est brisée, /Là par des flots captifs la terre est divisée. |
|
| (93) Et
de continuer son chemin. - Sulpice
Sévère, Pomponius Mela et Solin
confirment ces détails,
présentés d'une manière si
animée par Salluste. «Dans ce
malheureux pays, dit Solin, la mer a les dangers de
la terre, et la terre, ceux de la mer. La vase fait
échouer le voyageur dans les Syrtes, et le
vent le fait échouer dans les sables».
Lucain (Pharsale, liv. IX) a
également fait la description de ce
désolant fléau des déserts de
la Numidie. Citons encore la traduction trop
dédaignée de Brébeuf :
«La terre leur fournit la tourmente des
flots. / Le vent n'y trouve point de monts qui le
maîtrisent, / De forêt qui le lasse, ou
de rocs qui le brisent. / Trop libre en sa fureur,
il porte dans les champs / Des nuages de terre et
des syrtes volants. / Les sables agités et
la poussière émue / Egarent les
Romains en leur frappant la vue ; / Et des noirs
tourbillons les insolents efforts / Meurtrissent le
visage et repoussent les corps. M. Burnouf, dont le Commentaire offre de si riches études sur Salluste, a eu l'heureuse idée de rappeler à cette occasion un des plus beaux passages des Martyrs (liv. XI) : «Soudain de l'extrémité du désert accourt un tourbillon, dit M. de Chateaubriand ; le sol, emporté devant nous, manque à nos pas, tandis que d'autres colonnes de sables enlevées derrière nous roulent sur nos têtes. Egaré dans un labyrinthe de tertres mouvants et semblables entre eux, le guide déclare qu'il ne reconnaît plus sa route, etc.» |
|
| (94) Les
Grecs. - C'est-à-dire les
Cyrénéens, qui étaient Grecs
d'origine. |
|
| (95) Et sont enterrés vifs. - Valère-Maxime a aussi raconté l'histoire des Philènes (liv. V, ch. VI); il fait même, à leur sujet, des réflexions très belles. Pline (liv. V, ch. IV) dit que les autels des Philènes étaient des monceaux de sables ; mais il n'en restait déjà plus de trace dès le temps de Strabon. Des critiques ont traité de fable cette merveilleuse anecdote, qui cependant n'a rien d'invraisemblable ; et c'est sans doute le cas de leur appliquer ce que Salluste dit lui-même sur les faits qui sortent de la classe ordinaire : Quas sibi quisque facilia factu putat, eoquo animo accipit ; supra ta, veluti ficta, pro falsis habentur. (Catil., cap. III) |